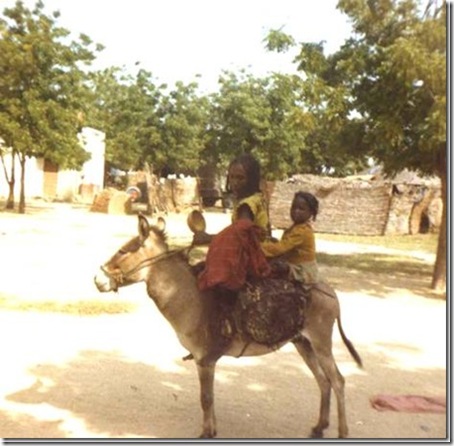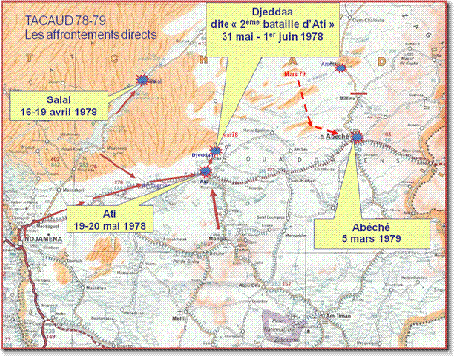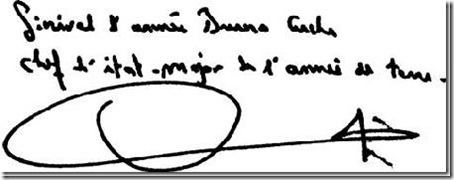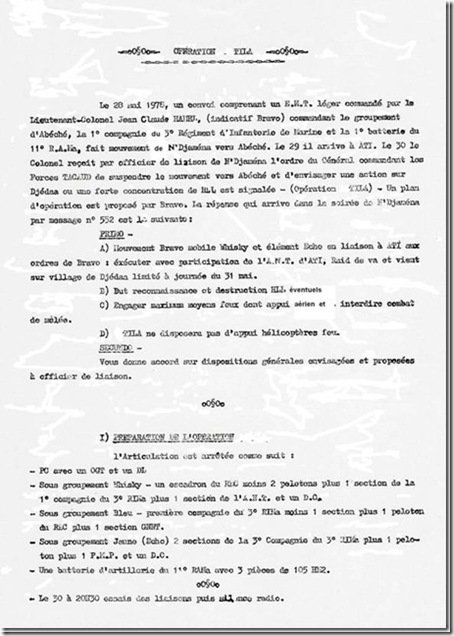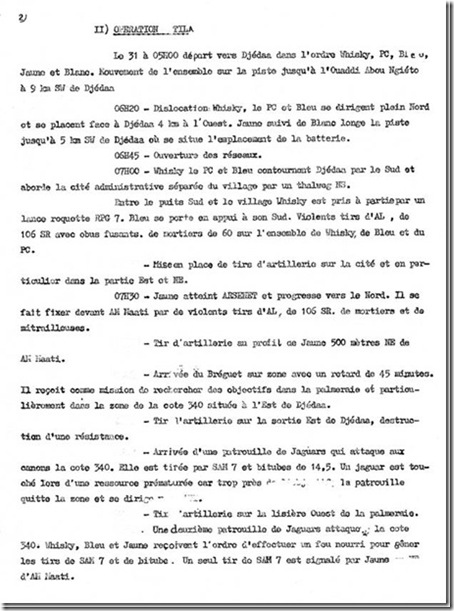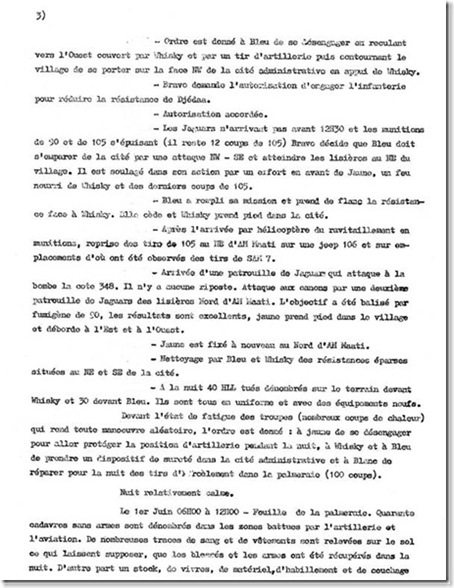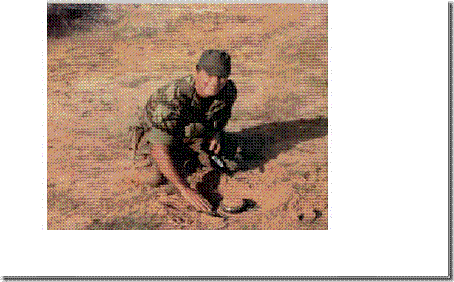Histoire militaire de la France
Retour vers la page principale
- Préambule
- 14-18
- Histoire des régiments de l'Armée Française
- Historiques particuliers
- 3e DLM
- 11e régiment de Dragons Portés (11e RDP)
- 3e Division Légère Mécanique
- Le 2e régiment de Cuirassiers en Belgique
- Epoque moderne
- 14e régiment de Dragons Portés (14e RDP)
- Bataille de Dien Bien Phu
- Histoire des Divisions Légères Mécaniques
- Histoire générale de la Cavalerie Française
- Les Hussards
- Ordre de bataille 1964-...
- Armée française 1960
- Armée française 1964
- Armée française 1970
- Armée française 1980
- Armée française 1982
- Armée française 1985
- Armée française 1995
- Armée française 2000
- Armée française 2012
- Uniformologie
Opération Tacaud, première opex
créé par Tanaka le 12/05/2009, modifié par Tanaka le 23/02/2010
Reproduction intégrale d’un livre qui témoigne de l’Opération Tacaud. Celle-ci ouvrait en 1978 le chapitre des opex dans la longue histoire de l’Armée française.
Préfacé par le Général Bruno Cuche, CEMAT.
Le livre ci-dessous est déposé à la BNF (Bibliothèque Nationale de France) et au SHD (Service Historique de la Défense). Sa reproduction est autorisée et libre de droits, sous réserve de mentionner la source. Au contraire la transformation ou l’adaptation de ce livre même partielles, ainsi que son utilisation commerciale, sont soumises à autorisation. Les auteurs restent propriétaires, chacun pour son travail, de tous leurs droits patrimoniaux et moraux.
Ce livre est principalement l’expression d’un officier issu de Saint-Cyr et diplômé de la Sorbonne. Le texte, accompagné de photos et documents fournis par ceux qui ont partagé cette aventure, raconte un épisode de la première des opérations extérieures (opex) de l’armée française, en 1978.
Depuis la fin de la guerre d’Algérie seize ans plus tôt, l’armée française n’était sortie de ses casernes et camps d’exercice qu’avec discrétion : à la demande de dirigeants de nos ex-colonies quelques actions d’AMT, « aide militaire technique » constituées d’effectifs peu nombreux équipés de matériel d’infanterie, avaient été mises en place sans attirer l’attention du public.
En 1978 commença une série d’interventions extérieures d’un style nouveau, plus visibles, série qui continue aujourd’hui. Les opérations extérieures étaient faites par des unités d’engagés volontaires qui préfiguraient l’armée actuelle.
Ce livre est doublement une nouveauté. Non seulement parce que « la Grande Muette », trop longtemps bâillonnée par un devoir de réserve qui était soigneusement respecté par crainte de récupérations politiciennes, s’affranchit maintenant de son mutisme et participe tranquillement au débat sur la Défense Nationale, après avoir commencé sur internet.
Une nouveauté aussi par les faits que ce texte relate, parce qu’ils étaient le début des « opex ».
Ecrit dans un langage clair, accessible à toutes et à tous, c’est un livre qui intéressera les profanes. L’on y verra, peut-être avec surprise, que nos militaires ne ressemblent pas aux personnages psychorigides popularisés par le cinéma et que l’on se plaît à caricaturer, imaginant trop souvent qu’ils sont réels.
L’on y verra surtout que des missions comme «désarmez les rebelles », faciles à dire, ne sont en fait pas si simples : elles exigent de ceux qui accomplissent la mission, pour être honorablement réussies sur le terrain, une grande force de caractère et une haute valeur morale.
C’est un livre qui intéressera aussi, parce qu’il décrit une action de leurs prédécesseurs, les spécialistes confirmés.
Les candidats à l’engagement s’y informeront de la réalité constante de ce métier difficile, parfois dangereux, mais humainement passionnant.
Opération tacaud, première opex
Auteur : Yves Cadiou. Dépôt légal BNF : janvier 2008
Préface par
Le Général d’Armée Bruno Cuche
Chef d’état-major de l’armée de terre
SALAL 16-19 avril 78 : 2° escadron du RICM, un Détachement d’assistance opérationnelle de la 9°DIMa avec l’armée tchadienne.
Deux tués RICM et dix blessés.
Pertes importantes chez l’ennemi.
SALAL 25 avril 1978 : 4°compagnie du 3°RIMa, 1°escadron du 1°REC.
Un tué 3°RIMa.
Résultat : fin de l’insécurité dans ce secteur.
ATI 19 mai 78 : EM 2°REP , 3°compagnie du 3°RIMa, ALAT, Jaguars.
Deux tués 3°RIMa, douze blessés.
ATI 20 mai 78 : EM 2°REP, 3°compagnie du 3°RIMa, ALAT, Jaguars, 1er escadron du 1°REC, une section CCS du 3°RIMa.
Un tué 1°REC.
65 kalachnikov et 10 armes lourdes prises à l’ennemi.
DJEDDAA 31 mai-1°juin 78 : EM 3°RIMa, 1ère compagnie du 3°RIMa, 1er escadron du 1°REC, 1ère batterie du 11°RAMa, 3° compagnie du 3°RIMa, Jaguars.
Un Jaguar abattu, blessés légers.
Plus de cent armes prises à l’ennemi, dont dix missiles SAM7.
Résultat : fin de l’insécurité dans ce secteur.
ABECHE 5 mars 1979 : EM 3°RIMa, 1°compagnie du 3°RIMa, 2°escadron du RICM, 1° batterie du 11°RAMa, ALAT (une AL3 SS11 et un Puma C20), Tchadiens : Forces Armées du Nord (FAN).
Un tué 1°compagnie du 3°RIMa, un blessé grave 2°escadron du RICM, dix blessés légers, une AML détruite, plusieurs véhicules endommagés.
Pris à l’ennemi : 850 armes dont 13 mitrailleuses, 12 lance-roquettes RPG7, un bitube de 14.5 mm, 6 jeeps-canon de 106SR, 5 mortiers de 81 et 34 missiles SAM 7. Nombreuses munitions et mines, 36 véhicules divers, de la Toyota armée au camion gros porteur.
Opération tacaud, première opex
L’histoire qui suit est un témoignage, ce n’est pas un roman : tous les faits sont réels, ainsi que les acteurs. Que ceux-ci me pardonnent les petites erreurs que ma mémoire, pourtant fidèle, a pu commettre. Yves Cadiou
Préface
par le Général d’Armée Bruno Cuche
Chef d’état-major de l’armée de terre
1.Avant le choc
11. La Première du Grand Trois
12. Courte halte à N’Djaména
13. Il faut atteindre Abéché avant le début des pluies
14. Vous avez sûrement une place pour moi, Mon capitaine
15. Un environnement difficile
16. Le Batha
17. L’escadron Ivanoff
18. Un renseignement population
19. Oui, et qu’Allah protège les Frani
2. Choc
21. Briefing
22. Les trente secondes
23. Les Bigor
24. Assaut retardé
25. Désarmement
3. Stabilisation
31. Le pony-express sahélien
32. L’Hadjeraï
33. « Se plier aux circonstances »
34. Les gars du Ouaddaï
35. Le Connétable de Richemont
36. Le GMP
37. Les « bons principes »
38. La relève
39. Soyons clairs
4. D’autres témoignages
41. Patrick Langöhrig, Tacaud début, milieu et fin
42. Gildas Sonnic, sur le déminage
43. Yves Bitsch
44. Mais d’où viennent donc les « Chats Maigres » ?
Postface
par M. Guy de Kersabiec
Vice-président du Conseil Général du Morbihan
Avant-propos.
Une profonde évolution de la Défense nationale débuta en France en 1978. Les conséquences de cette évolution sont actuelles.
Depuis la fin de la guerre d’Algérie seize ans plus tôt, l’armée française n’était sortie de ses casernes et camps d’exercice qu’avec discrétion : quelques actions d’AMT « aide militaire technique », constituées d’effectifs peu nombreux équipés de matériel d’infanterie, avaient été mises en place à la demande de dirigeants de nos ex-colonies sans attirer l’attention du public.
En 1978 commença une série d’interventions extérieures d’un style nouveau. De ce fait, le public et le monde politico-médiatique recommencèrent à s’intéresser aux questions de Défense après avoir longtemps cru que l’on pouvait ne plus y penser, la dissuasion nucléaire et le service militaire obligatoire étant jusqu’alors supposés régler tous les problèmes.
Les interventions extérieures étaient faites par des unités d’engagés volontaires. Peu nombreuses à cette époque dans une armée principalement formée des gros bataillons fournis par la conscription, les unités d’engagés volontaires préfiguraient l’armée actuelle et ses « opex » (opérations extérieures). Celles-ci occupent désormais une place importante dans notre dispositif militaire.
Les opex débutent en février 1978 :
1978 / 80 : Tchad (opération tacaud), Liban depuis mars, Zaïre (Kolwesi mai)
1980 : République Centrafricaine (opération barracuda)
1982 / 83 : Liban, République Centrafricaine, Tchad (opération manta )
1984 : Tchad (opération manta 2 )
1990 : Gabon (opération requin), Tchad (opération épervier )
1991 : Irak (opération daguet)
1992 : Tchad (opération épervier 2 ), Somalie (opération oryx)
1994 : ex-Yougoslavie, Rwanda (opération turquoise)
1995 / 96 : ex-Yougoslavie
1996 / 97: République Centrafricaine (opération almandin)
1997 : Bosnie (opération salamandre )
1998 : Tchad (opération épervier 3 )
1999 : Bosnie (opération salamandre 2 ), Macédoine (opération trident)
2000 : Kosovo, Sénégal, Côte d’Ivoire, Bosnie
2001 : Bosnie, Tchad
2002 : Sénégal, Kosovo, Côte d’Ivoire (opération licorne)
2003 : Côte d’Ivoire (opération mamba, européenne)
2003 : Congo (opération artemis, européenne)
2004 / … : Côte d’Ivoire
Le texte ci-après raconte un épisode de la première de ces opex.
Opération tacaud, première opex
« La grande immoralité, c’est de faire un métier qu’on ne sait pas » (Napoléon 1er, fondateur de Saint-Cyr)
« Nos ancêtres entrèrent dans l’Histoire avec le glaive de Brennus » (Charles de Gaulle)
Dédié à l’Adjudant-Chef Joseph Birien, instructeur au Prytanée en 1966 / 68, avec ses états de service impressionnants (onze citations au combat et trois blessures) :
« Debout, Messieurs, il est 6h30 ! Debout ! Le concours d’entrée à Saint-Cyr est dans N jours, une nouvelle journée de travail vous attend, ne soyez pas en retard ! Se lever le matin, c’est comme monter à l’assaut, c’est un effort de volonté ! Vous êtes ici parce que vous le voulez : debout, Messieurs ! »
Joseph Birien vient de décéder à l’âge de 79 ans et ses obsèques se sont déroulées le 22 avril 2009 en après-midi, à l’église, en présence d’une forte délégation d’adhérents des associations patriotiques de la Presqu’île de Crozon, de nombreux drapeaux venus de tout le département et de très nombreux amis. Joseph Birien est né à Argol, le 6 janvier 1930. En 1940, il s’engage dans l’Armée de terre et sa première affectation est le 41e régiment d’infanterie. Volontaire pour l’Indochine, il est muté au 43e régiment d’infanterie coloniale sur les Hauts plateaux du Sud Vietnam. Au cours de nombreuses opérations dans la région de Komtum où se trouvent plusieurs minorités catholiques, il apprend à connaître ce peuple. Rapatrié, il est ensuite affecté dans un bureau pour un emploi qui, très vite l’ennuie. Il se porte alors volontaire pour un deuxième séjour en Indochine. Puis, c’est l’Algérie où il effectuera deux séjours au 27e bataillon des chasseurs alpins en Kabylie. De 1962 à 1964, il est affecté à Annecy au 27e bataillon des chasseurs alpins.
À sa demande, il rejoint l’École du prytanée militaire à La Flèche (72). Pendant huit ans, il sera responsable des classes préparatoires à Saint-Cyr. En 1972, il prend sa retraite et est nommé sous-lieutenant de réserve puis lieutenant. Jusqu’en 1979 il participe à l’instruction des réserves. Au terme d’une carrière exceptionnelle, l’adjudant-chef Birien totalisera 14 titres de guerre, commandeur de la Légion d’honneur depuis 2001 et médaillé militaire.
Préface
du Général d’Armée Bruno Cuche
Caporal d’honneur de l’Infanterie de Marine
Chef d’état-major de l’armée de terre
« Je pense à Terre des hommes de Saint-Exupéry. Dans son omnibus, il y a ceux qui vont au bureau comme tous les jours, comme ils l’ont fait la veille et comme ils le feront encore le lendemain et encore tous les jours, et il y a celui qui va s’envoler pour le Sahara occidental par-dessus les montagnes d’Espagne au prix de quelques risques qui, au passage, affûteront ses qualités. Dans l’omnibus de Saint Ex, j’ai pris le bon ticket… pour franchir mes propres montagnes ». Cette phrase, à elle seule, traduit l’esprit de ce livre qui est à la fois le récit d’une guerre oubliée et une formidable aventure humaine. Car Yves Cadiou, ancien commandant d’unité de la Première compagnie du Grand Trois de marine et mon camarade de promotion de Saint-Cyr, nous fait revivre l’épopée, à la fois glorieuse et tragique, d’une troupe de Marsouins lancés à la poursuite de rebelles aux confins orientaux du Tchad. Cette première phase de l’opération Tacaud, dont le point d’orgue est la bataille de Njédaa, est un récit de guerre dont l’humanité peut surprendre et émouvoir celui qui ne connaît pas les ressorts de l’action militaire. Car l’humanité est présente à chaque page du livre, comme elle est toujours présente aux pires moments des combats, lorsque la violence se déchaîne, que l’exaltation du combat prend le pas sur la peur et que, finalement, la mort frappe aveuglément… au moment où on l’attend le moins. Elle s’exprime d’abord entre les hommes de la Première compagnie, autour de leur capitaine. La fraternité d’armes, cette véritable «intégration», entre les officiers, sous-officiers et soldats, de toutes origines sociales et géographiques, puisque de nombreux Marsouins sont originaires des «îles», n’est pas un slogan. C’est une réalité forgée sous le sifflement des balles et dans la promiscuité du quotidien au milieu du désert hostile.
Cette humanité s’exprime aussi par les liens de confiance tissés au jour le jour avec la population locale. Par respect pour leurs hôtes et par nécessité opérationnelle, les militaires français, et les troupes «coloniales» en particulier, cultivent l’immersion au sein des populations, partageant la rudesse de leur vie et leurs coutumes. En ce début d’été 1978, comme le plus souvent lorsque l’armée française intervient sur le continent africain, notre arrivée est accueillie avec soulagement par une population soumise aux exactions incessantes des rebelles et des bandes criminelles. Car ne nous y trompons pas, la population n’attend pas le plus souvent une aide humanitaire sous forme d’aide alimentaire ou médicale. Elle espère le rétablissement de la sécurité pour permettre le retour à la normalité. Or l’action humanitaire, indispensable dans l’urgence, est souvent inefficace dans la durée lorsqu’elle est confondue avec l’action non-violente. Ainsi que le rappelle opportunément Yves Cadiou : «la dissuasion, mot trop souvent galvaudé, ne consiste pas toujours à seulement montrer ses armes : elle consiste à convaincre les gens dangereux que l’on fera, à coup sûr et sans rémission, usage des armes. Et il faut parfois en faire vraiment usage pour que la menace soit prise au sérieux»… pour que la peur quitte le camp des civils innocents et gagne celui des agresseurs. A Njédaa, le Frolinat l’aura compris à ses dépens. Défait après l’assaut victorieux de la compagnie Cadiou, appuyée par l’escadron blindé Ivanoff de la Légion étrangère, les canons de 105 des bigors du 11ème de Marine et les Jaguars de l’armée de l’air, il évitera désormais chaque fois que possible l’affrontement direct. Cette bataille, trente années après, reste finalement d’une étonnante actualité. Au moment où l’histoire bégaie au Darfour, nos forces terrestres, nos régiments et nos compagnies, à l’instar de leurs illustres devancières, sont toujours parfaitement préparées et équipées pour intervenir, avec l’appui des autres armées, pour rétablir ou maintenir la paix. Partout dans le monde, en Afrique, en Afghanistan, au Kosovo ou au Liban, elles prouvent leur excellence : elles sont réputées et respectées.
Mais au-delà de cet éclairage sur les opérations d’hier qui ressemblent étrangement à celles d’aujourd’hui, Yves Cadiou signe un hommage poignant à ceux de nos camarades qui sont tombés au champ d’honneur, hommage dont la pudeur illustre mieux que n’importe quelle envolée lyrique le sens profond du métier des armes. Il prouve que la mémoire, loin de mythifier le passé, permet d’aider les jeunes générations à mieux comprendre le présent et à découvrir, au-delà des préjugés, la dimension unique du métier de soldat qui forge les âmes et les corps. Nos jeunes soldats trouveront, quant à eux, dans l’exemple de leurs aînés, une source d’inspiration pour guider leurs pas sur le chemin de la victoire et de l’honneur.
Opération tacaud, première opex
Yves Cadiou :
Par ordre de notre gouvernement, nous sommes ici pour désarmer les rebelles tchadiens.
Notre gouvernement, vous avez procédé à son élection dans le respect absolu des règles de la démocratie. C’est en votre nom que le 31 mai de cette année-là nous désarmons cette bande.
Mais celui-ci m’a envoyé une rafale de kalachnikov et il en est mort avant de pouvoir recommencer, je n’ai pas eu le temps de lui parler, même pas eu le temps de lui demander comment il s’appelait. Il est parmi ces pauvres bougres dont il ne reste que les cadavres sur le sable après qu’ils ont essayé de nous flinguer ce matin-là.
Si celui-ci ou celui-là avait un nom, personne ne s’en souviendra. Son cadavre est destiné à sécher sur le sable du désert jusqu’à ce que le vent l’y ensevelisse. Comme les autres autour de lui. Habillés de treillis kakis ou bariolés, ils croyaient être des guerriers. Ils n’étaient que des malfaiteurs. Mais ils savaient rêver. Des gens venus de loin leur ont donné des uniformes et des armes en leur faisant miroiter qu’ils deviendraient ainsi les maîtres du pays. Ils ont écouté ces gens, ils ont rêvé, ils sont morts.
Quand j’ai ramassé la kalachnikov sur le cadavre, j’ai aussitôt vu qu’elle était de fabrication chinoise. Si vous ne connaissez rien au métier des armes, vous ignorez qu’une arme qui tire par rafale a normalement tendance à monter vers la droite pendant le tir. Ne soyez pas navrés de l’ignorer, car même ce brave Rambo ne le sait pas : lui et ses collègues tiennent leur arme de cinéma comme ils tiendraient un marteau-piqueur pour attaquer la falaise (c’est une attitude photogénique, plus que de tenir son arme d’une façon techniquement correcte) alors ils ne s’attardent pas à vous montrer le problème de la déviation du tir vers le haut à droite.
Afin d’atténuer ce problème de déplacement du tir, les Chinois ont eu l’idée de modifier un peu le modèle de la kalachnikov soviétique. Le bout du canon du modèle chinois est taillé en biais, comme un sifflet de pipeau : il forme un bec en bas à gauche. Les gaz qui propulsent la balle appuient ainsi vers le bas et vers la gauche au sortir du canon, compensant la poussée naturelle qui veut dévier le tir vers le haut et vers la droite.
N’empêche que ce mec m’a loupé et qu’il en est mort.
Mais les Chinois n’y sont presque pour rien : les Chinois ont besoin d’argent, ils ont fabriqué des kalachnikov en modifiant un peu le modèle soviétique, ils les ont vendues à des acheteurs qui disposent de revenus pétroliers en hausse, des trafiquants libyens. Nous sommes en 1978.
Depuis quelque temps, les Libyens ont des visées sur le Tchad. Leurs prétextes sont divers, mais leurs vrais motifs sont mal élucidés. Ils ont fait distribuer ces armes à des pauvres bougres qui s’en sont servis et qui en sont morts. C’est très simple, au fond.
Pour nous aussi c’est très simple. Ils ont tiré de trop loin, parce que brusquement ils ont tous eu la trouille. Sinon, s’ils avaient pu se maîtriser, attendre juste un peu que nous avancions à meilleure portée, ils auraient fait un massacre et je ne pourrais pas, aucun d’entre nous ne pourrait, vous raconter cette histoire.
1. Avant le choc
11. La Première du Grand Trois
L’affaire s’annonçait depuis plusieurs semaines. La compagnie d’Infanterie de Marine que je commandais venait de rentrer à sa base en Bretagne, après quatre mois au Gabon, séjour paisible de simple présence amicale et historique, mais séjour qui fut mouvementé pour cause de circonstances exceptionnelles. Les cent trente-huit professionnels qui formaient ma compagnie avaient fait preuve, dans la brousse équatoriale peu accueillante, d’une belle capacité à s’adapter à des situations difficiles et imprévues, rapidement et sans se désunir. Il semblerait que j’avais alors été un bon capitaine, parce qu’Omar Bongo, le Président du Gabon, m’avait décerné la « médaille de la reconnaissance gabonaise », ma première décoration.
Mais c’est une autre histoire.
Il n’en reste pas moins que, médaille ou pas, j’étais fier et honoré de commander une telle compagnie, « la Première du Grand Trois ».
Entendez 1ère Compagnie du 3ème Régiment d’Infanterie de Marine (3ème RIMa), basé à Vannes (Morbihan) : à l’époque c’était l’un des rares régiments d’engagés volontaires de notre armée, qui était principalement composée par ailleurs de personnels enrôlés sous la contrainte pour le Service Obligatoire (on disait « des Appelés »).
On nomme traditionnellement « Grand Trois » le 3ème RIMa basé à Vannes parce qu’il fait partie des « Quatre Grands », comme on dit des aînés dans une famille, qui étaient autrefois basés dans nos quatre ports militaires, prêts à embarquer : le «Grand Un» à Cherbourg, le «Grand Deux » à Brest, le « Grand Trois » à Rochefort et le « Grand Quatre» à Toulon.
En rentrant à notre base en Bretagne, nous savions que nous ne tarderions pas à repartir, mais avec le plein de munitions réelles cette fois. Pour le Tchad, en Afrique Noire francophone comme le Gabon, mais avec un tout autre environnement et une toute autre situation sociologique.
Pays vaste et situé en grande partie en zone sahélienne, le Tchad était comme je vous l’ai dit la proie de bandes de malfaiteurs armés par la Libye. Ces bandits de grand chemin vivaient « sur le pays », pillant les maigres réserves de vivres dans les villages, interceptant les voyageurs et les commerçants, s’appropriant les véhicules et les marchandises, les troupeaux, les puits, massacrant quiconque s’opposait. Ces exactions étaient perpétrées sans réaction sérieuse de l’armée tchadienne, peu motivée et parfois complice.
La France avait missionné quelques unités militaires pour rétablir la situation, mais en trop petit nombre. Quelques-uns de nos camarades avaient été tués, tentant d’accomplir leur mission en dépit de l’infériorité de leurs moyens. L’ennemi était composé de plusieurs bandes, dont chacune se comptait en centaines d’hommes, supérieurement armés comme j’ai pu le constater moi-même plus tard : outre ses kalachnikov, l’ennemi disposait de quantité de lance-roquettes anti-chars RPG7 soviétiques, de mitrailleuses de 14.5 sur véhicules, de mortiers de 81, de canons de 106SR, de missiles anti-aériens portables SAM7 soviétiques, de fusils d’assaut de différents modèles. Parmi tout cet arsenal, des armes françaises cédées de gré ou de force par des militaires tchadiens.
L’infériorité de l’ennemi ne résultait que de sa faible compétence tactique et de son fallacieux sentiment de supériorité, au moins dans un premier temps. Son illusion de puissance était due à ses effectifs nombreux ainsi qu’à la quantité et à la qualité de son armement, illusion dangereuse pour lui mais développée par ses premiers succès contre les troupes régulières tchadiennes et contre les trop petits détachements français.
Vivant de façon nomade, ces bandes étaient toujours difficiles à localiser et conservaient l’initiative du combat. De ce fait l’insuffisance des effectifs français initiaux leur donna des victoires faciles. Faciles pour lui mais meurtrières pour nous. Nous maudissions la pusillanimité des décideurs politiques. Le devoir des décideurs est de décider : faire quelque chose ou ne rien faire. L’indécision et les demi-mesures ne produisent pas de bons résultats.
12. Courte halte à N’Djaména
Au moment où ma compagnie arrivait au Tchad avec des renforts qui seraient peut-être enfin suffisants, le moral de l’ennemi était « gonflé à bloc », ce que nous pouvions détecter en écoutant ses émissions-radio de propagande à destination de qui voulait les écouter.
Pour couvrir les crimes de ces malfaiteurs, et pour obtenir les meilleures parts du butin quand le moment serait venu (les meilleures parts sont les emplois où l’on touche l’aide au Tiers-Monde : chef d’état, ministres, ambassadeurs) ceux qui les manipulaient leur avaient attribué une étiquette politique : « front de libération nationale du Tchad », frolinat. Ils n’étaient pas allés jusqu’à y ajouter les épithètes magiques de l’époque : «démocratique » ou « socialiste ». Il est vrai que « socialiste » derrière « national », c’est peu porteur.
Si l’on écoutait les communiqués de radio-frolinat, les prétendus « rebelles » avançaient de victoires en victoires dans une marche irrésistible vers la prise du pouvoir à N’Djaména, la capitale.
Dans la réalité, il ne s’agissait que d’une série d’exactions qui frappaient les villes, bourgades et villages. Si l’on ne faisait rien, les exactions ne cesseraient qu’avec la mise à sac de la capitale et l’installation d’un nouveau « chef d’état » inféodé aux Libyens.
L’urgence pour nous était d’inverser le cours des choses, à la fois dans l’intérêt de la population livrée à un brigandage tragique, population déjà extrêmement pauvre et menacée de la disparition de toutes ses ressources, et dans l’intérêt de nos positions en Afrique où nos nombreux alliés et sympathisants considéraient l’affaire comme un test de notre efficacité.
Mieux valait pour nous que nous fussions fins tacticiens, pour compenser l’infériorité de notre armement : l’essentiel de celui-ci datait de la guerre d’Indochine, comme en témoignent les chiffres ci-après qui représentent l’année de sortie de chaque modèle. Fusil MAS 49 modifié 56 tirant coup par coup ; pistolet-mitrailleur MAT 49 ; fusil-mitrailleur AA 52 . Mais ma compagnie était aussi dotée de quelques armes moins surannées : neuf fusils de précision modernes modèle FRF1 avec lunette optique grossissement x4, et neuf lance-roquettes anti-chars LRAC d’un modèle récent, calibre 89 mm. Ne vous étonnez pas de la présence de ces munitions anti-chars, cela perce aussi bien les murs.
Ces FRF1 et LRAC pouvaient être équipés de lunettes à vision nocturne par intensification de lumière, ultra-modernes pour l’époque. Ces précieuses lunettes nous avaient été livrées à l’instant du départ, au dernier moment. Nous les connaissions mal et nous n’avions pas eu le temps d’en faire les réglages. Pour cela, il faudrait d’abord charger les batteries : ces lunettes fonctionnaient avec des batteries qu’il fallait charger sur du 220 volts mais nous n’en avions pas eu le temps. Au Tchad, où tout était en 110 volts, nous n’avons pas trouvé de 220 volts jusqu’à ce qu’on nous livre un petit groupe électrogène à essence quelques semaines plus tard. Elle n’ont donc été utilisables qu’après la bataille que je veux vous raconter, la plus décisive de cette intervention (dite « opération tacaud ») car cette bataille à Njédaa, 45km au nord d’Ati, fit basculer la situation d’ensemble à notre avantage.
En arrivant à N’Djaména par un DC8 charter de la compagnie UTA, nous avions retrouvé quelques camarades et bons copains qui étaient en séjour d’aide technique dans l’armée tchadienne, une présence française presque continuellement renouvelée par des séjours individuels d’un ou deux ans depuis l’indépendance en 1960. Plutôt contents de nous voir arriver, les copains, et pas seulement pour le plaisir d’évoquer des souvenirs.
Pendant les quelques jours où nous sommes restés à N’Djaména, nous recevions nos véhicules et les remettions en condition : c’étaient les camionnettes bâchées de marque simca que nous utilisions en France. Elles arrivaient par avions civils gros porteurs jusqu’à Libreville au Gabon, base de notre 6ème Bataillon d’Infanterie de Marine qui se chargeait alors de les transférer dans des avions Transall militaires pour les convoyer jusqu’à N’Djaména dont l’aérodrome n’était pas équipé pour les gros porteurs.
Cette courte halte à N’Djaména nous permettait de nous préparer matériellement à un séjour dans un secteur un peu rustique où 700km de route nous mèneraient, si l’on peut parler de « route » : nous n’avons vu que des pistes, la route à peu près digne de ce nom s’arrêtant à quelques kilomètres de N’Djaména.

A l’époque, nos véhicules d’infanterie ne sont ni blindés ni armés : c’est seulement douze ans plus tard que le 3ème RIMa sera équipé de véhicules blindés armés d’une mitrailleuse. (photo Patrick Langöhrig)
L’idée du Général commandant les forces françaises au Tchad était de renforcer au plus tôt le détachement trop léger qui se trouvait à Abéché, chef-lieu du Ouaddaï, à l’extrême Est du Tchad, c’est-à-dire de l’autre côté. Cette zone, qui est une petite partie du Darfour, est maintenant connue du public à cause des drames qui continuent de se produire au Soudan voisin et débordent sur le Ouaddaï, qui est le Darfour tchadien.
Pendant ces derniers jours de mise en condition, nos camarades en séjour d’aide militaire technique dans l’armée tchadienne, ainsi que les tchadiens restés loyaux, nous ont apporté le maximum d’aide. C’est ainsi que nous avons obtenu, sans presque avoir à les demander, quelques matériels bien venus.
Inventaire à la Prévert : deux mortiers de calibre soixante avec leurs munitions (je les prévoyais particulièrement utiles car ma compagnie manquait de puissance de feu et n’avait aucune arme à tir courbe, à l’exception de petits dispositifs lance-grenades au bout des fusils modifiés 56, portant à 400m au maximum et tirant à cadence très lente) ; des tapis anti-mines à placer sur le plancher des véhicules pour limiter les blessures « au cas où » ; quatre vieux camions GMC américains des années 40 dont l’un que nos amis reconstruisirent en une nuit, y compris décabossage et peinture sommaire, avec les éléments rassemblés de deux épaves débusquées dans un coin (dans ce pays sec, rien ne rouille vite, les pièces restent longtemps réutilisables) ; une cuisinière roulante ; une tonne à eau sur remorque ; une chambre froide qui devrait attendre l’arrivée du groupe électrogène que l’on nous enverrait par avion si c’était possible ; plusieurs roues de secours supplémentaires et un kit pour réparer les chambres à air ; des remorques ¼ de tonne à atteler derrière les jeeps ; pour toutes sortes de réparations de fortune, du fil de fer ; une pompe Japy pour faire les pleins des réservoirs si l’on nous livrait le carburant en fûts ; des plaques dites PSP pour franchir les zones de sable mou. J’en oublie certainement.
Après notre arrivée à Abéché, cette bourgade bien placée serait donc tenue par un groupement de trois unités sous le commandement du Colonel Hamel qui venait d’arriver lui aussi à N’Djaména. Il était, depuis huit mois, le Chef de Corps du Grand Trois. Entendez qu’il commandait le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine dont ma compagnie faisait partie. La quasi-totalité du régiment se trouvait désormais au Tchad, ses compagnies étant dispersées entre les différents points d’appui français. Le Colonel Hamel avait commencé sa carrière, jeune officier en Algérie, sous les ordres de Bigeard. Ma compagnie, dite « la Première du Grand Trois », était la dernière arrivée en dépit de son appellation, ayant été retardée par son séjour au Gabon et la nécessité de se reconstituer pour remplacer trente-cinq hommes en fin de contrat.
La Première avait donc une bonne excuse pour arriver la dernière chrono, en même temps que le colonel. Nous le connaissions d’ailleurs assez peu jusqu’alors, du fait de nos fréquentes missions à l’extérieur.
Je n’allais pas tarder à découvrir, chez ce « Bigeard’s boy » de quarante ans bien dans sa peau, son sens des populations, du terrain et de la manœuvre, celle qui réussit. « La chance, ça se mérite » disait-il souvent. J’étais d’accord avec ça : ceux qui me connaissent savent que je ne laisse rien au hasard, ou le moins possible. Méthode, ça s’appelle.
Le groupement d’Abéché serait formé de ma compagnie et d’une batterie d’artillerie du 11ème RAMa, Régiment d’Artillerie de Marine (qu’on appelle traditionnellement « les Bigor »), en plus de l’unité de blindés légers (un escadron du RICM, Régiment d’Infanterie & Chars de Marine) qui était déjà sur place depuis trois mois et avait subi des pertes.
La batterie d’artillerie du 11ème RAMa était arrivée à N’Djaména peu après ma compagnie. Elle était équipée de canons de calibre 105, des modèles 105 HM2 dont les Américains avaient doté les FFL (forces françaises libres) en 1944.
Nous ne savons pas encore, au moment de quitter N’Djaména, que la présence de cette batterie sera notre sauvegarde dans cinq jours.
13. Il faut atteindre Abéché avant le début des pluies
Nous formons convoi avec la batterie de 105, de N’Djaména jusqu’à Abéché, en passant par Ati à mi-parcours. Ma compagnie compte maintenant vingt véhicules : nos deux jeeps et nos quatorze camionnettes qui sont arrivées de Bretagne et les quatre vieux camions GMC dont on vient de nous faire cadeau. Pour avoir mon compte de conducteurs avant le départ de Bretagne alors que beaucoup étaient en fin de contrat et devaient être remplacés, il a fallu s’adapter au problème posé et être inventif. Je vous en parlerai tout à l’heure, avant l’arrivée à Abéché, quand mes conducteurs auront 700 km au compteur sans accident, avec quelques pannes dont aucune ne sera due à de la négligence.
L’ensemble de la colonne totalise plus de quarante véhicules dont un camion-citerne civil pour transporter notre carburant, comme ceux que l’on voit sur nos autoroutes mais pas très à l’aise ici. Des aviateurs nous diront par la suite que le nuage de poussière soulevé par notre convoi était épais et se voyait de loin, ce qui aura son importance.
Nous sommes à la fin mai, généralement c’est vers juin que commence la saison des pluies. Il faut passer avant le début des pluies qui rendent les pistes impraticables aux véhicules lourds et les terrains d’aviation aléatoires même pour les avions de transport militaires Transall qui sont pourtant peu exigeants.
La veille du départ, je donne l’ordre de distribuer les munitions réelles. Nous serons en zone d’insécurité (de fait, nous sommes ici pour y remédier), nous voyagerons donc avec les chargeurs pleins, les armes approvisionnées mais au cran de sûreté. Jusqu’à présent, en presque dix ans de service, je n’avais jamais ordonné une distribution générale de munitions réelles ailleurs que sur un champ de tir. Habituellement lors de nos sorties, seuls quelques gradés sont dotés de munitions, par sécurité en prévision de mauvaises rencontres. Même en France, où nos armes peuvent susciter les convoitises de gangsters qui ne sont pas tous en prison. Cette fois, c’est la totalité de la compagnie qui est prête à cracher le feu. Nous ne savons pas encore que ceci surviendra dans cinq jours mais nous sommes prêts autant qu’il a été possible de le devenir, matériellement, techniquement et moralement. Dès avant le départ de France, nous avons mis de notre côté toutes les chances possibles. Et nous sommes à effectifs complets. C’est que les volontaires n’ont pas manqué.
14. Vous avez sûrement une place pour moi, Mon capitaine (Ce « Mon » traditionnellement utilisé devant le grade n’est pas un pronom possessif, c’est une abréviation de « Monsieur » : on remplace « Sieur » par le grade.)
Avant le départ de France, pendant que je complète ma compagnie pour remplacer les soldats en fin de contrat, j’ai réparti dans les sections une trentaine de recrues qui sortent de leur formation initiale (lecteurs civils, vous diriez : « les bleus qui ont terminé leurs classes »), il me reste encore une demi-douzaine de postes à pourvoir. Plusieurs volontaires se présentent les uns après les autres.
Evidemment, je souhaite prendre parmi eux les meilleurs, mais la Base Arrière, c’est-à-dire la petite partie du Régiment qui restera à Vannes, ne veut pas trop se dégarnir de ses meilleurs éléments : l’administration, la garde et l’entretien du matériel, du casernement et des installations, mais surtout l’instruction des nouvelles recrues, tout cela nécessite du personnel compétent.
Alors que ma compagnie est la dernière à partir, je représente le dernier tramway, la dernière possibilité de départ avant longtemps pour les volontaires. Quand on a choisi de servir dans l’un des rares régiments d’engagés volontaires que l’armée française compte à cette époque, c’est-à-dire un régiment ayant vocation à partir n’importe où, n’importe quand, ce n’est pas par hasard qu’on est là. De ce fait je ne manque pas de candidats.
Petit problème, c’est que la Base Arrière est commandée par un officier supérieur alors que je ne suis que capitaine. La négociation n’est pas à mon avantage, en dépit de la qualité de mon argument « la mission est prioritaire » auquel on m’oppose qu’il faut aussi préserver l’avenir.
Il y a pourtant, parmi ceux qui me sollicitent, un sous-officier dont la Base Arrière n’aura aucune réticence à se séparer et que je prendrai volontiers, c’est celui qui est devant moi maintenant : pâle, les yeux perçants, les traits marqués et maigre à faire peur, il bénéficie cependant d’une réputation qui me le rend sympathique et je sais qu’il sera efficace sur le terrain. Pour les mêmes motifs, sachant que l’inaction le rendrait insupportable voire dépressif, la Base Arrière préfère ne pas le garder. Il a traîné ses guêtres dans toute l’Afrique, il a fait le coup de feu depuis vingt ans partout où des éléments français étaient en action, y compris pour des opérations dites « aide technique » dont vous n’avez peut-être pas entendu parler.
« Prenez-moi sur n’importe quel poste, je suis d’avance d’accord ». En effet je sais, parce que chacun peut en témoigner dans notre Régiment, que sa compétence est polyvalente et qu’il connaît tous les trucs du métier. C’est lui qui m’apprendra à identifier une kalachnikov chinoise, avec son canon en sifflet comme je vous l’ai dit au début de cette histoire. Il m’apprendra aussi, parmi beaucoup d’autres petits trucs du métier, un petit truc utile au décideur dans l’action d’infanterie sur le terrain : ôter son chapeau pour réfléchir. Je vous répète son conseil, en v.o. : « moi, quand ça commence à péter, je retire mon galure : autrement on fait des conneries si on a quelque chose sur la tête. » Parce que bien entendu je l’ai emmené, sans exactement savoir ce que je lui ferai faire, mais certain qu’il serait très utile.
Son nom : Jambon. Nom bizarre pour un Sergent-chef, ou pour quiconque d’ailleurs. Mais personne n’oserait s’en moquer, on fait avec. Un soir de confidences devant un feu de bivouac, il m’a dit qu’il était un enfant trouvé. Son nom lui a été attribué par l’Assistance Publique à la suite d’une anecdote que je n’ai pas retenue : un surnom transformé en patronyme. Et c’est vrai qu’il n’a aucune famille. Un jour où il devait prendre des permissions, il m’a donné avant de partir la liste des adresses où je pourrais le joindre pour le faire revenir d’urgence si l’ordre d’embarquement pour le Tchad était donné avant la date prévue pour son retour : j’y lis les adresses et téléphones de plusieurs régiments de la Légion et de l’Infanterie de Marine. « Je vais aller voir mes copains » m’a-t-il expliqué. Il a aussi une copine que je ne connais pas, il en parle peu et rarement, il l’appelle « ma gosse », avec une pudique tendresse.
15. Un environnement difficile
Deux jours de piste à partir de N’Djaména pour atteindre Ati, à travers un quasi-désert qui cependant n’est pas totalement aride. De part et d’autre de la piste, le paysage est parsemé de buissons secs ou un peu verts sur lesquels il est préférable de ne pas rouler car ils comportent souvent de solides et longues épines. L’on aperçoit et l’on traverse parfois des zones où la végétation est un peu plus fournie, des bosquets qui comportent quelques grands arbres : des zones un peu moins sèches, sans doute.
Il ne pleut pas. La chaleur, le soleil et le vent nous déshydratent et personne n’est en grande forme, d’autant que nous avons manqué de confort depuis le départ de Bretagne. Aucun accident cependant. La plupart de mes gars connaissent ce genre de terrain et de climat auquel le Gabon, humide et boisé, ne nous a pourtant pas vraiment préparés : mais la compagnie a fait un séjour à Djibouti avec le capitaine qui la commandait avant moi. Quant à moi-même, qui n’ai jamais mis les pieds à Djibouti, un stage au CMIDOM (Centre Militaire d’Information et de Documentation sur l’Outre-Mer) et une manœuvre deux ans plus tôt dans le nord du Sénégal (Diambour) font que ce genre d’environnement ne m’est pas totalement inconnu. Les plus jeunes, qui n’ont que deux mois de service et n’ont fréquenté sur la planète que leur banlieue, la lande bretonne et le granit de Quiberon-Penthièvre où ils viennent de terminer leur formation initiale, sont pris en charge par les anciens : dans ce genre de milieu inhospitalier, l’on peut commettre beaucoup d’erreurs que l’on n’imagine pas.
Ces gars se sont engagés dans l’Infanterie de Marine pour sortir de chez eux, voir autre chose avant d’entrer dans la vie active : ici, ils sont servis et ça n’est pas fini. Je crois aussi que, chacun à sa façon et pour ses propres motifs, ils ont une haute opinion de l’armée française et qu’ils veulent participer pendant quelque temps à sa longue histoire. Aucun n’est ici par inadvertance : les engagements par inadvertance sont détectés pendant la formation initiale et le contrat est alors transformé.
Vous verriez passer ma compagnie, vous ne reconnaîtriez pas l’unité bien rangée que vous pouvez admirer le 14 juillet, si vous voulez admirer : toutes ces lourdes cérémonies militaires publiques où l’on nous fait jouer aux soldats de plomb dans un ordonnancement rigide et surréaliste sont pour moi, en même temps que des corvées, l’expression de la discipline la plus formelle et la plus stupide. Elles donnent de nous une image qui ne correspond pas à notre réalité.
Nous sommes maintenant en opération, par conséquent Sieur Formalisme et sa Cousine Stupidité ne sont pas invités : j’ai fait démonter toutes les portières des camionnettes et camions, aussi surélever les bâches pour que tout le monde puisse vite débarquer si l’on se fait tirer dessus. Les gars, pour s’abriter du vent, du soleil et des volutes de sable, ont enveloppé leur tête dans leur chèche, un grand rectangle de tissu léger beige qui fait partie de l’habillement. Le tout est surmonté du chapeau à larges bords. On ne voit que leurs yeux ou, pour mieux dire, l’emplacement des yeux abrités par les lunettes de soleil. Si vous regardez bien, ne soyez pas surpris de voir que l’extrémité de tous les canons de fusils, pistolets-mitrailleurs et autres armes de petit calibre est couverte d’un préservatif : ce n’est pas freudien, c’est seulement le meilleur moyen d’empêcher le sable d’entrer dans les armes tout en les gardant prêtes à tirer en urgent, sans que le sable bloque le mécanisme.
Mais peu importe l’apparence : ils sont opérationnels, c’est ce qu’il faut. Et attendez : dans cinq jours cette compagnie d’Infanterie de Marine sera encore plus opérationnelle parce que tous auront reçu le baptême du feu.
Elle sera d’un aspect encore plus étonnant aussi, bien que le but ne soit pas d’étonner, car les pistolets-mitrailleurs de calibre 9 mm étant un peu trop faiblards, nous les aurons remis dans leurs emballages de transport et remplacés par les kalachnikov prises à l’ennemi. En traversant les rares villages, nous nous arrêterons toujours quelques minutes, non seulement pour faire une pause, mais aussi pour que nous soyons identifiés comme Français, car au passage ce n’est pas évident. Alors bavarder un peu avec les chefs de village, qui sont en djellaba mais francophones, cela atteste que ce fort détachement, ce sont les « Frani » (les Français) qui sont venus régler leur compte aux malfaiteurs.
Les chefs de village comprennent alors qu’Allah ne veut plus entendre parler de ces brigands : ils sont en disgrâce et punis certainement parce qu’ils ont trop fait souffrir des bons musulmans.
Allah a chargé des « Nazara » (des Nazaréens, des Chrétiens) d’accomplir Sa divine volonté, mais personne ne s’offusque de Son choix : Allah fait comme bon Lui semble, n’est-ce pas.
Ainsi en quelques jours, la situation s’est inversée. Cela s’est produit à l’occasion de l’étape de mi-parcours à la préfecture d’Ati. Voici comment.
16. Le Batha
Ati, préfecture du Batha, est une bourgade où il sera bon de s’accorder une pause après deux jours de piste à bouffer de la poussière sous le soleil “qui tape comme un marteau sur une enclume” (Lawrence d’Arabie). Nos véhicules surchargés sont parfaitement inconfortables et endolorissent les dos même les plus solides. Et pourtant, nous sommes des gars foncièrement résistants et sportifs, moyenne d’âge 23 ans (du haut de mes 30 ans, je suis parmi les plus âgés). On profitera de cette pause pour se laver, délasser les dos, dépoussiérer les armes, resserrer les boulons des véhicules, nettoyer les filtres, cirer les rangers (pour conserver leur souplesse, plus que par élégance), essayer de terminer tous les bricolages nécessaires qui n’ont pas pu être faits avant le départ, mais surtout se réhydrater et profiter de la relative fraîcheur (40° quand-même) que l’on trouve sous les arbres. Si c’est possible, nous achèterons des vivres frais.
Les arbres, ici à Ati, donnent une ambiance inattendue dans ce Sahel surchauffé dont nous soulevons la poussière depuis deux jours. Ces arbres d’Ati sont des feuillus, hauts et larges, et non les palmiers ni les buissons habituels. Avec leurs larges feuilles, ils ressemblent aux arbres de nos jardins européens où il fait bon se mettre à l’ombre l’été pour mieux siroter un petit verre avec des glaçons. Ils ont certainement de longues racines pour aller chercher l’eau qui se trouve loin sous la surface du sol.
Les rues principales d’Ati sont larges, ombragées par ces arbres, et l’on pourrait presque se croire dans une petite sous-préfecture de chez nous, avec quelques différences significatives cependant. Pas de pelouses, pas de goudron ni de pavés, le sol est une terre battue gravillonneuse qui n’a pas reçu d’eau depuis des mois. Pas de joueurs de pétanque avec leur béret sur la tête, pas de femmes qui papotent avec leur panier à la main : elles sont ridées, pressées, discrètes, couvertes de tissus ternes. Les hommes au contraire prennent leur temps. Ils sont en djellaba de couleurs claires, le plus souvent bleu-ciel, avec sur la tête un turban de couleur assortie ; détail que j’apprécie, le regard de ces hommes est direct. Je les salue d’un « bonjour Monsieur » comme je ferais chez nous et comme je faisais au Gabon. Je ne soulève pas mon chapeau, car c’est une politesse qu’ils ne pourraient pas me rendre.
Les murs des maisons sont épais et percés d’ouvertures rectangulaires ou voûtées qui tiennent lieu de fenêtres derrière lesquelles on devine que l’ombre intérieure est l’élément principal du confort.
Au moment où nous faisons halte à Ati, les murs portent de nombreuses traces d’impacts : nous savons qu’une compagnie de notre régiment (la 3ème compagnie, Capitaine d’Athis) a sévèrement accroché ici, dix jours plus tôt, au moment où nous-mêmes étions à l’aéroport du Bourget pour embarquer. A N’Djaména, avec le Colonel, je suis allé voir les blessés de la Trois à l’hôpital, leur parler et les écouter. Voici le récit de la bataille d’Ati, tel qu’il est conservé aujourd’hui dans les archives de l’Amicale du 3°RIMa :
Février 1978, le FROLINAT « Front de Libération Nationale Tchadien », soutenu par la Libye, s’est emparé de la partie nord-est du Tchad. En avril, il relance l’offensive en direction du sud–est et des provinces du Ouaddaï et du Batha. L’aide de la France est sollicitée, l’opération TACAUD est déclenchée.
Le 18 mai 1978, la ville d’ATI, préfecture du Batha, est investie par les rebelles. Le 19 mai au matin, l’interprétation de photographies aériennes prises par des Jaguar montre quantité d’hommes, d’armement et des matériels dissimulés dans le village. A 7 heures, la 3e compagnie, stationnée à MONGO, reçoit la mission d’aller prendre le contact avec l’adversaire.
152 kilomètres séparent MONGO d’ATI. A 4 kilomètres du village, les sections débarquent et progressent. En tête, de part et d’autre de la piste l’Adjudant ALLOUCHE et Jaune 3, soutenu par Jaune 2 (Adjudant MONIER) et Jaune 1 (Sous-Lieutenant MIOULET). Arrivée à 100 mètres de l’oued, la compagnie est prise sous un déluge de tirs d’armes lourdes et d’obus de 120 millimètres.
15 minutes après l’engagement, l’Adjudant ALLOUCHE tombe frappé d’éclats de mortiers à la fémorale. Le Sergent-chef RICHOL apporte les premiers soins à son chef de section, évacué au plus vite sur MONGO. L’Adjudant ALLOUCHE décèdera dans l’hélicoptère.
Les Jaguar arrivent, Jaune 2 et 3 parviennent à s’aligner sur la rive sud du BATHA, tandis que Jaune 1 poursuit le combat au nord. Les sections franchissent, tandis que l’ennemi se replie vers le village. Les affrontements durent maintenant depuis 2 heures 30. Les bidons sont vides, il fait 60 degrés.
Jaune 1 parvient à nettoyer la résistance, le Sergent FRANGEUL et le Caporal RAVENTHAL sont blessés. La compagnie s’aligne face à la ville, dans la dernière ligne de végétation. Une bande de sable de 150 mètres sépare les Chats Maigres de l’objectif.
Il est 15 heures 30. « On y va ».
La compagnie monte à l’assaut, entonnant « le Gars Pierre », au coude à coude, les yeux fixés sur la murette qui marque l’entrée de la ville. La murette grossit toujours. Le Caporal LENEPVEU tombe, frappé d’une balle dans la tête. L’assaut continue. L’ennemi se replie. Dans le village les combats continuent, la compagnie progresse pied à pied. En fin de combat, la section MIOULET est à nouveau éprouvée : le Caporal-chef JANONE, le Caporal HUC, les Marsouins LAURENT et MUNOZ sont blessés. Chez Jaune 3, DELEVALLE est grièvement blessé.
Au bilan final, l’ennemi laisse 80 tués, 7 véhicules détruits, 2 bitubes de 14.5 millimètres, un canon de 75 SR, un mortier de 120 , un mortier de 81, 6 mitrailleuses, 2 lance-roquettes RPG7 et 70 kalachnikov AK 47.
D’autres assauts et d’autres combats marqueront l’opération TACAUD, où les marsouins du 3e Régiment d’Infanterie de Marine continueront de s’illustrer. Dans le Ouaddaï, aux ordres du Capitaine LHUILLIER, la 3e compagnie donnera plusieurs fois l’assaut à des positions fortement tenues par l’ennemi.
L’Adjudant Allouche
Mort pour la France le 19 mai 1978 à Ati
le Caporal Lenepveu
Mort pour la France le 19 mai 1978 à Ati
J’avais bien connu l’Adjudant Allouche que l’ennemi a tué dix jours plus tôt, au commandement de sa Section de quarante hommes. Deux ans auparavant nous avions lié connaissance alors que nous faisions, pour des missions individuelles, le trajet Abidjan-Douala dans la soute d’un avion Nord-atlas. Ce vieux modèle d’avion volait relativement bas : Allouche, qui avait déjà fait ce trajet, m’avait montré au passage le Mont Cameroun, ce volcan qui est le plus haut sommet d’Afrique de l’Ouest. Par la suite, j’avais revu Allouche en diverses occasions.
Morts pour la France sur la terre africaine, l’Adjudant Allouche et le Caporal Lenepveu ont été tués par les brigands qui sévissent dans la région et dont je vous ai déjà parlé. Le nom d’Allouche vous indique clairement qu’il n’était pas d’origine vraiment gallo-romaine. Et c’était visible. Mais il a prouvé jusqu’au bout que sa patrie était la France. Il fut inhumé sous le drapeau tricolore, en terre bretonne et accompagné par ses camarades de l’Infanterie de Marine.
L’Infanterie de Marine, ainsi que la Première du Grand Trois qui en fait partie, comptait (et compte encore aujourd’hui, je crois) une forte proportion de gars qui n’ont visiblement aucun ancêtre gaulois. Ils y tiennent leur place si bien que je n’ai jamais décelé le moindre indice de tension raciale dans nos rangs.
Lenepveu fut inhumé à l’île de La Réunion dont il était natif, lui aussi sous le drapeau tricolore et accompagné par ses camarades de l’Infanterie de Marine. Au premier rang de ceux-ci se tenait le Colonel Jean Joubert, ancien Chef de Corps du Grand Trois.
Le Colonel Jean Joubert, tous ceux qui l’ont connu vous diront comme moi que c’est son commandement, de 1975 à 1977, qui fit du 3ème RIMa un régiment d’élite prêt à accomplir avec honneur toute mission de combat qui lui serait confiée. Rendons à César…
Cette pause à Ati, l’ambiance provinciale aidant et parce que le mouvement vers Abéché est lancé, me permet d’avoir d’autres pensées que l’immédiat qui a continuellement exigé des décisions rapides mais cohérentes depuis que le départ s’est précisé. Pourtant mes trois lieutenants secondés par mes dix-sept sous-officiers ont supporté leur part : mes officiers, qu’ils soient frais émoulus de Saint-Cyr (Lieutenants Sauvonnet et Bergerot) ou expérimenté, sorti du rang (Lieutenant Kellermann, surnommé « le Chat Maigre »(1) parce que ça lui fait plaisir et parce qu’il y ressemble : il est d’origine franco-vietnamienne), prennent les initiatives judicieuses qui s’imposent et allègent ainsi d’autant mes préoccupations. La qualité d’une compagnie se fonde sur la qualité de son encadrement : avec un bon encadrement, il suffit que le capitaine ne soit pas trop nul.
A la préfecture d’Ati, le préfet tchadien est absent. Celui-ci s’est enfui au plus vite dix jours plus tôt, animé sûrement par le double souci d’aller personnellement rendre compte de la situation à N’Djaména et de l’impérieuse nécessité, dans l’intérêt du Tchad, de sauver les élites administratives. Il a de l’avenir. Nous en plaisantons.
(1) Au sujet des « Chats Maigres », voir le chapitre 44, à la fin de ce volume.
17. L’escadron Ivanoff
Au moment de notre arrêt d’étape, le détachement français d’Ati est seulement constitué par un escadron de blindés légers de la Légion Etrangère. Après l’accrochage qui a eu lieu dix jours plus tôt, cet escadron a été maintenu sur place pendant que la 3ème compagnie de notre Régiment prenait position à Mongo, autre carrefour de pistes important situé à environ une centaine de kilomètres plus au sud. C’est dire que ce petit escadron de la Légion, certes vaillant et aguerri mais un peu trop léger comme tout notre dispositif depuis le début, s’il devait subir l’attaque d’une de ces bandes supérieures en nombre et fortement armées qui écument le pays, aurait de la difficulté à tenir jusqu’à l’arrivée de la 3ème compagnie.
Mon camarade le Capitaine Ivanoff, une forte personnalité faite d’un alliage de calme et de dynamisme, commande cet escadron de la Légion. C’est un escadron du 1er Régiment Etranger de Cavalerie (1er REC).
Comme beaucoup d’autres unités dites « de cavalerie légère» dans l’armée française à cette époque, l’escadron d’Ivanoff est équipé de ces petits blindés légers auxquels j’ai déjà fait allusion. Il s’agit d’AML90 Panhard que vous connaissez peut-être. De nos jours, un de ces engins retiré du service est exposé pour qui veut le voir en passant au camp de Satory à Versailles. Pour comprendre l’intérêt de ce matériel, il faut d’abord se souvenir qu’à l’époque l’hypothèse officielle pour toute l’armée française, c’était d’arrêter ou de freiner les chars d’assaut soviétiques supposés vouloir débouler sur l’Europe de l’Ouest. Les petits blindés rapides de la « cavalerie légère » semblaient, et étaient probablement, bien adaptés à une forme de combat qui aurait lieu sur notre réseau routier et nos chemins : attaquer à bonne distance les colonnes de chars lourds ennemis en leur faisant subir un maximum de pertes et en échappant à leur riposte.
Ces petits blindés étaient donc armés d’un canon de calibre 90mm pouvant tirer avec précision des obus anti-chars à des distances de 1500m. Ils pouvaient aussi tirer d’autres catégories d’obus. Ils étaient en outre équipés d’une mitrailleuse qui justifiait leur appellation « Auto-Mitrailleuse Légère » AML. Conçues pour être d’une grande agilité sur les routes et chemins d’Europe, les AML roulaient sur pneus. Ceci pour échapper à la riposte des chars ennemis à longue distance en disparaissant dans le paysage aussitôt après qu’elles avaient tiré, revenir ensuite et recommencer. Ces pneus étaient certainement un avantage pour le combat anti-chars à longue portée en Europe, mais devenaient ici un handicap pour un combat rapproché contre une piétaille nombreuse tirant par rafales denses. Les pneus, qualifiés «increvables » parce qu’ils résistaient aux crevaisons ordinaires, ne résistaient pas aux balles et étaient déchiquetés.
Pour le genre de combat qui était mené ici, ces unités de blindés légers sur pneus avaient besoin d’être accompagnées d’infanterie. Quant à nous fantassins qui manquions, comme je vous l’ai dit, de puissance de feu, être accompagnés des canons des AML90 était précieux pour nous. Complémentaires, on était faits pour s’entendre. Nous avions d’ailleurs l’habitude, au Grand Trois (3ème Régiment d’Infanterie de Marine), de nous exercer avec le RICM (Régiment d’Infanterie & Chars de Marine) équipé de ce même modèle de blindés légers.
La coopération entre ma compagnie et l’escadron du REC ne posera donc aucun problème. On peut à ce moment se risquer à le dire pour un futur proche parce que les renseignements que la population nous apporte, aux uns et aux autres, nous font entrevoir qu’Ivanoff et moi, la Légion et l’Infanterie de Marine, nous allons peut-être combattre côte à côte très prochainement. Ce sera en quelque sorte un retour à la tradition, comme en 1900 où notre armée en Afrique était en grande partie constituée par la Légion et « la Coloniale ».
Celle-ci a repris, en 1958 pour cause de décolonisation, son ancien nom « Infanterie de Marine », qui date de 1821 mais que l’on peut faire remonter à Richelieu en 1622. Donc ne vous étonnez pas de voir des unités dites « de Marine » ici à 1500 km de la mer. De même, ne cherchez pas les chevaux dans la « Cavalerie » blindée. Ni les Alpes toujours sous les pieds des Chasseurs dits « alpins ». Et j’arrête ici mes exemples, ne voulant pas par ailleurs, même pour plaisanter, être désagréable avec mes excellents camarades du « Génie ».
En parlant de tradition, je vois qu’Ivanoff s’est laissé pousser une grosse barbe noire. Pour économiser l’eau du rasage, peut-être : je ne lui ai pas demandé d’explication.
Ou alors c’est plutôt par référence à la coutume : dans la Légion la barbe est bien portée. Dans l’Infanterie de Marine, au contraire, elle n’a jamais été à la mode. En revanche, nombreux chez nous sont ceux qui portent volontiers la moustache. Le style, selon le goût de chacun, va du simple trait fin à l’énorme « guidon de vélo » soigneusement entretenu.
Quant à moi, je ne me laisserai pas pousser la barbe. Non que la barbe me déplaise, mais j’ai l’habitude de me voir avec seulement une fine moustache. Je prévois que je vais vivre des semaines qui pourraient être déstabilisantes et je veux, pour antidote, continuer de me reconnaître dans un miroir. Je ne veux pas risquer de perdre l’un de mes principaux repères qui est l’image habituelle que j’ai de moi-même dans les bons et dans les mauvais moments. Avec la même intention, j’ai apporté dans mes bagages quelques petits livres au format poche que j’ai déjà lus, pour les relire et garder mes repères.
18. Un renseignement population
Acheter des vivres frais. Les rations de l’intendance que nous avons apportées dans nos bagages commencent à peser sur les estomacs et depuis le temps que nous sommes à ce régime, nous allons finir par manquer de vitamines. D’ailleurs, si nous continuons à consommer ces rations à tous les repas, nous serons bientôt à court. Sans savoir quand nous serons réapprovisionnés.
J’envoie le Sergent-chef Jambon faire le marché, accompagné d’une petite équipe qui portera les achats. Discrètement armés, mais je ne crains guère qu’ils soient agressés, ce n’est pas l’ambiance. J’ai même l’impression que notre présence est perçue comme rassurante, impression partagée par tous ceux des miens qui ont déjà une expérience du Sahel. Et l’on ne pousse pas la discipline jusqu’à donner automatiquement raison au capitaine quand il vous demande votre avis.
J’ai précisé au Sergent-chef Jambon : « n’oubliez pas de marchander ». Il m’a regardé d’un air attristé par l’inutilité d’une telle recommandation : « évidemment, Mon capitaine. »
Marchander présente ici au moins trois avantages. Non pas tellement de nous faire économiser de l’argent, car les prix sont déjà dramatiquement bas et nous ne sommes pas radins à ce point. Mais marchander est d’abord une politesse : sinon le vendeur regrette de n’avoir pas demandé plus cher et considère l’acheteur comme un grossier personnage. Ensuite, si nous ne marchandons pas nous allons faire monter les prix et perturber le commerce local aux dépens des plus pauvres ; attention aux effets secondaires de notre présence qui doit rester autant que possible un remède sans trop d’inconvénients. Enfin, marchander permet d’engager la conversation.
C’est ainsi que le Sergent-chef Jambon revient non seulement avec les provisions voulues mais avec « par-dessus le marché » un renseignement utile dont les hommes d’Ivanoff ont aussi entendu parler de leur côté : une bande importante est installée à une quarantaine de km au nord, dans un bled qui s’appelle Njédaa où elle attend notre départ pour s’emparer d’Ati, qui pourrait être une nouvelle étape vers N’Djaména.
Compte-rendu immédiat au colonel. Pour en savoir plus, nous irons demain en patrouilles ratisser le secteur entre ici et Njédaa pour chercher des indices matériels et interroger les bergers nomades que nous rencontrerons, ou des villageois s’il y a des villages. Car ne croyez pas que ce semi-désert sahélien est complètement inhabité : au contraire vous y rencontrez facilement les gens qui veulent vous rencontrer. D’autant que toute la région sait maintenant que les Frani sont ici, et qu’ils y sont en force.
Du fait que nous ne savons pas quels méchants peuvent nous tomber dessus ni combien, les patrouilles seront constituées d’éléments suffisamment costauds pour pouvoir combattre afin de se dégager ou, au moins, tenir jusqu’à l’arrivée de renforts. Deux patrouilles suffiront, chacune composée d’une section d’infanterie et d’un peloton blindé groupés sous l’autorité d’un capitaine (Ivanoff et moi, chacun de son côté). On peut le dire autrement : deux capitaines, solidement escortés, chercheront du renseignement.
Je « prête » à Ivanoff la section du Lieutenant Bergerot et il me « prête » le peloton de quatre AML du Lieutenant Paradès. Je ne connais pas ce lieutenant, mais la bonne coordination est immédiate parce que nous sortons tous des mêmes écoles, avec les mêmes procédés d’action. Nous « parlons tous le même langage ».
Ivanoff et moi nous partageons les secteurs de patrouille, situés à mi-chemin entre Ati et Njédaa. Inutile d’approcher trop cette bande : pour l’instant le but n’est pas de combattre mais de compléter notre information. Paradès connaît le secteur, il sait où nous emmener, il roulera devant, Sauvonnet et moi nous suivrons jusqu’au secteur de patrouille.
A demain.
19. Oui, et qu’Allah protège les Frani
Nous sommes en piste au petit lever du soleil sans attendre qu’il chauffe.
Je profite maintenant de ce trajet pour vous parler un peu du Caporal Lécuyer qui conduit ma jeep (pour vous en parler ici, j’ai changé son nom, vous allez comprendre pourquoi). Conduire et entretenir la jeep du capitaine est une de ses fonctions depuis qu’il est revenu de son stage de conduite après le Gabon. Il est aussi et surtout le comptable de la compagnie. Pas de problème comme comptable, mais comme conducteur il confond sa droite et sa gauche. J’ai en ce comptable une confiance totale, parce que jamais un centime n’a disparu. Ce qui ne m’empêche pas de vérifier, ne serait-ce que par principe et parce qu’il ne comprendrait pas que je ne vérifie pas : il croirait que son travail m’indiffère.
Pourtant, après le retour en France, j’ai eu une surprise : les gendarmes sont venus me voir à son sujet. Il était recherché pour un vol de mobylette, ou je ne sais quoi, quand il était ado. J’ai demandé aux gendarmes de laisser tomber, je leur ai dit pourquoi, ils ont compris et le proc a été d’accord.
Revenons à notre patrouille. Paradès nous a emmenés sur un terrain qui serait favorable à un bivouac d’étape, pour les brigands comme pour nous ou pour quiconque, car cet endroit est parsemé d’arbres et de buissons sur un sol mollement vallonné. Toutefois l’absence de puits, sur ma carte comme en réalité, fait que ce coin ne serait pas favorable à une installation de longue durée. C’est d’ailleurs pourquoi aucun village ne s’y trouve.
Les quatre AML blindées du Lieutenant Paradès et les quarante hommes du Lieutenant Sauvonnet « ratissent » maintenant le terrain, à la recherche de tout indice (traces de bivouac, munitions ou pièces d’équipement) qui pourrait nous renseigner sur la présence, le nombre, le matériel des brigands dont on nous a parlé. J’ai prescrit au Caporal Lécuyer de rouler lentement en restant au centre du large dispositif formé par Sauvonnet et Paradès. Le hasard nous amène ainsi à passer au bord d’un creux du terrain, une cuvette naturelle d’environ deux ou trois mètres de profondeur sur cent mètres de diamètre. Un arbre nous offre son ombre, je dis à Lécuyer de s’arrêter sous cet arbre. J’observe les environs. Je vois, à une quarantaine de mètres de moi, un homme que je n’avais d’abord pas vu dans l’ombre d’un autre arbre. Il est immobile, debout dans le creux du terrain qui le met à l’abri des regards. Entouré de quelques chèvres, c’est évidemment un berger. Il a certainement entendu depuis longtemps approcher le bruit de nos moteurs et il nous attendait.
D’un geste très discret, il me fait signe de venir vers lui. Je n’ai pas l’impression qu’il veuille me vendre une chèvre, car dans ce cas il serait venu vers moi avec une chèvre, ou plusieurs pour que je choisisse. Je crois plutôt qu’il veut me parler sans être vu.
Je descends de la jeep, laissant Lécuyer et Félix (mon radio) sur place pour surveiller les environs. Ce qu’ils font donc, l’arme à la main en balayant du regard la totalité du secteur avec la tranquillité et l’attention des vieux briscards qu’ils sont déjà à vingt ans et vingt-cinq ans : pour le Caporal Lécuyer, deux petites années d’ancienneté qui l’ont fait passer par la lande bretonne, puis par une manœuvre à moins15° dans les neiges de l’hiver ardennais, quatre mois dans le désert de Djibouti et quatre mois dans la forêt équatoriale gabonaise, enfin le stage de conduite au retour du Gabon ; pour le Sergent Félix, avec sept ans d’ancienneté, insérez en plus dans l’énumération ci-dessus un an de stage des sous-officiers (ce qui correspond à « cadre B» de la fonction publique), le stage de radio graphiste, plus un séjour de deux ans outre-mer, aux Nouvelles-Hébrides je crois. Les voyages et les stages militaires forment la jeunesse, je suis sous bonne garde.
Je m’approche du berger. A l’ombre sous l’arbre, je remarque maintenant son campement que je n’avais pas vu parmi les buissons. C’est une sorte de tente basse faite de plusieurs épaisses toiles jaunâtres soutenues par quelques bâtons. Les toiles me paraissent faites avec des fibres qui ressemblent à celles que nos jardiniers utilisent pour ligaturer leurs greffes, du raphia : les fibres sont tressées et les tresses sont ensuite tissées, entrecroisées. J’ai observé ces détails, bien qu’ils me soient totalement inutiles, d’un coup d’œil rapide et presque involontaire. Aussitôt j’en déduis que mon attention est en éveil, bon signe.
Je ne suis pas ici pour m’improviser ethnologue, mais écouter ce berger qui veut me parler. Jamais l’expression « nous ne sommes pas du même monde » ne m’a semblée plus adéquate. Pourtant j’ai l’impression paradoxale que nous nous ressemblons beaucoup, lui et moi : lui qui n’a probablement jamais rien vu d’autre que son Sahel semi-désertique et moi qui n’ai jamais longtemps quitté ma civilisation européenne où tout est sophistiqué, y compris nos blondes. Peut-être parce que son attitude, sans soumission ni hauteur, fait de nous des égaux.
Ce n’est pas non plus le moment de faire de l’analyse psychosociologique, je réfléchirai plus tard à l’étrange paradoxe que représente ce berger sahélien qui est maintenant devant moi.
Il est francophone, comme tout le monde dans ce pays. Voici l’essentiel du dialogue, que je traduis ici en français de chez nous. « Tu cherches les frolinat. Ils sont à Njédaa.
—-Oui, on me l’a dit. Je voudrais savoir s’ils sont beaucoup, s’ils sont tous armés et où ils sont exactement.
—-Oui, beaucoup. Tous armés.»
Il s’accroupit, j’en fais autant. Avec un petit bâton, il trace sur le sol un dessin rudimentaire.
« Ici, la ville avec des maisons (il trace des carrés) : pas beaucoup de maisons. Ici le village (il trace des ronds) : beaucoup de maisons, mais petites. Ici, le puits (il pointe son bâton sur le sol, entre les ronds et les carrés). Ici dans les maisons (carrées), ils sont beaucoup. »
Il pose un instant son bâton, plie et déplie les doigts de ses deux mains plusieurs fois. J’ai cru compter neuf ou dix. Une petite centaine. Oui, c’est déjà beaucoup.
« Pas de frolinat ici (les petites maisons rondes). Ici (les maisons carrées), ils sont toujours au puits et portent de l’eau à ceux qui sont dans les palmiers. Ici (frottement du bâton sur le sol, à quelque distance des maisons carrées.) »
Allons bon, il y en a encore dans une palmeraie. Il me faut évaluer leur effectif :
« Combien dans la palmeraie ?
—- Je n’ai pas vu. Mais ils prennent beaucoup d’eau. (Il déplie deux et trois doigts en montrant de son bâton les maisons carrées.) Comme ça peut-être. »
Deux cents à trois cents. Aïe.
Avec son bâton, il complète son schéma :
« Le soleil se lève de ce côté. »
Cet homme n’est pas un imbécile : il m’a dessiné les lieux comme les voit un oiseau et il a pensé à orienter son schéma. «Orienter » au vrai sens du mot : vers l’est, parce que le nord n’est pas une direction de référence pour lui qui vit dehors et voit un soleil se lever chaque matin. Le nord est une invention de nos géographes coperniciens qui savent que c’est la terre qui tourne et non pas le soleil. Un autre univers.
Je crois qu’il m’a tout dit, mais il ajoute : « Ils m’ont volé des bêtes, beaucoup ». Ca m’explique pourquoi il voulait me parler. Je réponds posément, mais peut-être un peu trop sûr de moi : « Nous tuerons les voleurs frolinat : ils ne voleront plus personne ». C’était ce qu’il voulait m’entendre dire. Il sait sûrement déjà que nous sommes arrivés en force à Ati.
« Oui, et qu’Allah protège les Frani ».
Sa bénédiction en cadeau-bonus.
Je remonte vers la jeep. Je prends un papier et un crayon, et avant d’oublier je recopie le schéma tracé sur le sol par le berger. On appelle ça un « renseignement-terrain ».
Félix et Lécuyer sont souriants : à me voir détendu, ils ont compris que la pêche est bonne. Je parie qu’au retour, toute la compagnie le saura rapidement.
Je dis à Lécuyer d’avancer la jeep sur cinquante mètres, lentement.
Me voyant bouger, Paradès approche ses AML et Sauvonnet fait rembarquer ses gars dans les véhicules.
Je leur fait signe « terminé, on rentre ». Inutile d’utiliser la radio quand on peut faire autrement.
Je n’ai plus qu’à me laisser conduire jusqu’à Ati, dans le sillage de Paradès et suivi de Sauvonnet, pour rendre compte au colonel. Vingt kilomètres. Pour moi vingt ou trente minutes de pause pour réfléchir.
Laissant mon escorte et mon conducteur se débrouiller pour me ramener, inutile que j’intervienne pour ça, je m’explique peu à peu le lien presque familial que j’ai ressenti avec ce berger d’un autre monde. Sa dignité et sa pauvreté me rappellent celles de quelqu’un que j’ai connu quand j’étais gamin : un grand-oncle que nous allions visiter de temps en temps, au fond de la Bretagne. C’était dans les années cinquante. Il vivait dans une chaumière isolée, sans électricité ni adduction d’eau. Il portait ses seaux pour aller chercher l’eau à la source. Chauffage et éclairage au bois dans la cheminée en feu continu, et l’un de ces fameux lits-clos qui font maintenant le bonheur des antiquaires. Fier propriétaire d’un vieux cheval de trait, de quelques volailles, d’un pommier et d’un potager, il complétait l’ordinaire par un peu de braconnage, de châtaignes et de champignons de la forêt voisine qui lui fournissait aussi son bois. Pauvre mais digne : lisez ou remémorez-vous le livre « le Cheval d’Orgueil » de Pierre-Jakès Hélias et vous comprendrez ce que je veux dire. J’ai retrouvé la même qualité humaine dans l’âme de ce berger sahélien qui m’a donné sa bénédiction.
Ces gens-là sont valables, au Tchad comme certainement dans les pays voisins. Ils n’ont besoin que de sécurité : donnons-leur la sécurité et ils feront le reste, élevage, agriculture, artisanat, commerce. L’on ne fait rien si l’on sait que l’on sera dépossédé des résultats de son travail. Mes réminiscences d’Histoire de France me disent que la situation d’insécurité était la même chez nous il y a peu de siècles, jusqu’à ce qu’un roi ( je crois me souvenir que c’était Louis XIV) décide d’en finir avec les bandits de grand chemin. Par la force des armes. Les périodes de prospérité ont toujours été d’abord fondées sur la sécurité.
On peut parler d’aider l’Afrique par un « nouveau plan Marshall pour l’Afrique », pourquoi pas. Mais aidons les Africains en leur donnant pour commencer la sécurité, car nous en sommes capables si nous faisons l’effort de ne pas trop écouter les mauvais intérêts qui s’y opposent sous couvert d’idéologie. Et ne confions pas cette mission à n’importe qui, remède pire que le mal.
En cette fin mai 1978, un berger sahélien a confirmé ma motivation.
Au Tchad, en cette fin mai et ce début juin 1978, la situation a changé pour quelques mois. « C’est déjà ça », dirait Alain Souchon.
En rentrant à Ati après cette fructueuse patrouille, je vais directement voir le colonel. Il s’est installé dans la Préfecture devenue disponible. N’imaginez pas que cette préfecture ressemble aux palais administratifs de chez nous. Ici, il s’agit d’une maison aux fenêtres vides, un peu plus grande et plus ouvragée que les autres. Cependant elle est entourée d’un parc, agréable à regarder peut-être à la saison des pluies. Pour le moment, après une dizaine de mois sans eau, les parterres sont seulement figurés par des alignements de cailloux blancs qui forment des figures géométriques. Jardin à la française, mais sans eau, variante sahélienne.
Le parc est entouré de murettes qui le séparent de la voie publique. La confidentialité des réunions n’est donc pas garantie. C’est de la transparence administrative, en quelque sorte.
Ce mode de fonctionnement n’a pas échappé au colonel et il a l’intention d’en jouer. Nos réunions présenteront toutes les apparences de la confidentialité mais de fait nous serons en représentation, il ne faudra pas l’oublier tout en jouant le jeu : des oreilles indiscrètes nous écouteront et pourront nous être utiles, il suffira de le savoir mais de ne pas en avoir l’air.
Au retour de patrouille je me présente à mon chef et je n’ai pas besoin de faire d’effort pour sembler content des informations que je rapporte. Je donne mon croquis au colonel et lui raconte tout ce que vous savez déjà, sans oublier en finale ma promesse au berger suivie de sa bénédiction.
Je retourne auprès de ma compagnie, toute proche : j’ai installé la section dite « de commandement » dans une zone ombragée juste derrière la préfecture.
La section de commandement, je vous le précise si vous ne le savez pas, est un ensemble disparate mais indispensable placé sous les ordres d’un adjudant. Celui-ci se nomme Musselin : au Gabon, il courrait ses dix kilomètres tous les matins sur la plage ; ici la plage est grande mais il manque l’air de la mer ; par ailleurs il est passionné de rallyes automobiles ; avaler les kilomètres, à pied ou sur roues, c’est son passe-temps favori.
La section de commandement est composée de dix-huit hommes aux spécialités diverses : l’équipe du Sergent Ben Chemak avec plusieurs mécaniciens qui sont aussi les conducteurs des camions de matériel ; l’infirmier de la compagnie (Caporal Tagliamento, surnommé « Tagli », antillais fin et humoriste ; j’ai vu Tagli, au Gabon, faire ses preuves de secouriste avec 15 blessés dans un accident routier de taxi-brousse à côté de notre bivouac : 15 blessés dans un véhicule 9 places, et il y avait encore des passagers indemnes, ceux qui avaient pu sauter en marche et criaient le plus fort) ; le comptable qui est aussi mon conducteur (Caporal Lécuyer) ; l’équipe du Sergent Félix avec des radiographistes pour les liaisons à longue portée en morse (le téléphone par satellite n’existe pas à cette époque) ; l’armurier et ses deux assistants qui sont aussi conducteurs et un peu cuisiniers : le caporal Dumontant, surnommé « Pondiche » parce qu’il est originaire de Pondichéry, et le caporal Rajaonarivelo, dit « Radja », de Madagascar. Radja est doué d’une acuité visuelle extraordinaire : au Gabon, dans la savane, il apercevait à l’œil nu des détails que des yeux normaux ne pouvaient distinguer qu’avec des jumelles.
C’est évidemment dans cette section que j’ai placé le Sergent-chef Jambon, à qui j’ai confié depuis N’Djaména les deux mortiers de 60 dont nos amis nous ont fait cadeau.
Spontanément à N’Djaména l’armurier, le Sergent Mouillerat, s’est proposé pour seconder Jambon dans l’utilisation des mortiers en plus de son travail d’armurier. Mouillerat est un petit Auvergnat chargé de comptabiliser continuellement les armes et les munitions de l’ensemble de la compagnie. J’ai bien fait de le choisir pour ce travail auquel il applique ce qui est, paraît-il, une caractéristique des Auvergnats : méticuleux, un sou c’est un sou. Pendant toute cette opération dont nous ignorons encore la durée pour nous (ce sera quatre mois, nous serons relevés en septembre), je saurai à tout moment, grâce à Mouillerat, où se trouve telle ou telle arme qui était détenue par tel ou tel soldat rapatrié sanitaire (il y aura plusieurs rapatriements sanitaires) : quand je poserai la question, Mouillerat compulsera un carnet sorti de sa poche, trouvera l’emballage où est stockée l’arme correctement huilée, vérifiera la correspondance entre le nom du soldat et le numéro de l’arme : «la voici, Mon capitaine, avec ses quatre chargeurs et sa trousse d’entretien, qui est complète j’ai vérifié ; les munitions sont à part, il manque trente-trois cartouches que j’ai redistribuées à Untel ». Je n’ai aucune inquiétude pour la comptabilisation de mes armes et munitions. De plus je sais que mes deux mortiers et leurs obus sont en de bonnes mains.
Quand je rejoins les gars de « la commandement » qui sont installés derrière la préfecture, ils sont en train de s’occuper de l’entretien du matériel : nous nous sommes arrêtés à Ati pour ça, parce que « qui veut voyager loin… ». Deux d’entre eux ont allumé un petit feu de bois sur lequel ils font bouillir de l’eau pour tout le monde. C’est une habitude quand nous sommes sur le terrain en Afrique, nous faisons bouillir de l’eau à chaque fois que nous en avons l’occasion, pour la stériliser avant de la boire : c’est une précaution qui n’est pas infaillible, mais c’est mieux que rien, pour éviter bien des chiasses qui sont désagréables et surtout déshydratent celui qui en est atteint.
Si l’Intendance avait pu nous livrer régulièrement de l’eau propre dans des bidons, ou une quantité suffisante de pastilles de purification, cela nous aurait évité beaucoup des problèmes de santé qui firent diminuer à la longue l’aptitude opérationnelle de toutes nos unités : de nombreuses hépatites virales notamment. Le virus de l’hépatite résiste à 100°, il nous aurait fallu des marmites à pression.
L’une des caractéristiques de cette intervention au Tchad en 1978, ce fut l’insuffisance de la logistique : nourriture (notamment eau potable, légumes et fruits), prévention et soins de santé, matériel et même munitions.
Aujourd’hui en 2007 je crois inutile de m’appesantir sur ce problème de logistique parce que les temps ont changé. A l’époque de l’opération tacaud l’attention de l’armée française, comme je vous l’ai dit, était uniquement tournée vers l’Europe de l’Est. L’outre-mer n’intéressait pas les services logistiques. Au contraire aujourd’hui, ce qu’on appelle désormais « les forces de projection » et les « opex » (opérations extérieures) sont une partie non négligeable, et sûrement non négligée, du dispositif militaire français. J’ai entendu dire que déjà pour l’opération manta, en 1983, la situation était meilleure.
Toutefois nous avons développé à l’époque de tacaud, et j’espère légué à nos jeunes, une capacité d’adaptation aux circonstances qu’il serait regrettable de perdre, comme par exemple l’habitude de stériliser l’eau par dix minutes d’ébullition, ou la réparation d’un carburateur en le tenant en place par du fil de fer, la protection des armes contre le sable, celle des peaux et des yeux contre le sable et le soleil, le renseignement obtenu à l’occasion des achats sur le marché et en toutes occasions, la tête nue « quand ça commence à péter », d’autres trucs du métier que vous trouverez deci-delà dans cette histoire et que vous retiendrez si vous voulez. Les solutions opérationnelles ne sont pas toutes dans les règlements ni dans une logistique de club de vacances.
Après avoir tout dit au colonel, j’ai rejoint la section de commandement de ma compagnie. Je m’accorde une pause : je m’assois au sol, à l’ombre, le dos contre une roue de la jeep en buvant un peu d’eau.
J’écoute l’ambiance. Pas de problème, mes gars ne sont ni tendus ni angoissés : même dans les travaux les plus simples, il y a plusieurs façons de demander un tournevis ou un chiffon, et j’ai l’oreille suffisamment « musicale » pour déceler les tensions contenues dans les voix. Ici, je ne décèle aucune tension. Il est vrai que tous ces gars sont engagés volontaires dans l’Infanterie de Marine et que chacun, comme moi, trouve normal d’être ici et de faire ce qu’il fait.
« Voulez-vous un morceau de chèvre, Mon capitaine ? » me demande le Caporal Lecuyer (vous savez : mon comptable-conducteur) qui s’est approché avec à la main une assiette et une fourchette. (Mais où ont-ils donc trouvé du fromage de chèvre ? ). Et je comprends : il me propose un morceau de viande de chèvre qu’ils viennent de griller sur le feu. Volontiers, merci. D’autant que mon ptidéj’ s’est limité à deux biscuits des rations de l’Intendance trempés dans de l’eau chaude améliorée par un peu de café soluble et un sucre. Je mange donc mon « morceau de chèvre » en étant assis par terre, le dos contre la roue de la jeep, l’assiette sur les genoux, en coupant la viande avec le canif que j’ai toujours sur moi (un opinel n°8, celui qui est équipé d’une virole pour bloquer la lame en position ouverte : parce que je suis un gars prudent, vous voyez ).
Cette histoire de fromage de chèvre imaginaire, et la vie routinière qu’il évoque, me fait faire un bref voyage, instantané, dans le temps et dans l’espace : où sont donc en ce moment mes copains et copines du lycée de Brest, avant qu’un bachot avec mention me permette d’entrer en prépa-cyr au Prytanée ? Ils et elles sont allé(e)s à l’Université, on leur a distribué des diplômes qui n’intéressent aucun employeur sauf l’Etat (il ne peut pas renier les diplômes délivrés par ses propres professeurs, bien entendu) et ils sont devenus fonctionnaires. Etre ou ne pas être, telle est la question à laquelle chacun doit répondre vers dix-huit ans. Peut-être sont-ils heureux, mais pas autant que moi en ce moment et sûrement pas de la même façon.
Je pense à « Terre des Hommes », de Saint-Exupéry. Dans son omnibus, il y a ceux qui vont au bureau comme tous les jours, comme ils l’ont fait la veille et comme il le feront encore le lendemain et encore tous les jours, et il y a celui qui va s’envoler pour le Sahara occidental par-dessus les montagnes d’Espagne au prix de quelques risques qui, au passage, affûteront ses qualités. Dans l’omnibus de St-Ex, j’ai pris le bon ticket. En mai68, je passais le concours de Saint-Cyr.
Pour franchir mes propres montagnes.
Je termine mon « morceau de chèvre » quand arrive mon camarade le Capitaine Maudet. Il constitue, avec le Capitaine Kersaho, le petit état-major du colonel.
Maudet est un gars grand et longiligne qui me dépasse de plus d’une tête quand je suis debout. Je suis assis par terre, il a la politesse de s’accroupir pour me parler. Il est souriant, les nouvelles sont bonnes je suppose. Il me dit : « Réunion des capitaines avec le colonel dans une heure.
—-Dans une heure, OK. Pour parler de quoi ? »
D’une grimace, il me fait comprendre qu’il ne peut pas se permettre de m’en dire plus. Il ajoute cependant, avec un sourire entendu : « ça va te plaire, tu verras ! Je crois que ça va te plaire ! ».
2. Choc
21. Briefing
Une heure plus tard, les capitaines sont autour du colonel dans le « parc de la préfecture ».
La confidentialité de la réunion est plus qu’incertaine. Nous pouvons même être sûrs que nos paroles seront répétées. Mais nous faisons mine, tous, de ne pas savoir qu’on nous écoute. Lorsque pour les oreilles indiscrètes nous voulons souligner l’importance d’une information, il suffit de baisser un peu le ton. En fait, rien n’est confidentiel dans ce que nous disons, cette mise en scène fait partie des « trucs » du colonel qui sait très bien que dans une heure les malfaiteurs à Njédaa seront informés de nos projets.
Je vous explique le truc, car vous ne pouvez pas deviner. Pour deviner il vous manque l’information-clef qui nous oblige à agir ainsi : lorsque nous rencontrerons les prétendus « rebelles » (en fait, le mot rebelle est politique et donc abusif, ils ne sont que de vulgaires bandits de grands chemins, vous le savez maintenant que vous êtes à cet endroit de votre lecture), lorsque nous rencontrerons ces « rebelles » que notre gouvernement nous a chargés de désarmer, les directives politico-politiciennes nous interdisent de tirer les premiers. Comme à la bataille de Fontenoy : « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Ici et deux siècles et demi plus tard, nous n’avons pas l’autorisation de tirer, excepté « pour nous défendre ».
Mais en même temps la mission c’est « désarmez les rebelles ! ». Vous comprenez que nous ne pouvons pas aller saluer ces malfaiteurs en leur disant doucement : « Cher Monsieur, au nom du gouvernement français, et en vertu des accords de coopération franco-tchadiens, je vous prie d’avoir l’extrême obligeance de bien vouloir me donner votre arme. Celle-ci vous est confisquée. » Si nous agissons comme ça, ils ne vont pas être d’accord.
Alors pour accomplir notre mission de désarmement, nous devrons probablement employer la force des armes, mais problème : comment employer la force des armes avec l’interdiction de l’employer autrement que « pour nous défendre » ? Solution : en ne laissant que deux possibilités aux frolinat : soit ils font reddition sans tirer, soit ils tirent les premiers mais ils nous loupent. Il faut donc leur « mettre la pression » et c’est ce que nous faisons maintenant avec nos préparatifs faussement secrets.
Le colonel expose la situation pour tous mais, chère lectrice, cher lecteur, vous me permettrez de ne pas vous la répéter inutilement : vous la connaissez déjà, du fait que vous étiez avec moi pour écouter le berger.
Le colonel continue : « Par conséquent, nous attaquerons demain matin.»
(Maudet m’avait bien dit « ça va te plaire, tu verras »).
« Quand je dis ‘nous attaquerons’, ce n’est pas le mot exact : je veux dire ‘nous irons à Njédaa désarmer ces rebelles’, en leur laissant une dernière chance de lâcher leurs armes et lever les bras s’ils le veulent. Le général est d’accord, compte tenu de la menace grave que cette bande représente pour la ville-préfecture d’Ati après notre départ. Je suppose qu’il a l’assentiment de Paris, mais ceci n’est pas de mon ressort.
Voici comment nous allons faire. Nous nous emparerons d’abord de Njédaa-ville (les maisons carrées sur ce croquis) puis, selon la nouvelle situation et les nouveaux renseignements à ce moment, nous prendrons le contrôle de la palmeraie par sa lisière nord qui fait face à Njédaa-ville, et nous tiendrons simultanément sa lisière sud.
Répartition des missions : demain matin avant le départ, Ivanoff et Cadiou échangeront une section et un peloton, de façon à panacher l’infanterie et les blindés. Au lever du jour, l’Escadron et la Première quitteront Ati en direction du nord, avec moi. Aussitôt après, la batterie de105 ira se mettre en position à portée de tir de Njédaa, soit un peu moins de dix km au sud-ouest de l’objectif. La batterie détachera un officier-observateur (l’officier observateur est en première ligne avec l’infanterie, en liaison radio avec la batterie, pour faire le réglage des tirs d’artillerie.) auprès d’Ivanoff, et un autre auprès de Cadiou.
Au lever du jour au moment où nous quitterons Ati, la 3ème compagnie quant à elle quittera Mongo pour venir prendre position, un peu après notre attaque initiale, au sud de la palmeraie, pour intercepter tout individu porteur d’une arme. Quand nous attaquerons la palmeraie par le nord, l’ennemi va essayer de filer par un autre côté. Il s’agit d’empêcher cette bande de se reconstituer plus tard : il faut que cette bande laisse toutes ses armes sur le terrain, que les survivants n’aient pas envie de recommencer et que personne ensuite ne veuille les imiter. Seuls les individus sans arme auront la vie sauve et pourront aller raconter ce qui est arrivé.
Au départ d’Ati demain matin, l’Escadron (Ivanoff) et la Première (Cadiou) rouleront vers le nord, en colonne, jusqu’à un point situé à environ 4km à l’ouest de Njédaa. Là, tous les véhicules font un quart de tour à droite, ce qui fait que nous nous retrouvons en ligne, les uns à côté des autres avec 30 à 50 mètres de distance entre les véhicules et face à Njédaa à 4km. Vitesse maximum direction Njédaa.
Les habitants, comme d’ailleurs les frolinat, sauront dès ce soir ce qui se prépare pour demain : cette information permettra aux habitants de s’éloigner par prudence. Et aux frolinat de commencer à réfléchir à leur avenir, car ils n’ont pas l’habitude que nous prenions l’initiative. Clair pour tout le monde ?
—- On sera face au soleil, alors ? »
Je ne sais plus qui a posé cette question. Ce pourrait être n’importe lequel d’entre nous car nous savons tous qu’il est préférable d’être dos au soleil pour mieux voir sa cible. C’est le B-A BA. Seuls les cancres ne le savent pas encore, comme par exemple John Wayne, ce tartarin monumental. Mais il est gentil quand-même, ce pauvre John Wayne. Rigolade. Pour nous, presque tous les « films de guerre », quels qu’en soient les auteurs (exceptés Schoendoerffer et Kubrick, bien entendu), sont un inépuisable sujet de moquerie. Pour les oreilles qui nous écoutent, faire entendre notre décontraction n’est pas mauvais.
Le colonel confirme : « Oui, face au soleil, pour qu’ils nous voient mieux venir. »
Cette nuit beaucoup de ces malfaiteurs dormiront mal : depuis le début de la crise c’est la première fois que les Frani viennent sans que ce soit pour réagir à une attaque du frolinat, c’est nouveau et inquiétant. Cette nuit chez les brigands, il y aura sûrement des désertions. Tant mieux : ils seront moins nombreux, et ceux qui voudraient encore abuser de la kalachnikov auront bien cherché ce qui leur arrivera.
Ivanoff et moi nous mettons d’accord : il me prêtera le peloton du Lieutenant Paradès, avec qui j’ai travaillé ce matin, et je lui prêterai cette fois la section du Lieutenant Sauvonnet alors qu’aujourd’hui je lui avais prêté la section du Lieutenant Bergerot. J’alterne parce que je veux que mes deux jeunes lieutenants, dans leurs futurs souvenirs et leur curriculum, aient l’un et l’autre une expérience de coopération avec la Légion. Ivanoff est d’accord, car il connaît ces deux jeunes aussi bien l’un que l’autre : ils sont de la même promo de Saint-Cyr et Ivanoff y était leur instructeur.
Le colonel sait que pour beaucoup d’entre nous, si les frolinat choisissent l’affrontement, ce sera le baptême du feu. Certains peuvent être un peu inquiets. Pas de honte à cela, c’est arrivé à des plus grands : tu trembles, carcasse, disait Turenne.
Le colonel me dit : « Entre quelqu’un qui n’a jamais connu le feu et quelqu’un qui connaît déjà le feu, la différence est de trente secondes.
—- Trente secondes ?
—- C’est le temps qu’il faut pour comprendre que ça se passe comme vous l’aviez imaginé : vous verrez. »
J’ai vu : c’est exact.
Et à ce point de mon récit, je vais peut-être vous étonner : pour ma part je n’avais pas peur, je m’en souviens parfaitement trente ans plus tard, à l’idée d’un affrontement armé qui serait pourtant le premier pour moi. Etonnant, ce calme, et c’est sûrement parce qu’il était étonnant que je m’en souviens si nettement.
J’avais peur seulement au deuxième degré : de perdre mon self-control sous la pression des événements et d’une situation qui pourrait être plus angoissante que prévu : et par conséquent de prendre de mauvaises décisions dont mes gars pourraient être victimes. Peur d’avoir peur.
A part ça, aussi tranquille que possible grâce à l’idée que j’étais passé par les meilleures Ecoles et à travers les filtres les plus sélectifs. Il ne me manquait qu’une brève vérification : elle se ferait en trente secondes, disait le colonel.
Maintenant, ce n’est pas tout pour cet après-midi, j’ai encore du boulot : organiser les moyens pour partir à l’aube sans cafouillage, mettre «dans le coup» mes chefs de section (je ne commande pas directement 137 hommes, mais 4 chefs de section qui commandent chacun 4 chefs de groupe) pour leur faire connaître autant que possible non seulement le schéma d’ensemble de l’action à laquelle ils vont participer, mais aussi leur transmettre ma confiance, sans en rajouter. Je raconte l’histoire des trente secondes, parce que la séance de demain sera aussi une nouveauté pour la plupart d’entre eux. Sincèrement, je ne suis pas angoissé (pourvu que ça dure). Je crois que c’est contagieux, d’autant qu’eux aussi sont passés par des sélections et des formations sérieuses. Ma confiance vient aussi de la confiance que j’ai en eux.
On utilise le reste de la journée à compléter les réservoirs des quelques véhicules qui ont roulé depuis l’arrivée à Ati et alléger les chargements : une grosse partie du matériel et les camions lourds resteront à Ati, on les récupérera ensuite, avant de reprendre la piste pour Abéché. Je ne nous vois pas attaquer, par exemple, en traînant une cuisinière roulante. Je ne suis pas opposé à un peu d’humour, mais là ce serait vraiment … déplacé.
Une équipe de seulement quatre hommes restera ici pour assurer la garde du matériel, un caporal-chef ancien étant chef d’équipe. Un peu inquiet quand-même, l’ancien[1], car il ne comprend pas que c’est une planque : «s’ils nous attaquent, on pourra pas faire grand chose.» Il a raison, mais toute ma compagnie elle-même serait un peu légère : dix jours avant notre arrivée, une autre compagnie de chez nous plus l’escadron du REC, c’était déjà léger. Alors je fais l’impasse, je ne peux pas faire autrement. Je dis : « ils ne vous attaqueront pas, ils seront trop occupés avec nous. Vous restez ici pour éviter les chapardages qui se produiraient si on laissait tout ce matériel sans surveillance».
« Ouais… » Il n’est pas convaincu, mais il devine quand-même que je n’ai pas d’autre solution.
Le Caporal Lebon tient une conversation sérieuse et animée avec le Caporal Papéétoha, sous un arbre, autour d’une caisse de cartouches.
La plupart des gars de la Première sont caporaux : après un ou deux ans d’ancienneté de service, c’est le moyen que nous avons trouvé pour augmenter un peu leur solde, qui reste selon moi excessivement modique au regard de leurs qualités.
Le Caporal Lebon, j’aurai encore l’occasion de vous parler de lui dans cette histoire. Il est « tireur de précision », équipé de l’un de ces excellents fusils à lunette FRF1 dont il prend grand soin. Un « tireur d’élite » si vous préférez le désigner comme ça.
Lebon a juste un peu plus de dix-neuf ans, un peu plus d’un an de service. Vous le rencontreriez en civil dans la rue, votre première impression serait « voilà sûrement un brave petit gars ». Et effectivement, c’est un brave petit gars, sociable, astucieux, jamais de problème. Le genre Titi parisien, regard vif et sourire spontané. A mieux le connaître, vous confirmerez votre première impression mais vous découvrirez aussi, comme je l’ai découvert par la suite, qu’il est d’une maturité insoupçonnée.
Le Caporal Papéétoha, lui, n’est pas parisien : son origine se situe de l’autre côté de la planète, dans les territoires français de l’Océan Pacifique. La Polynésie, Tahiti pour mieux situer, mais plus précisément il vient de l’île de Huahiné, à mi-chemin entre Tahiti et Bora-Bora. Ces noms évoquent la douceur de vivre mais les Polynésiens, jusqu’à la colonisation française au 19ème siècle, vivaient dans un régime de guerres tribales et cannibales où Darwin verrait de la sélection naturelle. Quand vous observez le visage, l’allure et les moindres gestes du Caporal Papéétoha, son caractère guerrier vous apparaît aussitôt évident : voyez les All Blacks, la Nouvelle-Zélande n’est pas loin de la Polynésie. Comme pour souligner le personnage, il est équipé d’une arme puissante qui nécessite d’être physiquement costaud : Papéétoha est mitrailleur, avec une AA52 qui pèse plus de dix kilos mais semble légère entre ses mains.
J’entends vaguement que la conversation de Lebon et de Papéétoha concerne des balles traçantes.
Je tends l’oreille tout en semblant m’intéresser à autre chose pour ne pas interférer. Un peu d’explication technique vous est ici nécessaire si vous ne connaissez pas notre armement.
Le FRF1 (l’arme de Lebon) et l’AA52 (l’arme de Papéétoha) sont des armes qui tirent des munitions de même calibre, munitions qui peuvent donc être échangées. L’AA52 est une arme qui tire par rafales : ses munitions sont alignées sur une bande faite de maillons métalliques démontables. Une cartouche sur cinq est repérée par une pointe de peinture rouge : cela signifie que cette cartouche contient une « balle traçante ». Une balle traçante est une balle ordinaire qui comporte un supplément : lors de l’usinage, l’arrière de la balle a été enrobé de phosphore, comparable à une tête d’allumette qui s’allume au départ du coup. Cette balle suit une trajectoire exactement identique à n’importe quelle autre balle de même calibre, mais sa trajectoire est visible grâce à ce point lumineux. Ainsi le tireur voit où va son tir. Toutefois, j’ajoute un bémol : l’ennemi voit aussi d’où vient le tir, ce système n’est donc pas à utiliser en toutes circonstances mais seulement quand la situation le permet. Les munitions réglementaires de Lebon ne sont pas traçantes et c’est pourquoi il en demande aux mitrailleurs qui peuvent en ôter quelques unes de leurs bandes de cartouches.
Par la suite, j’ai demandé à Lebon d’où il tenait ce truc : «C’est mon père qui me l’a dit, il était dans la Coloniale avant que ça s’appelle l’Infanterie de Marine. Le FRF1 n’existait pas encore, c’était le MAS49 avec lunette, mais c’était déjà le même calibre.
—- Bonne idée, en effet. Il vous en a dit beaucoup des comme ça, votre père ?
—- Oui, autant qu’il a pu, tout ce qu’il savait. »
C’est à cela que l’on reconnaît une corporation : les trucs du métier se transmettent de père en fils, ou de maître à apprenti, comme chez les horticulteurs, les maçons ou les ébénistes. La transmission du savoir et du savoir-faire, c’est selon moi la différence essentielle entre d’une part la valeureuse unité que j’ai l’honneur de commander et d’autre part les bandes malfaisantes que nous sommes chargés ici de désarmer.
Mais il n’y a pas que le savoir-faire : dans une corporation, les règles de l’art s’accompagnent aisément de quelques règles de morale car le savoir-faire est souvent aussi un devoir-faire.
Ma Première est cohérente, imprégnée des valeurs transmises par M. Lebon et tant d’autres, alors que les troupes occasionnelles, comme les bandes qui nous occupent ici, n’ont aucune des références techniques ni surtout aucun des repères moraux qui font notre force.
Les bandes du frolinat sont un ramassis, comme en d’autres pays les milices et autres « gardes » (et pire : les troupes de partis politiques comme les SA, les SS, la Phalange, les Khmers Rouges…).
Quant à nous, Armée française, nous qui sommes la plus ancienne armée du monde (j’écarte, parmi les pays qui avaient plus de mille ans d’Histoire, ceux qui au 20ème siècle ont fait table rase du passé), nos références sont Brennus, Clovis, Jeanne d’Arc, Bayard, d’Artagnan, Lafayette, le Capitaine Marchand, Lyautey, Leclerc, Monsieur Lebon et beaucoup d’autres. Pour ne pas perdre nos références, du passé ne faisons pas table rase.
C’est en pensant à Monsieur Lebon, père de mon caporal, que j’écris cette histoire.
Et c’est aussi en pensant à vous, Mon jeune capitaine que je ne connais pas et qui commandez aujourd’hui la Première du Grand Trois : j’espère que mes souvenirs, alors que j’ai quitté depuis plus de vingt ans le service des armes, vous seront utiles.
De cette parcelle d’histoire de la Première du Grand Trois, vous tirerez les enseignements que vous voudrez tirer. Parce que les circonstances et les moyens changent, mais les principes d’action et les âmes ne changent pas.
22. Les trente secondes
Le lendemain, « on fait comme on a dit », on démarre à l’aube dans l’ordre prévu. Je n’ai pas pris de café ce matin, pour ne pas être énervé. D’autres préfèrent ne pas changer leurs habitudes.
Chère lectrice, cher lecteur, je vous invite maintenant à vous mettre un peu à la place du pauvre bougre du frolinat à Njédaa ce matin-là. Mais je ne vais pas vous y laisser trop longtemps, car sa place n’est pas enviable : depuis la veille il sait que l’heure des comptes approche, que les Frani ont décidé d’exterminer sa bande. Exterminer n’est pas notre intention, mais tous ces pauvres bougres en ont été persuadés par ceux qui les manipulent.
C’est la première fois que les Frani sont assez nombreux pour montrer cette audace. Et ils sont en force à Ati : « katir » (beaucoup). L’aïeul boiteux qui était ancien tirailleur avec des gri-gri qu’il appelait «médailles » (il en avait une « avec l’étoile de merveille[2] ») disait toujours que les Frani, c’est la plus forte armée du monde. Alors les armes qui sont parfaites pour voler les troupeaux, piller les villages, s’assurer des puits, attaquer les dix hommes d’une gendarmerie, intercepter la petite troupe qui vient secourir les gendarmes, ces armes ne suffiront pas cette fois.
Bien sûr celui qui est venu distribuer ces armes, un Libyen, a dit que ce sont de bonnes armes et il l’a montré en tuant l’aïeul boiteux, faisant tomber dans le sable l’Etoile de Merveille. Mais notre brigand ce matin a remarqué que, profitant de la nuit, plusieurs de ses comparses sont partis. Le Libyen aussi, est parti. Parce que le Libyen était venu pour distribuer des armes mais ne croyait pas lui-même ce qu’il racontait, c’est soudain évident. Et les Frani savent que le Libyen est un menteur. D’ailleurs, tous les habitants de Njédaa sont partis aussi parce que les Frani leur ont dit de partir pour leur laisser juste le temps de tuer les frolinat.
Le pauvre bougre du frolinat, quand il entend les Frani arriver, il voudrait partir maintenant comme les autres qui sont partis cette nuit. Mais maintenant c’est trop tard, le jour se lève et si on le voit partir l’un de ses voisins va l’arrêter d’une rafale, il va mourir tout de suite. Alors il reste où il est, en essayant de croire à la protection des gri-gri qu’il porte en collier, mais n’osant plus beaucoup espérer avoir la protection d’Allah le Justicier qui a envoyé les Frani.
On entend les Frani arriver : dans le matin du désert, le bruit des moteurs porte loin. Et l’on voit arriver de la direction d’Ati un épais nuage de poussière éclairé par le soleil levant. Ce nuage avance avec un grondement qui s’amplifie, il passera en face de nous, assez loin on dirait. Peut-être Allah a-t-il changé d’avis et a-t-il dit aux Frani de passer leur chemin ?
Non. Le nuage s’est arrêté, mais maintenant il vient droit vers nous, il grossit éclairé par le soleil et le grondement grossit d’autant. C’est un rouleau qui approche comme un monstrueux vent de sable qui va nous emporter. Il faut arrêter les Frani et leurs machines qui grondent et soulèvent le vent de sable. Les doigts des brigands se crispent de plus en plus sur les gâchettes. L’une des gâchettes cède sous la pression de l’un des doigts, la détonation fait craquer tous les nerfs, tous les brigands libèrent leurs nerfs sans vraiment viser, gaspillant frénétiquement leurs munitions, chargeurs, roquettes, bandes de mitrailleuses. En lâchant toutes ces munitions dans un vacarme qui couvre le bruit des Frani, on évacue sa peur.
Chère lectrice, cher lecteur, revenons maintenant de notre côté un peu plus tôt. De notre côté l’ambiance est différente. Depuis notre quart de tour à droite, nous fonçons à découvert vers Njédaa, les accélérateurs au plancher, les véhicules à côté les uns des autres, avec des écarts de 30 à 50 mètres. L’Escadron plus la Première, cela fait trente-deux véhicules qui foncent vers Njédaa, formant un front large de plus d’un kilomètre. On joue Mad Max, avant la sortie du film. Mad Max : Max le fou. Pour nous, c’est vrai que c’est fou, mais ça n’est pas du cinéma. Nous avons escamoté les pare-brise en position horizontale haute, sur le conseil de Jambon : «parce que si vous prenez une bastos dans le pare-brise, vous ramassez une giclée d’éclats de verre dans la figure et c’est pas bon. »
Le terrain, totalement nu et parfaitement roulable, comporte quelques longues ondulations, une sorte de houle solide sur laquelle les véhicules montent et descendent à mesure de leur progression. Tous en ligne, personne n’aurait l’idée saugrenue d’aller moins vite que les autres : dynamique de groupe. J’ai une question dans un coin de la tête : les types d’en face vont-ils lâcher leurs armes et lever les mains ? Je sais que ça peut «commencer à péter » d’un instant à l’autre et que peut-être je ne verrai pas la suite, mais j’ai réfléchi depuis longtemps à ce genre de situation. La suite sera sûrement intéressante et j’aimerais y participer, mais avec ou sans moi nos malfaiteurs choisiront maintenant le sort qu’ils méritent. Chacun de mes gars sait ce qu’il doit faire : « Seuls les individus sans arme auront la vie sauve et pourront aller raconter ce qui est arrivé.» On fonce pleins pots.
Au moment où les frolinat ont tiré, la chance était avec nous, nous abordions « à fond la caisse » un de ces légers creux du terrain. J’ai vu passer une rafale de traçantes juste au-dessus de la jeep, suivie aussitôt d’un projectile que je n’ai pas identifié (Pierrot Kellermann, le Chat Maigre, l’a vu et me dira que c’était une roquette anti-chars ; j’imagine qu’une jeep percutée par une roquette anti-chars, ça fait des très petits morceaux). Ils savent reconnaître la jeep du capitaine, je m’en doutais. A moins que je ne sois parano, parce qu’en fait je n’étais pas spécialement visé par ces tirs de saturation : le Caporal Nativel, qui se tenait debout sur le plateau du véhicule voisin à ma droite (celui du Sergent-chef Takasi, un Wallisien qui est l’adjoint du Lieutenant Bergerot) n’a pas bénéficié du creux du terrain et a été blessé d’une balle dans l’épaule droite. Ce Réunionnais n’avait peur de rien et, somme toute, il a eu de la chance. Nous avons tous eu de la chance. Peut-être l’avions-nous méritée.
Tout le monde s’arrête aussitôt et se met en position de riposter. Les tirs intenses du frolinat sont un casus belli suffisant pour que notre riposte ne vise pas des innocents : nous allons les désarmer par le seul procédé qui est possible avec des gens qui refusent (s’il existe un autre procédé, montrez-moi comment l’on fait).
Musselin m’a envoyé Tagliamento, l’infirmier, pour soigner le Caporal Nativel blessé. Le Lieutenant Paradès place son AML devant l’infirmier pour que celui-ci travaille à l’abri des tirs. Ceux qui peuvent identifier une cible ouvrent le feu, les autres ne tirent pas, ce serait inutile. Pas de ces feux roulants et gaspilleurs tirés au hasard, pas de ça chez nous : les feux roulants sont une caractéristique des mauvaises troupes, celles qui manquent de stabilité émotionnelle et qui libèrent leur nervosité en tirant beaucoup et mal.
Les obus des AML90 soulèvent la poussière dans les maisons de Njédaa, les tirs ennemis diminuent de densité. L’ennemi a ouvert le feu à 400 mètres environ : mauvaise distance pour lui. Au-delà de 300 mètres, une kalachnikov ou un lance-roquette RPG7 perd toute précision, ainsi d’ailleurs que n’importe quelle arme si elle est mal servie par un mauvais tireur.
Au contraire, c’est la bonne distance pour nous avec notre matériel certes vieux mais soigneusement entretenu et nos gars qui ont reçu une formation sérieuse. De plus le faible creux de terrain où nous sommes arrêtés met à l’abri les pneus des AML, des camionnettes et des jeeps : nous ne serons donc pas entravés par des pneus endommagés, nous pourrons manœuvrer. L’escadron Ivanoff, avec la section Sauvonnet, est sur notre gauche dans une position identique à la nôtre, proche du village : les petites maisons rondes que le berger m’a dessinées en me précisant, ce qui était exact, qu’aucun frolinat ne s’y trouvait. J’aperçois d’ici l’imposante moustache du Sergent-chef Batailleur qui est l’adjoint du Lieutenant Sauvonnet.
Les tirs ennemis ont diminué d’intensité, mais ça n’est pas fini. Pour nous, le front ennemi présente une largeur que nous ne pouvons pas saturer sans gaspiller de munitions et nous ne savons pas quand nous serons réapprovisionnés. De plus, Njédaa-ville, bien qu’il ne s’agisse que d’une très petite agglomération, donne aux tireurs ennemis une profondeur qu’ils peuvent utiliser à leur avantage : ils approchent sans être vus avant de tirer, tirent puis disparaissent aussitôt vers les maisons de deuxième rang, échappant à notre riposte faite de tirs directs. Parmi ces brigands il y a donc quelques combattants qualifiés : on essayera de savoir d’où viennent ceux-ci.
Pour l’instant j’observe dans mes jumelles, en stabilisant ma vision avec les avant-bras contre la bâche de la jeep. Je sens quelques secousses en bas de mon pantalon de treillis : c’est mon radio, le Sergent Félix, qui veut attirer mon attention. Il s’est installé à l’abri des tirs et du soleil, assis par terre, adossé à la roue de la jeep (cette roue semble donc confirmer sa vocation de dossier, depuis hier et mon morceau de chèvre). Félix a fait pendre ses combinés radio, au bout de leur fil, jusqu’à ses épaules et il écoute le trafic-radio comme il doit le faire. Mais ce n’est pas pour me signaler une communication radio qu’il m’a appelé : « vous devriez un peu vous planquer, Mon capitaine ! Parce que ça tire, quand-même ». Il semble s’excuser de me dire ça, mais il a bien raison. A trop voir et entendre passer les coups à côté, on s’habitue, on finit par trouver ça normal et se croire invulnérable. Je m’assois sur le pare-choc de la jeep : ainsi je vois encore tout, presque aussi bien, et je suis moins exposé. Assis, on est mieux que debout, c’est connu.
De l’endroit où nous sommes, on ne voit pas cette palmeraie dont on nous a parlé. Elle est sûrement cachée par une ondulation du terrain. En venant d’Ati, nous avons vu plusieurs zones boisées avec quelques arbres et des buissons comme celle où j’ai rencontré le berger hier, mais rien qui soit une palmeraie. Nous ferions bien de la localiser dès que possible parce qu’elle peut cacher des renforts ennemis.
Si le combat continue comme ça, par cet espèce de duel qui ne peut pas être décisif, ça risque de durer jusqu’à épuisement de nos munitions, sans résultat très net. Mais il nous faut un résultat net. Actuellement, c’est comme si on jouait à « la bataille », lorsque les deux joueurs exposent des cartes de même force. Il nous faut sortir une plus forte carte. La voici.
23. Les Bigor
Le Lieutenant Mesure (c’est son nom) est l’observateur d’artillerie qui m’a été affecté. Il approche en jeep, un peu protégé par sa vitesse et par le creux du terrain. Il fait arrêter sa jeep à côté de moi et m’annonce « le premier coup de réglage est tiré ! » Il précise : « on commence par des fumigènes ».
C’est effectivement préférable de commencer par des fumigènes pour ajuster ce tir d’artillerie : les obus fumigènes sont faits pour dégager une boule de fumée à leur arrivée sur le sol au lieu de faire une explosion qui disparaît aussitôt comme un flash. Les impacts d’obus fumigènes sont donc plus exploitables que les impacts d’obus explosifs pour régler le tir. Mais surtout les obus explosifs projettent des éclats dangereux faits pour tuer ou blesser jusqu’à une distance de 300m autour du point d’impact. Nous sommes actuellement placés à 400 m de l’objectif et une erreur de seulement 100 ou 200m nous placerait dans la zone dangereuse des obus explosifs. Or il faut ici prévoir que le début du tir manquera de précision parce que nos artilleurs ne disposent pas de cartes précises : ils n’ont que des cartes Michelin (et je crois me souvenir que ces cartes du Tchad n’étaient pas à la même échelle qu’en France, mais qu’elles étaient au 1 / 500 000, c’est-à-dire encore moins précises). Des cartes routières dans un pays sans routes, l’incertitude est certaine.
Le Lieutenant Mesure fait son réglage, en notant avec précision tous les éléments qui pourront servir pour d’autres tirs dans le même secteur. Le réglage n’est pas instantané, car chaque obus tiré met environ une minute à parcourir les dix km de sa trajectoire (une minute, c’est sous réserve que mon souvenir soit exact, je me trompe peut-être ; mais parlant de canon je ne veux pas vous dire « un certain temps » comme Fernand).
Le colonel me dit à la radio « pendant le tir d’artillerie, vous décrocherez, vous reculerez pour passer derrière Ivanoff qui, lui, restera sur place pour fixer l’ennemi, puis vous vous irez vous établir sur notre côté gauche en contournant le village, en mesure d’investir à mon signal la position ennemie par ce côté où ils ne vous attendent pas. »
C’est une manœuvre classique qui ne me pose aucun problème, si ce n’est que je ne l’ai jusqu’à présent pratiquée qu’en exercice. Mais depuis tout à l’heure nous avons tous vieilli de plus de trente secondes, alors ça ira tout seul.
Enfin, le Lieutenant Mesure m’annonce « réglage terminé ; on commence le tir d’efficacité ». Nous effectuons donc ce mouvement qu’en termes techniques on appelle un « débordement » pour préparer un «assaut».
24. Assaut retardé
Nous sommes maintenant sur la base d’assaut. Le terrain est plat et nu jusqu’à l’objectif qui est constitué des maisons pour la plupart basses et carrées auxquelles nous faisions face avant notre mouvement de débordement, mais que nous voyons maintenant sous un autre angle. Nous sommes sur le côté droit de l’ennemi qui nous tirait dessus tout à l’heure. L’objectif est situé à 500 mètres devant nous sur une légère ondulation de terrain derrière laquelle on ne peut rien voir d’ici. Je sais seulement, parce que mon berger-cartographe d’hier me l’a dit et dessiné, qu’il y a probablement une palmeraie à quelque distance au-delà.
Je réfléchis pour la suite. J’entends encore mes instructeurs, le Lieutenant Suty quand j’étais jeune Saint-Cyrien à Coëtquidan et le Commandant Thérenty à l’Ecole des capitaines d’infanterie à Montpellier : “Toujours, à la fin d’un assaut, dépassez aussitôt l’objectif et gardez-vous de la contre-attaque ! Toujours !“
Quand nous serons arrivés sur l’objectif, nous pourrions subir une contre-attaque sous plusieurs formes : un contre-assaut à pied ou en véhicules venant d’une direction inattendue (on sait depuis la bataille d’Ati que l’ennemi est équipé de Toyota-mitrailleuses), ou des tirs directs venant d’une autre position ennemie (c’est ce qui se produira, mais je ne le sais pas encore), ou des tirs d’artillerie déclenchés par l’ennemi qui sait qu’il n’a plus aucun des siens encore vivant ou utile sur l’objectif (nous subirons en effet quelques tirs de 106, mais je ne le sais pas encore).
A la radio, le colonel me dit : “tenez-vous prêt, on enverra le tir d’artillerie et vous avancerez aussitôt après“. Un temps et il ajoute : “seul problème, c’est qu’il ne reste que 17 obus d’artillerie, le tir sera bref.” Dans mon for intérieur, je lui sais gré de ne pas m’avoir caché ce sérieux manque.
A moi maintenant d’organiser l’assaut. Compte tenu du terrain, du peu de munitions d’artillerie qui restent, du fait qu’il faut ne pas trop laisser avancer seuls les blindés du Lieutenant Paradès, de l’avantage d’aller vite, de la fatigue physique de mes gars, je prends une décision qui n’est pas exactement conforme aux règlements mais qui est conforme au principe de s’adapter aux circonstances. Les gens qui écrivent ou signent les règlements (qui sont en fait plutôt des recommandations) pour un combat contre les forces blindées-mécanisées du Pacte de Varsovie en Europe, ne pensent pas en même temps à un combat contre une piétaille de malfaiteurs nombreux et surarmés au Tchad, ni ne prévoient que notre logistique sera défaillante.
J’y réfléchis à deux fois, pour tenir compte de ma propre fatigue qui pourrait fausser mon jugement. Bien sûr, suivant le conseil que donne depuis longtemps le Sergent-chef Jambon, j’ai ôté mon chapeau, tête nue sous l’ombre de la bâche de la jeep. Parce que ce n’est pas le moment de « faire des conneries ».
Nos véhicules d’infanterie ne sont pas blindés, ce sont des camionnettes. Mais si nous y allons à pied dans l’état de fatigue où nous sommes, et sous le soleil, la plupart des gars ne termineront pas la course, ou seront à bout de forces en arrivant. Et je décide : nous avancerons en véhicules à la vitesse des blindés et nous débarquerons juste avant l’ondulation de terrain qui, vue d’ici, nous cache la suite du paysage. Puis dans la foulée nous dépasserons l’objectif.
En attendant, nous scrutons l’objectif avec nos jumelles : on ne voit rien bouger. S’il y avait des survivants après les tirs de tout à l’heure, ils ont filé. Mais nos Bigor tireront quand-même les dix-sept coups qui leurs restent. L’intérêt d’un dernier tir d’artillerie avant l’assaut n’est pas seulement d’assommer ou d’achever d’éventuels survivants qui n’auraient pas pu fuir, blessés désespérés et donc d’autant plus dangereux : l’intérêt est surtout de détruire des pièges que l’ennemi aurait pu laisser avant de s’enfuir. Ces pièges éventuels sont faciles et rapides à installer, même par des gens inexpérimentés et pressés : par exemple une grenade dégoupillée coincée sous un objet et qui explosera quand elle sera décoincée. Il est facile d’en truffer la position avant de fuir. Le dernier tir d’artillerie sert à secouer les pièges pour les déclencher avant notre arrivée.
Par radio sur la fréquence intérieure de la compagnie, j’ai donné mon ordre préparatoire, très simple : “à tous, ici Bleu. Objectif : les maisons situées à 500m devant nous, à dépasser pour être en mesure de faire feu sur la lisière d’une palmeraie qui se trouve au-delà. Préparez-vous pour un assaut en véhicules, formation triangle pointe en avant, les blindés en tête, l’infanterie au plus près derrière, Kellermann à droite, Bergerot à gauche, moi-même au centre. Vitesse maxi et nous débarquerons avant les maisons. Tir à tuer sur tout individu armé, ne prenez aucun risque. Attendez mon ordre pour démarrer.”
Je rends le combiné à mon opérateur-radio, le Sergent Félix. Il me tend son bidon d’eau, comme en échange. Je ne lui ai pas demandé, mais il a deviné que c’est le moment de boire une gorgée d’eau. “Elle n’est pas très fraîche“, s’excuse-t-il.
Et la compagnie attend, j’attends, le signal. Nous attendrons ainsi pendant trois heures. Je sais que le colonel a dû demander à N’Djaména l’autorisation «d’engager l’infanterie », car c’est toujours une phase risquée. Le général lui-même (je le connais) n’est pas homme à tergiverser. En y repensant plus tard, j’ai supposé qu’à la suite des pertes subies dans les semaines précédentes, les politiciens à Paris avaient réduit la marge d’initiative du général. C’est possible : de nouvelles pertes pourraient bientôt faire jaser la presse, gêner le gouvernement en donnant des arguments à son opposition qui, n’ayant pas gouverné depuis la précédente République, a la critique facile à l’époque, sur tous les sujets. La décision, dans un bureau parisien à dorures, n’est pas facile à prendre. D’autant qu’à Paris, c’est bientôt l’heure du déjeuner.
Mais ces affaires de politiciens ne sont pas mon affaire, surtout pas à ce moment. Pendant que nos Rougon-Macquart se consultent mutuellement pour évaluer le risque auquel ils exposent leur carrière j’attends sans états d’âme, seulement ennuyé par ce contre-temps : pas de place pour les doutes pendant l’action, mais longtemps avant ou après. Pendant l’action, je ne laisse pas mon attention s’en détourner, surtout aujourd’hui où la vie des miens en dépend.
Je me les suis posées plus tard, les questions théoriques qui me restaient à résoudre. J’ai lu les débats parlementaires de l’époque : c’est affligeant. L’on y voit s’exprimer, sous couvert de principes, les antagonismes des partis politiques et les arrivismes personnels. Nous souffrons du soleil sur la base d’assaut sans pouvoir organiser l’attente parce que je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je sais que la suite risque d’être difficile, peut-être mortelle pour les miens et sûrement mortelle pour les pauvres bougres d’en face. A ce moment, quelle importance que les accords franco-tchadiens de coopération, modifiés en 1976, contiennent désormais un article 4 stipulant que les coopérants français (c’est nous) ne seront pas directement engagés dans des actions de combat ? La réalité sur le terrain, c’est qu’il faut neutraliser ces pillards et ôter à quiconque l’envie de les imiter. Ils sont une menace évidente pour la préfecture d’Ati après notre départ et ils ont déjà démontré largement, et encore dix jours plus tôt, leur capacité criminelle. Cette fois, ils ont encore cherché l’affrontement en ne disparaissant pas pendant la nuit. Ils ont eu leur dernière chance ce matin : au lieu de nous tirer dessus, ils pouvaient lâcher leurs armes et lever les bras. Dans ce cas, nous n’avions aucun intérêt à les tuer. Alors qu’est-ce qu’on attend ?
Le seul effet de cet « article 4 » est de déblayer devant les malfaiteurs tout obstacle sérieux pouvant empêcher leurs commanditaires de parvenir au pouvoir et d’encaisser les bénéfices. Je ne connais pas les vrais motifs des politiciens d’opposition qui, à Paris, exigeaient l’application de cet article protégeant les pillards. D’autant que quelques années plus tard, la situation s’étant inversée en France, l’opposition devenue gouvernement ne s’est guère arrêtée à cet « article 4 ».
Attendre comme ça pendant des heures en plein soleil, ça n’arrange pas notre forme physique. Les gars se mettent à l’ombre comme ils peuvent. J’ai bien fait de prévoir d’avancer au plus près de l’objectif en véhicules.
Pendant cette espèce de trêve, l’ennemi pourrait se réorganiser dans la palmeraie que nous ne voyons pas. Pour empêcher ce risque nos avions « Jaguars » interviennent. Ces avions sont faits pour « appuyer » l’infanterie (excusez ce terme technique : appuyer signifie faire feu sur les ennemis pour aider les amis). Deux Jaguars basés sur l’aéroport de N’Djaména n’attendaient que cela, dans leurs starting-blocks, depuis l’annonce de la bataille ce matin.
Ils arrivent à très basse altitude et grande vitesse (les aviateurs ont coutume de dire que le Jaguar est “un avion capable de voler plus vite que sa peinture et de décoller uniquement parce que la terre est ronde”). Leur indicatif-radio est « cresson », celui de l’officier de guidage à terre (OGT) est « vaurien ». Je ne sais pas qui a inventé ça, mais John Wayne n’aurait pas accepté des indicatifs aussi peu valorisants, ni d’ailleurs de jouer dans une opération nommée « tacaud ». Si vous préférez des indicatifs comme « Top-gun leader » ou « Tarzan balèze», et des opérations nommées « Ouragan sur le Sahel», ça n’est pas chez nous que vous les trouverez. Mon camarade le Capitaine Kersaho, qui est à côté du colonel et qui est qualifié OGT, assure leur guidage final par radio. Pour être vu de la direction où ils arrivent, il a déployé un panneau rouge, un « panneau air-sol », à l’arrière d’un camion. Je dispose moi-même d’une radio sur leur fréquence, mais j’écoute sans intervenir. Je n’interviendrais que si je les voyais en position de tirer sur nous. Mon indicatif sur cette fréquence est mignon aussi : « vaurien bleu ».
Pas de baratin à la radio, pas de tchatche, on n’est pas à Hollywood : « cresson de vaurien, voyez-vous les maisons à 5km devant vous, au-delà du panneau rouge ? L’objectif est une zone boisée au sud des maisons.
—- … (quelques secondes pour approcher à 800 km/h et apercevoir) … De cresson, visuel panneau rouge. …Visuel les maisons. … Et visuel cette zone boisée.
—- Vous êtes dans l’axe correct : autorisation de tir. »
Les deux Jag larguent leurs bombes sur la palmeraie dont, au passage, ils ont ainsi confirmé l’existence et montré à peu près la distance. Leur mission n’est pas sans risque car l’ennemi, au sol, dispose de matériel perfectionné : nous voyons l’un des avions être poursuivi par l’un de ces missiles anti-avions faits pour être tirés par un piéton équipé d’une arme portable, le missile SAM7 (pour Sol-Air Missile modèle n°7), arme de fabrication soviétique. Ce missile d’infanterie est auto-guidé à l’infrarouge, attiré par la chaleur du moteur. Dans les semaines précédentes, les mêmes modèles de missiles SAM7 ont abattu des avions commerciaux d’Air-Tchad. Heureusement cette fois, l’avion est rapide et dans le ciel tchadien vers midi, il n’y a pas que le moteur qui chauffe : il y a aussi le soleil. Nous voyons le missile SAM7 être distancé, abandonner la poursuite et monter droit vers le soleil.
Leur mission terminée, les Jag rentrent à leur base, excepté un qui a été touché, probablement par une mitrailleuse, et s’écrase au retour. Le pilote a pu s’éjecter et a été récupéré. Voilà cependant un bombardement de précaution qui coûte cher. Mais il a peut-être sauvé quelques uns d’entre nous en empêchant l’ennemi de se réorganiser hors de notre vue pendant qu’il en avait le temps.
Ce qui coûte cher, encore cette fois, c’est l’indécision : retarder notre assaut a nécessité l’intervention des avions d’appui-feu, dont un a été perdu. L’indécision nous a déjà coûté cher depuis trois mois en nous faisant tarder à intervenir d’emblée avec des moyens suffisants et en nous cantonnant dans un rôle défensif.
Arrive enfin l’ordre (mais nous le prenons plus exactement comme une autorisation) d’investir l’objectif. Encore une fois, « on fait comme on a dit », je ne vous répète pas la manip.
Nous dépassons rapidement les quelques maisons de Njédaa-ville, à pied avec les blindés, laissant nos véhicules non-blindés en arrière. Ce n’est pas vraiment une ville : aucun plan d’urbanisme, les maisons semblent posées ça et là au hasard, assez écartées pour laisser des passages larges mais irréguliers que l’on ne peut pas appeler des rues. Nous marchons rapidement mais notre attention est en éveil maximal. Nous passons, avec un coup d’œil à l’intérieur, derrière les maisons où les frolinat s’étaient retranchés face à nous tout à l’heure. Pendant ce temps l’escadron d’Ivanoff avance sur notre côté droit. Les maisons ont été endommagées par les canons des AML90 en tir direct, mais ailleurs le tir d’artillerie a fait peu de dégâts matériels car les obus étaient réglés « fusants », c’est-à-dire explosion instantanée à l’impact, avant que l’obus n’ait le temps de pénétrer dans le sol ou dans les toits. Ce réglage « fusant » augmente la dispersion des éclats et diminue les dégâts matériels, pour tuer les ennemis qui étaient en arrière hors de notre vue et de nos tirs directs, aussi pour déranger les pièges, sans que l’endroit ne devienne impraticable pour l’infanterie (danger et difficulté d’avancer dans des ruines instables ou sur des gravas).
C’est au cours de cette progression que nous découvrons le spectacle que je vous décrivais au tout début de ce récit.
Pendant que nous traversons la petite agglomération, nous subissons des tirs d’un canon de « 106 » qui viennent de la profondeur de la palmeraie. Ces obus de calibre 106 (je reconnais leur mode opératoire appris à l’Ecole) sont réglés pour exploser après un temps de trajectoire défini et donc à quelques mètres au-dessus du sol. Les explosions au-dessus de nos têtes sont assourdissantes et elles nous assomment pendant un moment à chaque coup, mais elles ne font presque aucun dégât, inexplicablement (le Dieu de Clotilde ? Allah ? Nos anges-gardiens ? La chance ? Comme vous voulez). A côté de moi, je vois un de mes jeunes, le soldat Rubio, recevoir une blessure à un oeil, non par un éclat d’obus mais par un objet qu’une explosion de 106 a balayé d’un toit.
On entend arriver chaque obus de 106 par un sifflement qui descend dans l’atmosphère. Lorsque c’est un long sifflement aigu, cela signifie que nous ne sommes pas sous la trajectoire du projectile. Plus le sifflement se fait entendre aigu, plus l’explosion sera lointaine. Au contraire, plus le sifflement se fait entendre sur une note grave (c’est même un grondement et il est bref), plus il annonce que l’explosion sera proche. Le Sergent Zimmer, qui marche à côté de moi à ce moment-là, écoute mon explication avec intérêt : je le revois encore aujourd’hui, trente ans plus tard. La vérification de ma leçon de musique arrive alors : on entend un sifflement aigu et une explosion lointaine puis au coup suivant un grondement qui déclenche le réflexe immédiat de s’abriter. Ceux qui ne le savaient pas imitent ceux qui savent. Rien de mieux à faire que de s’accroupir vivement à côté d’un mur en pensant à la bénédiction du berger : qu’Allah protège les Frani.
L’explosion est un coup de massue. Groggy mais assez conscient. Effort pour se réveiller. On se redresse, on continue.
Nous avançons au plus vite, les gars qui sont en éclaireurs font feu sans hésiter sur tout individu armé, mais nous ne rencontrons que des morts : parfois il arrive par erreur que les éclaireurs « tuent » un cadavre parce qu’un mort avec une arme dans les mains ressemble à un vivant immobile et armé. Surtout quand on regarde un endroit sombre avec des yeux éblouis par le soleil. D’autant qu’il faut en même temps vite regarder, avant de tirer, qu’on n’a pas un camarade dans l’axe de tir. Quand on est en position d’éclaireur, on ne tire pas sur tout ce qui bouge mais sur tout ce qui pourrait être un danger. Du fait que les éclaireurs des deux sections (la section Kellermann à ma droite, celle de Bergerot à ma gauche) avancent à la même hauteur, on tire devant soi ou au sol, non à l’horizontale sur les côtés, car nos balles de 7.5 sont puissantes, elles peuvent traverser un mur et blesser un camarade. Ce genre de progression exige d’être très attentif et lorsque je vous dis « nous avançons au plus vite », n’imaginez pas une galopade.
On marche vite, les blindés en tête règlent leur vitesse sur celle des éclaireurs. J’ai dit avant l’assaut, chacun se souvient de mon ordre : « tir à tuer sur tout individu armé, ne prenez aucun risque. » Je ne reprocherai pas aux éclaireurs d’avoir fait feu sur des cadavres dans cette situation : parce que ce n’est pas par cruauté ni par haine qu’ils l’ont fait.
J’observe qu’il n’y a aucun civil parmi les victimes : nous avons bien fait d’avertir hier. Je ne vois pas non plus les cadavres des combattants qualifiés dont je vous parlais avant le tir d’artillerie, souvenez-vous : ces gens qui étaient capables de disparaître vers l’arrière des maisons pour échapper à notre riposte aussitôt après qu’ils avaient tiré. S’ils étaient ici je pourrais, ou plusieurs d’entre nous pourraient, remarquer leurs cadavres à quelques signes distinctifs : des uniformes différents, ou du matériel particulier, un pistolet à la ceinture ou un poste radio.
Mais non, ils ont filé. Ce sont probablement les mêmes qui nous envoient maintenant du 106 depuis la palmeraie. Le réglage d’artillerie a été fait au fumigène. Le réglage au fumigène présente des avantages et c’était même indispensable cette fois : du fait de l’imprécision des cartes, le réglage avec des obus explosifs aurait été dangereux pour nous. Mais du côté de l’ennemi les fumigènes constituent un avertissement sans frais pour ceux qui comprennent qu’il s’agit d’un réglage et savent ce qui va suivre.
Les cadavres qui sont ici sont ceux de simples porteurs de kalachnikov. Parmi eux, il y a peut-être les cadavres de ceux qui ont tué Allouche et Lenepveu. Les chefs, ainsi que les conseillers techniques, nous ont échappé. Peu importe : notre mission n’était pas de capturer les chefs et les conseillers techniques, mais de désarmer les rebelles.
Nous avançons sans tarder pour dépasser l’objectif. Les tirs de 106 se sont arrêtés, pour un motif que j’ignore. Munitions épuisées ? Canon enrayé ou détruit par une erreur de manipulation ? Ou plutôt panique et fuite des tireurs qui nous entendent arriver à la fois du nord (ma compagnie et l’escadron) et du sud (la 3ème compagnie arrivée de Mongo).
Pendant cette action, je n’ai pas sorti mon arme, parce que « le capitaine, il a autre chose à faire que de jouer du flingue » (je vous laisse deviner qui est l’auteur de cette maxime). Et c’est vrai que lorsque les événements se précipitent on ne peut pas en même temps faire le coup de feu, suivre la situation d’ensemble de la compagnie et garder l’esprit clair : méthode[3]. Pour me protéger de l’ennemi, je compte sur la compétence des gars qui sont autour de moi.
J’ai pris une radio portable calée sur la fréquence intérieure de la compagnie, mais j’écoute seulement : je n’ai pas à intervenir, les décisions à prendre actuellement ne sont pas du niveau du capitaine, tout le monde a compris quel est le résultat à obtenir (se mettre en position pour faire feu sur la lisière d’une palmeraie qui se trouve au-delà des maisons ; tir à tuer sur tout individu armé) et chacun fait sa part en parlant le moins possible à la radio : seulement les communications indispensables, claires. On serait mal venu de baratiner à la radio, nous sommes quinze sur la même fréquence. Mon radio, le sergent Félix, me suit avec un autre poste, calé sur la fréquence du colonel. Là non plus, pas de paroles inutiles : j’ai informé le colonel au moment où nous avons quitté la base d’assaut, je le rappellerai quand nous serons à portée de tir de la palmeraie. Jusque là, il sait que si on ne l’appelle pas, cela signifie que tout se déroule à peu près comme prévu , que l’on n’a besoin de rien et que les décisions ne sont pas de son niveau.
Nous ramasserons les armes ennemies plus tard, elles peuvent rester avec les cadavres en attendant. Pour le moment, il s’agit de prendre sous notre feu la lisière nord de la palmeraie qui se trouve en face de nous à 300m au-delà des maisons. La forme du terrain ne nous est pas favorable, parce qu’elle cache en partie la lisière.
Le groupe du Sergent Joannès, progressant en ligne (cela signifie « côte à côte avec des distances ») et à découvert parce que le dernier abri possible à cet endroit a été franchi quelques mètres plus tôt et ne lui permettait pas de voir son secteur de lisière, ce groupe se fait tirer dessus depuis un autre endroit de la lisière face à nous. Tirs imprécis, heureusement (j’ai supposé par la suite que ces tireurs frolinat préféraient rester à l’abri derrière les aspérités du terrain et tirer au-dessus de leur tête, sans viser).
Le chef de la section fait revenir le groupe Joannès à l’abri, accompagné de l’appui-feu des deux autres groupes de la section. Voix de Joannès à la radio « je retourne ramasser Derval, il est tombé ». Le Sergent Joannès est un Antillais baraqué : ce n’est pas le poids du petit Derval qui peut poser problème, ce sont les tirs ennemis. Le groupe de Joannès stoppe sur place et se retourne pour faire feu contre tout tireur qui sera repéré dans le secteur d’où viennent les tirs.
Dans le reste de la compagnie, tout le monde a compris : toutes les armes qui le peuvent font un tir de neutralisation contre la palmeraie pendant que Joannès prend Derval sur ses épaules. Voix de Jambon, qui sert les mortiers de 60 avec Mouillerat, Pondiche et Radja : « il me reste seulement huit coups, qu’est-ce que je fais ? » Je lui réponds aussitôt : « balancez tout sur la lisière, maintenant ».
Jambon a raison de me poser la question : la décision d’épuiser des munitions ou d’en garder quelques unes est de la responsabilité du capitaine.
Le Sergent Joannès a chargé Derval sur ses épaules et l’a porté à l’abri des tirs et du soleil : je saurai bientôt par le Caporal Tagliamento, l’infirmier, que Derval était victime d’une hyperthermie, un accident de santé grave qui peut, en soi, être mortel. Et plus vite mortel encore lorsque ça arrive à portée des tirs ennemis. L’hyperthermie, on appelle ça aussi un « coup de chaleur ». C’est dû à l’excès de température que nous subissons depuis plusieurs jours et surtout aujourd’hui : ces trois heures d’attente avec peu d’ombre et sans vent ! L’hyperthermie commence par un malaise qui, si on ne rafraîchit pas la victime, continue par un évanouissement et la mort. Derval a commencé son hyperthermie dans la camionnette du groupe, avant de débarquer pour l’assaut. Il aurait dû rester là, à l’ombre de la bâche et avec de l’eau. Personne ne lui aurait reproché dans l’état où il était. Mais non : les copains y vont, j’y vais donc aussi et tant pis si je crève. Dynamique de groupe, encore : plus que de la camaraderie, c’est de la fraternité.
25. Désarmement
Maintenant, on se calme. La compagnie prend position en bordure des maisons pour tirer sur la palmeraie qui est à 300m comme je vous l’ai dit. L’on y voit assez profondément, les arbres étant clairsemés. Nous avons seulement un angle mort sur la gauche, c’est dans le secteur du Lieutenant Bergerot qui fera faire un détour à l’un de ses groupes, avec une AML, pour prendre une position de tir correcte. Pour nous qui sommes bons tireurs (remerciement à nos instructeurs de tir), la distance de 300m nous est favorable. Les gars de la section du Lieutenant Kellermann ont trouvé des caisses en carton dans les maisons je ne sais où, ils les ont remplies de sable et sont « en position du tireur couché » derrière ce créneau improvisé, alignés comme au champ de tir. Le soleil n’est plus à son sommet dans le ciel et son rayonnement devient moins dangereux. Les chefs de groupe ont désigné sur la lisière des secteurs de quelques mètres de large pour chaque tireur afin d’éviter que l’on tire en pagaille simultanément à plusieurs sur le même homme armé. Je regarde avec mes jumelles ce qui se passe dans la lisière et je vous le commenterai quelques pages plus loin.
L’affaire Derval, tout à l’heure, a été répétée par Tagli pour rappeler le danger de l’excès de soleil : pour que leurs hommes tiennent pendant le reste de l’après-midi sans trop souffrir de la chaleur, les chefs de groupe les envoient tour à tour se mettre un moment à l’ombre et boire de l’eau dans les véhicules qui sont en retrait, à l’abri des tirs ennemis. Mais il n’y a plus guère de tirs ennemis maintenant.
La lisière nord de la palmeraie, n’est plus fréquentable par aucun homme armé : porter une arme y est très dangereux, mortel, car nous y veillons. Si l’on veut vraiment y circuler, il faut le faire sans arme et les mains bien visibles. S’abstenir évidemment de ramasser les armes tombées à terre. Désarmement, c’est la condition pour qu’ils aient la vie sauve.
Au même moment, à 2 ou 4 km plus au sud, notre 3ème compagnie venue de Mongo comme prévu s’occupe de la lisière opposée, dans les mêmes conditions.
Pendant ce temps, j’ai chargé la section de commandement de ramasser toutes les armes ennemies qui traînent sur le terrain où nous venons d’avancer. Ce sont pour la plupart des Kalachnikov, mais il y a aussi des lance-missiles anti-avions SAM7 : ces engins, depuis le début de la crise, se sont révélés mortels pour les transports aériens. Mes gars ramassent tant d’armes qu’ils en remplissent un camion, pendant que l’escadron d’Ivanoff en ramasse autant de son côté.
Ramassées sur le sol tchadien, ces armes appartiennent au Tchad : avant notre retour en Bretagne, nous les rendrons à la Gendarmerie tchadienne, qui nous en laissera volontiers quelques unes pour nos musées.
Dans les jours suivants, pendant que la Première et la batterie de 105 continueront vers Abéché, l’escadron d’Ivanoff reviendra ratisser la palmeraie et ramassera encore toutes sortes d’armes abandonnées, y compris des armes lourdes.
Le résultat qui était voulu depuis la veille au briefing du colonel semble maintenant obtenu. Toutefois nous allons rester ici cette nuit pour que l’élimination du frolinat de Njédaa par les Frani soit incontestable et connue de tous.
En ce milieu d’après-midi, je fais maintenant le tour de ma compagnie, à la fois pour me montrer, montrer ma satisfaction et recueillir les commentaires immédiats des uns et des autres, car beaucoup d’éléments d’information et d’ambiance peuvent avoir échappé à mon attention.
Je vois se diriger vers moi le Sergent-chef Chapellier, qui est l’adjoint du Lieutenant Kellermann. Chapellier semble content de sa journée. Il approche, carrure d’athlète, yeux clairs dans l’ombre du chapeau, sourire jusqu’aux oreilles, pistolet-mitrailleur en bandoulière, jumelles autour du cou : “On s’est bien marrés, hein, Mon capitaine ?“
J’avise les jumelles : elles portent une profonde encoche, certainement une trace de calibre 7.62 kalachnikov ou d’un éclat d’obus. Sous les jumelles, une estafilade qui déchire la veste du treillis confirme que le coup n’est pas passé loin. Je dis à Chapellier : “Vous avez eu de la chance, on dirait ? “. Regard interrogatif, il ne comprend pas de quoi je parle. Je lui montre les dégâts. Il comprend brusquement. Stupéfait.
Je lui dis : “Ces jumelles, on va vous en faire cadeau, vous les garderez en souvenir. Officiellement, je ferai un compte-rendu de perte.
—- Je vous remercie, Mon capitaine, c’est sympa.” Cependant il reste pensif.
Il ajoute : ” Mais il y a quand-même un problème.
—- Pas de problème : si un fourrier me dit que ça n’est pas réglo, je lui dirai qu’il aurait dû y venir lui-même.
—- Non, le problème c’est ma femme : quand elle va voir les jumelles, je vais devoir lui raconter. Elle ne va pas aimer que j’aie couru des risques.”
Pour comprendre complètement l’âme et le cœur de tous ces garçons, on aurait tort d’oublier que chacun pense à sa famille qui espère son retour.
Continuant de parcourir le terrain, je remarque une scène qui me semble assez significative pour mériter de vous être rapportée.
Cela se passe, si vous vous rappelez le schéma dessiné hier par le berger, entre Njédaa-ville (les maisons carrées) et Njédaa-village (les maisons rondes). Des femmes ternes et discrètes comme celles que j’ai vues à Ati sont maintenant sorties du village. Elles amènent un âne portant un rouleau de corde et des morceaux de cuir que je n’identifie pas d’abord.
Elles s’affairent autour d’un endroit du sol où trois solides morceaux de bois disposés en triangle délimitent une sorte de trou dont je ne comprends pas non plus l’utilité.
Une extrémité de la corde étant attachée à l’âne, elles attachent les pièces de cuir à l’autre bout de la corde et mettent le cuir dans le trou du sol. Vous comprenez que je suis perplexe mais intéressé. Elles semblent savoir ce qu’elles font, leurs gestes dénotent une intention qui est claire pour elles. Mais pas claire pour moi. J’observe. Ma présence et ma curiosité ne semblent aucunement les perturber : je suis certainement classé « ami ».
Le mystère s’épaissit pour moi quand je vois que, d’une légère tape, l’une d’elle a donné un signal à l’âne qui sait évidemment beaucoup mieux que moi de quoi il s’agit (il en serait vexant, l’animal ! ) : la corde se tend aussitôt que l’âne commence à s’éloigner du trou d’un pas tranquille et régulier. La corde tendue n’en finit pas de sortir du trou à mesure que l’âne s’éloigne.
Je comprends enfin quand je vois apparaître en haut du trou la pièce de cuir, qui est attachée par ses quatre coins, gonflée d’eau : un puits ! L’une des femmes fait soigneusement sortir du trou la pièce de cuir pleine d’eau que l’âne a fait monter.
Ces gens étaient privés de leur eau, ressource vitale pour eux mais accaparée par les malfaiteurs abusant de la force des armes. Ces armes avaient été distribuées avec la mauvaise intention politique de déstabiliser la région, au mépris des habitants. Nous avons bien fait de venir rétablir la situation. Ces villageoises, en utilisant leur puits dès que nous en avons chassé les frolinat, nous ont adressé en silence le plus beau remerciement possible.
L’âne est loin, à l’autre bout de la corde tendue. Je mesure la distance, utilisant le double-pas que j’ai étalonné lors de ma formation militaire initiale. Longueur de la corde : soixante mètres ! Un puits profond de soixante mètres !
Les Africains de Njédaa, comme beaucoup d’autres au Sahel, ont été capables de creuser un puits de soixante mètres sans l’aide de personne. Cessons de sous-estimer les Africains. Effaçons de nos têtes tous les clichés simplistes que des reportages trop schématiques y ont inculqués : je vous le suggérais déjà hier après ma rencontre avec le berger.
Au contraire, appliquons un maximum d’esprit critique aux opérations d’aide à l’Afrique que nos journaux présentent au public : ces opérations sont souvent inadaptées, voire illusoires.
Le souvenir de ce puits profond de soixante mètres me rappelle une démarche qui fut à la mode pendant un temps et pour laquelle vous avez peut-être versé des sommes d’argent qui n’ont pas été perdues pour tout le monde : l’opération « une pompe pour le Sahel ». On a oublié de vous dire qu’aucune pompe par aspiration n’est capable de tirer de l’eau à une telle profondeur, car il existe une limite infranchissable qui résulte de la pression atmosphérique, une donnée naturelle impérieuse. Dans la plupart des puits du Sahel cette « pompe pour le Sahel » ne pouvait pas fonctionner : seule une pompe immergée peut fonctionner ici et ce n’était pas le cas de cette « pompe pour le Sahel », qui était un système par aspiration. Une pompe à fric, en fait. Regardez la réalité : dans le Sahel, l’eau se trouve partout à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Vérifiez sur les cartes : certaines cartes indiquent la profondeur des puits.
Les pompes par aspiration que les reportages vous montrent en service ne tirent de l’eau qu’à moins de sept mètres de profondeur, une situation qui est rare, très rare, au Sahel.
J’ai vu la supercherie, alors je vous la dis, même si je dois vous décevoir.
J’ai peut-être tort de vous décevoir en étant aussi direct dans l’expression. Cette opération présentait quelques avantages, après tout. Vous avez montré votre générosité en donnant des sous, croyant faire quelque chose pour le Sahel parce que vous ne pouviez pas savoir de quoi il a besoin : il a besoin de sécurité avant tout, mais personne ne vous l’a dit. Avantage secondaire de cette opération « une pompe pour le Sahel » et autres opérations du même tonneau, mais c’est un avantage qui me plaît beaucoup moins : les vendeurs de pompes et leurs intermédiaires ont été très contents de l’opération. Enfin ce qui est bien, si l’on veut, c’est que leurs pompes ne risquent pas de rouiller, n’est-ce pas ? Et le métal est récupérable par les forgerons du coin, qui en feront bon usage car ils sont très habiles.
Vous avez fait ce que vous avez pu. Mais votre bonne intention a été détournée.
Je vous répète donc ce que je vous disais hier après ma rencontre avec ce berger cartographe : les Africains, et ceux du Sahel comme les autres, sont capables de beaucoup ; il faut que nous leur donnions pour commencer ce qui leur manque le plus, la sécurité.
En juin 1978 au Tchad, un petit bataillon de votre armée a rétabli la sécurité, faisant une bonne action dont l’effet s’est prolongé pendant quelques mois. « C’est déjà ça. »
Je voudrais maintenant revenir sur un autre aspect de cette mission, aspect qui de nos jours, trente ans plus tard, présente encore un intérêt je crois : vous en jugerez.
Tout à l’heure, ici quelques pages plus haut, je vous disais que j’observais avec mes jumelles les tirs de mes gars contre la lisière à 300m et dans la profondeur jusqu’à 600m. Ce qui suit, je vous le raconte sans cruauté aucune car notre action ne comportait pas la moindre cruauté. Mais je vous le raconte tel quel, parce que c’est la réalité des faits et parce que je veux ensuite vous dire quelque chose qui me semble important.
Dans la lisière gît le cadavre d’un de ces pauvres bougres qui ont cru que leur kalachnikov leur donnait un incontestable pouvoir. L’arme est au sol à côté du cadavre. Arrive un autre pauvre bougre, qui croit encore au pouvoir de la kalachnikov et veut la ramasser. Ses comparses sont restés à l’abri et l’observent. Sans doute ils l’encouragent, nous n’entendons pas. Le Caporal Lebon lui envoie une traçante d’avertissement. Peut-être le type croit-il que Lebon a manqué son coup et croit-il qu’il aura le temps d’aller courir s’abriter derrière un tronc d’arbre proche ou dans l’une des ravines qui forment ici des tranchées naturelles. Il se baisse, se relève avec l’arme à la main, mais il n’a pas le temps de courir, il meurt aussitôt, transpercé par une deuxième traçante de Lebon. Plus loin, même scène, mais c’est Papéétoha le mitrailleur qui intervient : pour avertissement, une courte rafale de trois cartouches tirées au sol. Si l’avertissement ne dissuade pas de ramasser l’arme, alors Papéétoha envoie trois autres balles, c’est-à-dire 27 grammes de métal (plomb enrobé de cuivre full metal jacket) lancés à vitesse supersonique, mais pas à côté cette fois. Le triple impact projette le malfaiteur à plusieurs mètres en arrière, le ventre arraché. Il est mort avant de toucher le sol. Cette scène se reproduit jusqu’à ce que les pauvres bougres comprennent que les sommations ne sont pas des tirs manqués et abandonnent l’idée de récupérer des armes.
Et voici ce que je veux vous dire : quelques années plus tard des bavards se déchaînaient sur nos écrans de télévision et dans la presse d’opinion à l’occasion de la guerre civile en Yougoslavie. Philosophe ou pas, french doctor ou pas, lorsque l’on essaye de convaincre mes compatriotes «il faut intervenir ! c’est inadmissible ! il faut désarmer les … ! » (je ne me rappelle plus qui les bavards prétendaient désarmer cette fois), l’on n’a pas le droit de faire mine d’ignorer que cela donne la mort, par la traçante de mon Lebon ou par la mitraille de mon Papéétoha ou par la terrible efficacité de l’artillerie.
« Désarmer » c’est un joli mot, mais si les intéressés ne sont pas d’accord, on désarme un cimetière. Que les parleurs assument leurs paroles comme nous assumons nos actes.
Lorsque, pour s’abriter soi-même, craignant les critiques faciles, l’on complète la mission d’intervention par : «faites de la dissuasion ! ne faites pas usage de vos armes !
—- m’enfin, euh …?
—- bon, d’accord, mais seulement pour vous défendre. »
Alors ça devient de la folie.
Cette folie nous en sommes capables, s’il le faut : je vous l’ai montré. Mais que l’on s’interdise ensuite de nous insulter.
Insultes avec intentions politiciennes, en France même, venant de l’opposition et de ses sympathisants : un « déferlement de calomnies », l’expression n’est pas de moi, elle apparaît dans les débats parlementaires. Je ne vous répète pas ces calomnies, si elles vous intéressent vraiment vous pourrez les trouver dans les archives.
Nous étions en première ligne : c’est l’endroit où c’est le plus facile de nous tirer dans le dos.
Heureusement, la stabilité émotionnelle est l’une des qualités que nous cultivons.
Heureusement … ? Oui et non. Nous devrions nous intéresser aux tireurs dans le dos.
Pour cela aussi, les temps ont maintenant changé : la profession dispose de retraités pugnaces et sans complexes. Elle en disposera de plus en plus parce que l’abolition du Service Obligatoire a rendu le métier plus conforme au caractère des hommes et femmes d’action. Ceux-ci et celles-ci passeront volontairement dans l’armée une partie plus ou moins courte de leur vie, mais une partie passionnante et inoubliable créant un sentiment d’appartenance. Puis ils et elles se chargeront, pour leurs jeunes camarades occupés ailleurs, de riposter aux tentatives de tir dans le dos.
A la fin de cette journée à Njédaa, nous avons tous acquis trente utiles secondes d’expérience professionnelle et bien avancé dans notre mission. Mais l’insécurité locale reste potentielle ou peut-être réelle. Nous devons nous assurer que la zone en est complètement débarrassée. Notre destination c’est Abéché. Demain nous retournerons à Ati pour reprendre la configuration qui convient au trajet qu’il nous reste à parcourir : encore deux jours de piste poussiéreuse avec étape à Oum Hadjer.
Nous avons profité de la fin de journée pour faire bouillir de l’eau avant la nuit : les lueurs de nos feux dans la nuit pourraient permettre à l’ennemi, s’il est encore combatif, d’ajuster des tirs contre nous.
Bonne idée d’avoir apporté quelques marmites au lieu de toutes les laisser à Ati, je n’y aurais pas pensé. Les villageoises ont bien voulu tirer de l’eau pour nous, en rigolant doucement de voir les Frani incapables de faire avancer leur âne.
Notre organisation pour la nuit est très simple : à peu près la même que celle de l’après-midi. On continuera de surveiller la lisière à tour de rôle. On profitera de la clarté de la nuit sans nuages mais on regrettera l’indisponibilité des lunettes à intensification de lumière. Quelques armes ennemies nous ont peut-être échappé cette nuit-là, mais assez peu je suppose parce que les musulmans d’ici redoutent de mourir la nuit : c’est un malheur qui condamne leur âme à errer éternellement dans les ténèbres sans trouver le chemin du paradis. Nos tirs, sans les lunettes à intensification de lumière, ne peuvent être que des coups à côté parce que nous ne voyons que des silhouettes, nous ne voyons pas si l’homme est porteur d’une arme ou non. Mais nos tirs sont probablement assez dissuasifs après la démonstration de l’après-midi et mes gars voient peu de silhouettes se risquer dans leur secteur de tir.
Bien sûr, j’aurais préféré que nos lunettes à intensification de lumière fussent en état de marche. Elles auraient, dans l’imaginaire des brigands, parce qu’ils ne connaissent pas encore ce matériel, fait de nous des sorciers capables de voir à travers la nuit. Ce sera pour une autre fois.
Pour dormir, j’ai demandé à Jambon de me trouver le meilleur coin. Il comprend aussitôt ce que je veux dire : non pas tellement l’endroit le plus confortable, mais celui où je serai abrité des tirs s’il s’en produit et où l’on pourra facilement venir me chercher si l’on a besoin du capitaine. Où l’on pourra aussi garer la jeep pas trop loin et accessible, pour que je puisse rapidement me trouver près des postes de radio qu’elle porte. La section de commandement assure la surveillance proche et la veille radio.
Mon repas de ce soir est constitué du même menu diététique que celui de ce matin : je mange trois biscuits de l’Intendance trempés dans de l’eau bouillie. Il faudra par la suite que j’améliore mon alimentation et celle des gars, avant que nous subissions des carences qui nous affaibliraient. Pour commencer je mangerai mieux demain, jour de « remise en condition des matériels et des personnels », sauf événement imprévu.
Je m’allonge sur le sol, roulé dans une toile. Jambon s’assoit par terre, le dos contre un mur, pas loin. D’après lui, et j’approuve, une compagnie ne doit pas perdre son capitaine. Il passera la nuit comme ça, ne dormant que d’un oeil, tenant son arme sur les genoux. Il s’est déjà équipé d’une kalachnikov qu’il a soigneusement inspectée et nettoyée, il a rendu son pistolet-mitrailleur MAT49 à Mouillerat, mon armurier auvergnat qui a noté la restitution, détaillée comme il faut, dans son carnet.
Pour moi, le sol est dur mais ça ne me dérange pas pour dormir : la baisse du taux d’adrénaline aidant, je passe ma meilleure nuit de sommeil depuis longtemps. Vieillir comme ça de trente secondes, le contrecoup détend les nerfs : épuisé. Et puis, ma Première est maintenant une compagnie de vrais guerriers qui connaissent les trente secondes et sont aimés de l’Archange, alors pourquoi me ferais-je du souci ? J’aimerais me remémorer les mots exacts :
« Les armes peuvent remuer au fond des cœurs la fange des pires instincts, proclamant le meurtre, nourrissant la haine, déchaînant la cupidité, écrasant les faibles, soutenant la tyrannie. Pourtant, si Lucifer en a fait cet usage, on les a vues aux mains de l’Archange.
De quelles vertus elles ont enrichi le capital moral des hommes ! Par leur fait, le courage, le dévouement, la grandeur d’âme atteignirent les sommets ».
(Charles de Gaulle in Le fil de l’épée)
Il fait grand jour quand on me réveille avec un petit bol de café chaud et sucré : on ne pouvait pas allumer du feu pendant qu’il faisait nuit. Curieuse impression au réveil de voir et de se rappeler qu’on a dormi dans les environs d’un certain nombre de cadavres de la veille. On comprend alors qu’un tel voisinage n’est pas réellement un problème. C’est par ce genre de constatation, s’ajoutant au contact de drames humains véritables comme la rencontre avant-hier avec le berger dépossédé de son troupeau, donc ruiné, et hier les villageoises manquant d’une eau qui est vitale, que l’on s’aperçoit que nos préoccupations quotidiennes de civilisés sont principalement constituées de petits problèmes futiles voire fictifs.
Si une griffure sur votre carrosserie vous pourrit la vie, ou si vous êtes désespéré parce que le tableau d’avancement vous a un peu oublié, alors vous êtes loin de la réalité.
D’où, au retour en France et aussi longtemps que tous ces souvenirs restent vivaces dans la mémoire, c’est-à-dire définitivement, une inévitable incompréhension de la part des autres passagers de l’omnibus. Les casaniers ont l’explication trop facile à notre sujet : avec tout ce qu’ils ont vu, il sont un peu décalés, ça se comprend. On pourrait en dire autant de tous ceux qui ont choisi de vivre quelques situations exceptionnelles : médecins sans frontières, scientifiques en mission, journalistes de guerre, coopérants, tous ceux qui, d’une profession ou d’une autre, ont « roulé leur bosse ».
L’incompréhension des casaniers pourrait nous inciter à ne fréquenter que nos alter-ego, ceux qui ont connu des situations assez identiques et peuvent comprendre. Un tel isolement serait une erreur et une faute. Faisons l’effort d’admettre que des problèmes que nous analysons désormais comme futiles ou fictifs sont considérés comme réels par la plupart de nos voisins.
[1] Avant le départ de Bretagne, j’ai un instant aperçu les adieux que lui faisait sa femme, par hasard et parce qu’elle ne se cachait pas beaucoup. Je comprends qu’il ait envie de revenir vivant.
[2] Etoile de Vermeil. La scène est imaginaire mais le personnage ne l’est pas : nous l’avons rencontré à N’Djaména, où il est venu nous visiter, appuyé sur sa béquille, pour nous montrer son « étoile de merveille ». Il a tenu à nous chanter « la Marseillaise » pour nous encourager ou nous remercier d’être venus. Nous avons repris en chœur, avec le clairon.
[3] Toutefois, dans une autre situation, par exemple avec risque de snipers, je porterais la même arme que mes hommes pour que ma fonction ne soit pas identifiée.
3. Stabilisation
31. Le pony-express sahélien.
Retour de Njédaa vers Ati, dans un tout autre état d’esprit qu’à l’aller.
A Ati, ré-arrimage de tout le matériel dont on s’était allégé, réhydratation par consommation d’eau bouillie à volonté, achat de vivres frais sans oublier de marchander.
Le Capitaine Kersaho vient me voir, tenant à la main quelques papiers dactylographiés : « Le colonel m’a chargé de rédiger son rapport de la bataille d’hier. Lis et dis-moi ce que tu en penses. » Il me tend ses papiers, que je prends. En plusieurs endroits, la frappe a transpercé les feuilles, les « o » sont remplacés par des trous, mais c’est lisible. « J’ai tapé ça sur une machine que j’ai trouvée par là, et je ne suis pas dactylo », m’explique-t-il. Je lis.
En dépit de la présentation, le rapport est net et clair : c’est ce qu’on demande à un rapport, n’est-ce pas ? Pas de fioritures, Kersaho n’est pas un littéraire, sa formation est scientifique. Un jour, à Vannes, il m’a expliqué la théorie d’Einstein. C’était parti d’une blague idiote que j’avais faite mais qu’il avait prise au premier degré. J’avais dit « moi, la vitesse de la lumière, ça me dépasse ». Alors Kersaho m’avait expliqué e=mc2 aussi facilement que d’autres vous expliquent que 2 fois 2, c’est pareil que 2 plus 2. Einstein, trop fort pour moi, je n’avais rien compris. J’avais seulement retenu que Kersaho m’expliquait une théorie qui lui semblait parfaitement limpide. C’est le genre de gars en face de qui je me dis que le Bon Dieu aurait été sympa de faire le même effort pour moi et de me doter moi aussi d’une intelligence performante. J’avais arrêté les explications de Kersaho quand il avait commencé de vouloir me démontrer pourquoi la théorie d’Einstein était contestée, à juste raison selon lui, par les partisans de la théorie quantique.
Mais nous sommes à Ati, préfecture du Batha, et j’oublie la théorie d’Einstein : je constate qu’aujourd’hui le rapport de Kersaho rend bien compte des faits, mais que parfois sa façon de voir le déroulement des événements ne correspond pas exactement aux impressions que j’en ai gardées. Toutefois, dans l’ensemble et pour l’essentiel je suis d’accord. Je lui restitue son papier en lui disant tout ça.
Ce rapport n’était pas confidentiel et rien n’aurait justifié qu’il le fût : nous agissons en votre nom , nous n’avons rien à vous cacher. Mais le Ministère ne l’a pas publié, se contentant de démentir le frolinat, par un vieux réflexe de rétention de l’information qui datait peut-être de l’Affaire Dreyfus ou de la Drôle de Guerre. La loi du 17juillet 1978 sur la liberté d’accès aux documents administratifs n’existait pas encore en juin 78. En ne communiquant pas ce rapport à la presse, le Ministère obligeait celle-ci à tenter de s’informer à de mauvaises sources : les communiqués du frolinat et les racontars de gens qui n’y étaient pas.
Et voici les nouvelles que vous recevez :
De nos jours, l’ambiance est moins crispée au Ministère et à l’état-major : le principe de rétention systématique de toute information semble avoir été aboli. Les infos se trouvent sur internet : opérations extérieures, site officiel
Ce jour-là, à Ati, la nouvelle de la bataille de Njédaa est connue et chacun prend bien conscience de la contradiction entre les nouvelles que radio-frolinat tente de propager et la réalité des faits.
Je ne sais pas exactement comment les vraies nouvelles circulent par ici, mais le système est au point : par les bergers nomades et les commerçants, je suppose, d’autant que la sécurité de leur circulation vient d’être nettement améliorée. Mais quand j’ai mieux connu le pays par la suite, j’ai souvent vu aussi des cavaliers, seuls ou à deux, passer à bride abattue : le pony-express sahélien.
Toujours est-il qu’aujourd’hui la nouvelle se propage dans le pays, qu’elle est à Ati où l’on voit les Frani tranquilles et qu’elle est en cours de diffusion dans notre zone d’intérêt : les frolinat de Njédaa ont été mis hors d’état de nuire.
Cependant j’écoute radio-frolinat, parce que ses mensonges ne sont pas à négliger. C’est ainsi que « j’apprends» qu’hier à Njédaa le frolinat a courageusement pris l’initiative d’une bataille contre les mercenaires néocolonialistes français, que les vaillants combattants de la liberté ont abattu huit avions-jaguars français, qu’en ce moment-même à Njédaa cinquante-trois mercenaires français sont encore encerclés (je me souviens avec exactitude, trente ans plus tard, de ces chiffres de huit et cinquante-trois sans savoir d’où la propagande les a sortis) et que l’on conseille gentiment à ces braves mercenaires, d’une voix doucereuse, de se rendre. Il ne leur sera fait aucun mal parce qu’avec le frolinat, nous sommes entre collègues combattants. Des frères d’arme, ose-t-il affirmer.
Hier à Njédaa, je n’avais bien sûr aucune sympathie pour ces pauvres bougres que nous désarmions en les tuant. Mais aucune haine non plus. Aujourd’hui à Ati, en écoutant le propagandiste de radio-frolinat, je ressens contre ce parleur, bien à l’abri derrière son micro hors de notre zone d’action, et d’ailleurs hors de notre mission, un profond dégoût qui est probablement proche de la haine. Dégoût et mépris parce qu’il incite des pauvres bougres à se transformer en bandes prédatrices de ce pays nécessiteux et à s’en faire tuer.
De nos jours, au 21ème siècle, raconter ce genre de propagande d’une autre époque ne présente plus qu’un intérêt anecdotique parce que les choses ont maintenant beaucoup changé. En Afrique aujourd’hui chaque village dispose, m’a-t-on dit, d’une télé-satellite qui capte toutes les chaînes, les mêmes que vous captez chez vous car nos satellites géostationnaires émetteurs ne peuvent pas stationner ailleurs qu’au dessus de l’équateur : pour être captées en Europe nos télévisions doivent stationner à 36000 km au-dessus de la portion d’équateur qui nous concerne, ce qui les place au-dessus de l’Afrique.
Bien qu’elle n’ait plus guère d’intérêt de nos jours, je vous raconte cependant cette propagande d’autrefois car elle m’a permis d’apprécier un principe qui me semble valable partout et à toutes les époques : il faut toujours bien comprendre la mentalité locale.
Radio-frolinat m’apprend ce jour-là, ainsi qu’à tous ses auditeurs, que le colonel français a été tué hier au cours de la bataille. Je me demande alors d’où vient ce mensonge et je me souviens qu’hier, quand explosaient au-dessus de nos têtes les obus de 106 dont je vous ai parlé (« assommants » au plein sens du terme), le colonel ayant un peu tardé à me répondre à la radio m’a expliqué qu’il avait « pris un coup de 106 derrière les oreilles ». Le frolinat a capté cette communication et s’est empressé de diffuser et répéter à l’envi la nouvelle de la mort du colonel. Décès dont je me suis fait un respectueux devoir d’informer aussitôt le décédé, avec une nuance d’insolence amusée je l’avoue.
Mais la suite du mensonge concernant la mort du colonel vaut d’être connue, c’est un truc qui peut encore servir. Je vous la raconterai après l’arrivée à Abéché.
32. L’Hadjeraï
Encore une journée de piste à bouffer de la poussière dans un paysage semi-désertique qui n’a pas reçu une goutte d’eau depuis presque un an. Nous sommes partis d’Ati ce matin, nous arriverons à Oum Hadjer ce soir.
Nous roulons quand soudain la nuit tombe, en plein jour : chaque conducteur est obligé de s’arrêter sur place à cause de ce crépuscule inattendu et bizarre que les phares ne peuvent pas éclairer, l’air étant chargé de poussière. Le vent nous met des claques. C’est une tempête de sable. Dans la lumière crépusculaire, le vent est violent, désordonné et cinglant de sable. Mieux vaut stopper aussi les moteurs pour ne pas encrasser les filtres. Une poussière très fine pénètre partout, y compris sous le chèche. On respire le moins possible, on entrouvre à peine les yeux, les moustachus ont du sable plein leur moustache et il y en a dans toutes les oreilles (… qui a dit « les portugaises ensablées » ?). Cela dure plusieurs minutes, peut-être dix ou quinze.
Un climatologue, quelques années après, m’a appris que du sable saharien est emporté par le vent jusqu’aux Antilles. Je me suis souvenu de toute cette poussière puissamment aspirée par le ciel et je n’ai pas été étonné qu’elle aille aussi loin (et vous zot’, à Marie-Galante, si vous retrouvez mon chapeau vous seriez gentils de me le rendre).
La tempête passée, on reprend la piste mais lentement car elle est effacée. Le ciel reste jaune et filtre en jaune le rayonnement du soleil.
L’on en viendrait à espérer la pluie, comme tout le monde par ici en ce moment, bien que l’on sache qu’il faut arriver à Abéché avant qu’elle commence à tomber parce que la boue nous empêcherait de rouler avec nos véhicules surchargés.
Une tempête du même genre, un an plus tard, a tué mon bon camarade le Capitaine Pierre Cerutti en rattrapant son hélicoptère sans être précédée d’aucun signe annonciateur. Impossible de voler ni même de se poser dans cette crasse opaque parcourue de vents brutaux en tous sens.
Etape à Oum Hadjer, ville principale d’une région qu’on appelle l’Hadjeraï et qui présente une sympathique particularité : elle produit des instituteurs. La plupart des instits tchadiens (et aussi dans les pays voisins je suppose, car les frontières administratives sont un peu théoriques dans ces pays sans administration), la plupart des instits, m’a-t-on dit, sont Hadjeraï.
A Oum Hadjer, Jambon m’intéresse encore une fois : il me présente et me recommande un homme jeune, un gaillard un peu moins grand que les basketteurs américains mais avec une voix douce qui est inattendue dans une telle carcasse, un gaillard que Jambon connaît « depuis euh… mais ce serait trop long à vous raconter ». Il propose que je l’embauche à mon service « comme ‘boy’ et comme interprète parce qu’il connaît toutes les langues de la région ». Un ‘boy’ m’arrangerait bien, en effet, non seulement pour résoudre les questions pratiques comme le lavage de mon linge et ma couture, mais aussi pour qu’il fasse mes achats en ville quand nous serons à Abéché.
De plus un interprète, connaissant les politesses locales, me sera utile quand nous irons patrouiller dans des coins un peu reculés, car nous serons au fin-fond de l’Afrique ex-française, regardez la carte de l’Afrique. Pour moi ce sera comme de débarquer sur une autre planète : alors avec l’aide de mon interprète, le contact sera le moins maladroit possible.
De fait, par la suite nous sommes allés dans des coins plutôt isolés, comme celui-ci au-delà d’Am Zoer : curieuse impression que d’avoir en face de vous un homme qui vous regarde, effrayé sans motif, le visage gris et tremblant de peur de la tête aux pieds sous sa djellaba, comme si vous étiez un extra-terrestre. J’ai demandé à mon boy-interprète pourquoi cet homme, qui semblait par ailleurs très normal, était effrayé. Il lui a parlé et m’a expliqué que cet Africain n’avait jamais vu de Blanc. Heureusement que mon Hadjeraï était là : son comportement et ses paroles ont rassuré.
Mais pour l’instant nous sommes à Oum Hadjer où nous n’effrayons personne. Avant d’embaucher mon Hadjeraï comme boy-interprète, je ne veux pas le piéger : du fait que j’ai un peu appris dans les livres d’Histoire la mauvaise habitude qu’ont depuis longtemps les gouvernements français de retirer leurs troupes sans prévenir et de lâcher nos amis outre-mer, j’avertis le candidat : je ne sais pas combien de temps je reste au Tchad, je ne connais pas la suite de l’aventure et il devra peut-être, s’il se compromet avec nous, dans quelques semaines ou quelques mois se sauver en courant. Il accepte cette perspective et Jambon me dit « ne vous en faites pas pour lui, il s’en sortira toujours ». On convient, avec l’aide de Jambon, d’un salaire qui me paraît exagérément bas mais il est d’accord. Pas idiot, le jeune homme, j’ai compris son idée par la suite : l’essentiel pour lui, c’est d’être embauché et ensuite il trouvera d’autres employeurs dans la compagnie pour arrondir sa paie.
Il porte des gri-gri protecteurs en collier, comme tout le monde par ici, mais je me suis aperçu plus tard que c’est un « esprit fort » : il m’a dit « il ne faut pas trop croire aux gri-gri ». C’est la version hadjeraï de mon « ne rien laisser au hasard » et du « la chance ça se mérite » du colonel. Il ne faut pas trop croire aux gri-gri, c’est un principe salutaire.
Son nom complet prendrait ici la longueur de deux lignes à écrire, mais ça commence à peu près par Ben Ar… etc. Alors quelqu’un propose de l’appeler « Bernard », comme le deuxième prénom catholique du Président du Gabon. L’intéressé est d’accord et ça l’amuse (mais on n’a pas demandé au Président). Chez les Frani, mon boy-interprète s’appellera donc Bernard. Il embarque dans l’un des camions de la section de commandement où on lui fait une place, et ça roule.
33. « Se plier aux circonstances »
Dernière étape : de Oum Hadjer jusqu’à Abéché. C’est le bon moment pour vous parler de mes vingt conducteurs : ils ont maintenant 800 km de piste sans accident depuis N’Djaména, y compris un détour par Njédaa que Bison Futé n’aurait pas conseillé. Mais tenez-vous bien : douze d’entre eux n’ont pas le permis, y compris mon propre comptable-conducteur. C’est qu’avant le départ de Bretagne le temps a manqué. On a fait ce qu’on a pu, sachant que la connaissance du code de la route n’était pas indispensable où nous allions.
Il me manquait des conducteurs parce qu’au retour du Gabon, comme je vous l’ai dit, trente-cinq de mes hommes étaient en fin de contrat. Parmi eux, douze conducteurs que la Base Arrière n’était pas en mesure de me remplacer. J’ai donc demandé à l’école de conduite du Régiment (l’Adjudant-chef Dutilleul et quatre moniteurs) de faire en moins d’une semaine une formation adaptée pour douze de mes gars que je désignerais parmi les volontaires après que le toubib aurait vérifié leur aptitude médicale. Vu l’urgence, pas question de leur faire passer le permis. On ferait au retour le complément d’instruction indispensable pour le permis. Dutilleul et moi avons défini le minimum que mes futurs conducteurs devaient savoir : manipuler le véhicule (volant, vitesses, frein, éclairage, tout-terrain…), lire le tableau de bord, vérifier et compléter les niveaux avant de démarrer (eau, huile et lockeed, graissage, pneus…), changer une roue et quelques autres impératifs pour la conservation du matériel et pour arriver à destination sans accident ni panne. Pour le reste (atteler une remorque, nettoyer ou changer les filtres, enrouler du chiffon autour des durites pour empêcher les vapor locks…), le Sergent Ben Chemak et son équipe de mécaniciens feraient un complément d’instruction « sur le tas » au Tchad.
L’Adjudant-chef Dutilleul et ses moniteurs ont gagné le pari et nous n’avons eu aucun accident pendant les quatre mois de séjour, y compris dans les situations d’urgence. Après le retour, mes conducteurs ont reçu un complément d’instruction chez l’Adjudant-chef Dutilleul, ont appris le code de la route et l’usage du clignotant, puis ils ont passé le permis. Sans trop de problèmes pour la pratique.
34. Les gars du Ouaddaï
Arrivés à Abéché, il s’agit d’organiser un séjour qui doit durer.
Dans mon souvenir actuel, Abéché est une ville-préfecture qui ressemble à Ati, mais sans les arbres et avec plus de sable.
Nous installons la compagnie dans un bâtiment officiel abandonné. Nous recrutons quatre personnels locaux qui seront chargés de nous faire manger correctement. Comme Bernard, ils arrondissent leurs revenus en lavant du linge ou en faisant de la couture pour qui leur demande de le faire. Notre alimentation est enfin équilibrée, ou à peu près. Alimentation locale en partie : à la saison des pluies, on aura parfois un hors d’œuvre de sauterelles grillées.
Aucun problème pour acheter de la viande, l’élevage nomade est la principale activité économique et les patrouilles des Frani de Njédaa dissuadent les pillards. En fin de saison sèche, le bétail dans la région doit se contenter de peu, mais la pluie est pour bientôt.
L’intendance nous fait livrer, par les avions réguliers d’Air-Tchad qui ne craignent plus de se faire descendre depuis la bataille de Njédaa, des boîtes de légume par dix kilos. Mais ne croyez pas qu’on nous en fait cadeau : nous devons les acheter collectivement, ce qui exige d’organiser une comptabilité. Du fait qu’une petite partie de notre solde nous est également livrée, le comptable en retire ce qui correspond à l’alimentation. La tâche m’incombe de vérifier inopinément le travail.
Je vous disais « aucun problème pour acheter de la viande ». Cependant le service de l’intendance tient à nous expédier, et donc à nous vendre à son prix, des boîtes de corned-beef. Des stocks à écouler avant qu’ils soient périmés, probablement. Dans cette opération, je pourrais écrire un gros bouquin sur le seul sujet des insuffisances de la logistique (nourriture, matériel, administration, et le plus grave : santé et même munitions) mais c’était il y a trente ans, l’armée française était presque exclusivement tournée vers un hypothétique danger venant de l’est de l’Europe. De nos jours, comme je vous le disais plus haut, l’état d’esprit a changé et je crois que ça ne présente pas d’intérêt, sauf à titre anecdotique, de parler encore de nos problèmes de logistique de l’époque.
En revanche, je vais maintenant avoir le plaisir de vous raconter une scène qui vaut le coup d’être connue et refaite à l’occasion. Vous vous rappelez qu’après la bataille de Njédaa, radio-frolinat s’est vantée d’avoir tué le colonel, ce qui a bien fait rigoler celui-ci.
Peu après l’arrivée à Abéché, ma jeep roule derrière celle du colonel. Voyant sur le côté de l’avenue une bande de jeunes qui auraient le profil d’être des recrues pour le frolinat, le colonel fait arrêter sa jeep à leur hauteur et il leur dit : « viens ici, viens me toucher le bras, touche mon bras ». Ils approchent. L’un d’eux touche le bras, puisqu’on lui dit. Alors le colonel, changeant de ton, profère une mise en garde terrible : « Mais attention à toi, je suis mort ! C’est radio-frolinat qui l’a dit : je suis mort ! Tu as touché mon bras, mais je suis mort, c’est radio-frolinat qui l’a dit ! » Ils reculent vivement, effarés d’avoir approché un fantôme. Le choc émotionnel les fera peut-être réfléchir aux mensonges du frolinat.
Et le colonel-frani-qui-est-mort (et qui de plus me semble assez content de sa sinistre plaisanterie) dit à son conducteur d’avancer.
Le frolinat vient encore de perdre quelques combattants.
Dans ma jeep, on est morts de rire.
La suite du séjour fut ennuyeuse comparativement à son début en fanfare, mais il n’y avait pas lieu de s’en plaindre du fait que c’était la marque d’une mission réussie.
Le frolinat semblait s’être volatilisé, dans tout le Tchad. Pourtant nous avons beaucoup ratissé la région, questionné les habitants, les bergers, les voyageurs, les commerçants : frolinat, profil bas. Nos véhicules maintenant allégés étaient peu gênés par la boue. La saison des pluies faisait verdir le paysage. Nous circulions avec précautions parmi les champs de mil dont la récolte cette année se ferait sans crainte.
A Adré, frontière du Soudan (le Darfour, c’est ici), la frontière est invisible. L’une de mes sections l’a franchie sans le savoir. La section s’en est aperçue parce que derrière elle un homme filiforme, habillé d’un large short, d’une chemise ouverte et d’une casquette trop grande, était sorti d’une cabane en courant et levait ses bras qu’il agitait vigoureusement. Un douanier. Non francophone, car nous entrons dans l’Afrique ex-britannique (voyez l’histoire du Capitaine Marchand et du conflit de Fachoda en 1898, très édifiante). L’homme à casquette anglophone a quand-même réussi à se faire comprendre et à expliquer le problème. « Ah, bon ? Excusez-nous, sorry. On fait demi-tour.»
Vous me direz peut-être que de nos jours, cela ne risque pas d’arriver parce qu’on a le GPS. Ouais, hmm, mais je crois qu’il faut encore maintenant accepter un risque d’erreurs topographiques et savoir travailler aussi sans GPS. Non seulement parce que ça peut tomber en panne ou être brouillé localement par des contre-mesures peu coûteuses, mais surtout parce que c’est un système états-unien.
Il peut nous arriver de faire une opération qu’un gouvernement états-unien, ou un lobby influent, voudrait nous voir louper. Décaler soudain le GPS de cinq cents mètres au-dessus de notre zone d’action, c’est faisable par le propriétaire du système ou par ses employés, qui seraient corrompus pour l’occasion (make money). Et je vous ai montré par exemple l’importance de 500 m pour le fantassin appuyé par un tir d’artillerie. De même, mieux vaut que les bombes de notre aviation tombent où elles doivent tomber et pas sur nos moustaches un jour où le GPS se décale par surprise. Alors, mes jeunes camarades, si vous ne négligez pas la boussole, la règle-rapporteur, la calculette, le crayon de bois et la topographie « à l’ancienne », sans GPS, vous me faites plaisir.
Non par nostalgie mais par prudence.
Ma compagnie fut remplacée et rapatriée en septembre. Jusque là, il est encore intéressant d’évoquer aujourd’hui la difficulté pour l’encadrement d’entretenir la vigilance des hommes alors que nous ne faisions jamais de rencontres hostiles. L’utilité de notre présence n’était plus directement perceptible.
Il est encore intéressant aussi d’évoquer ma section tchadienne. La ville d’Abéché comporte une petite garnison de l’armée tchadienne. Peu après notre arrivée, quelques militaires tchadiens se présentent un par un à nous. Ils nous demandent d’être intégrés dans nos rangs.
Pour ma part, je les prendrais volontiers en copiant le système de l’amalgame qui fut en vigueur dans nos armées peu après la Révolution (c’est un épisode qu’on n’a pas le droit d’ignorer quand on a un lieutenant qui s’appelle Kellermann, même s’il se surnomme « le chat maigre »). Le colonel préfère ne pas pratiquer l’amalgame dans les circonstances où nous sommes : nous allons plutôt créer une section entièrement tchadienne avec un encadrement pris dans ma compagnie et ça me fera une section supplémentaire. On n’a pas appris ça à l’Ecole, mais on a appris à s’adapter.
Le colonel prend contact avec les autorités tchadiennes pour que notre recrutement ne soit pas interprété comme un débauchage. De mon côté, je désigne dans ma compagnie les gradés qui encadreront cette section. Vous devinez qui sera le chef de cette section : Jambon, bien sûr. Il n’a pas la totalité des brevets et certificats officiels pour être chef de section en Europe, mais ici il fera parfaitement l’affaire. C’est un meneur d’hommes, en dépit de son allure physique qui est très loin de tous les stéréotypes en la matière. Son autorité résulte de sa compétence. Jamais il ne hausse le ton : lorsqu’il élève la voix, c’est seulement pour qu’elle passe dans le bruit ambiant. Chez nous, on ne gueule pas, on communique : des info, des décisions.
Il me faut aussi trois chefs de groupe, c’est-à-dire des gradés capables de commander un groupe de dix hommes car nous avons l’habitude qu’une section soit formée de trois groupes. J’ai dans ma compagnie quelques caporaux-chefs qui commandent des équipes de quatre hommes mais qui sont un peu sous-employés dans cette fonction parce qu’ils ne détiennent pas encore tous les certificats et brevets nécessaires pour être chef de groupe. Je les retire donc de leur équipe, dans laquelle un nouveau chef d’équipe est désigné, qui n’a pas lui non plus tous les brevets voulus mais qui devra s’y mettre.
Et voici mes trois nouveaux chefs de groupe pour la section du sergent-chef Jambon : le caporal-chef Ansquer, un solide Breton du Guilvinec (vous savez : en passant par Pont-Labbé, au Pays Bigouden), le caporal-chef Rigot et le caporal-chef Surville. J’ai choisi des vrais gaulois, en évitant les gars des dom-tom, parce que je sais qu’en général les Africains ne s’entendent pas bien avec ceux-ci, je ne sais pas pourquoi. Félix Eboué, Guyanais devenu gouverneur de l’Afrique équatoriale française, était un cas particulier. Il est vrai que la Guyane elle-même est un cas particulier, peut-être parce que elle est en Amérique du sud, juste en face.
Après l’encadrement, ce n’est pas tout : le matériel. Certes je n’ai pas à me soucier de fournir des armes, car ces militaires tchadiens viendront chacun avec sa kalachnikov et ses munitions. La kalachnikov est le fusil d’assaut le moins cher sur le marché international de l’armement, l’armée tchadienne en est donc massivement pourvue. Mais il me faut des véhicules. C’est facile avec les camions dont on nous a fait cadeau à N’Djaména et qui ont transporté notre matériel : ils sont maintenant disponibles, j’en affecte deux à la section tchadienne. Ce sont de vieux GMC américains des années 40, mais on a pu les amener jusqu’ici, ils pourront bien continuer encore leur service : la débrouillardise de mes mécaniciens se confirme tous les jours, avec l’aide du forgeron local (lui, ne vous inquiétez pas : il a déjà prévu de récupérer du métal après le départ des Frani). Et même si leurs bricolages ne sont pas toujours parfaitement conformes au manuel (… quel manuel, où ça ?), ça marche et ça tient.
Parmi les militaires tchadiens qui se présentent, Jambon en choisit trente. Ses critères de base sont le tonus et aussi le regard direct (j’ai les mêmes critères : si vous êtes mou, ou si votre regard est sournois, votre place n’est pas avec nous). Il veille également à panacher les ethnies dans la mesure du possible : pour qui connaît l’Afrique comme Jambon, les cousinages de chacun sont évidents au premier coup d’œil. Début d’apprentissage pour nos volontaires tchadiens : quand on est chez les Frani, l’ethnie n’est pas un critère valable.
Un jour j’ai vu arriver l’un de mes Tchadiens au volant d’un blindé soviétique que ses chefs mettaient à notre disposition. Par « blindé soviétique », n’imaginez pas l’un de ces chars lourds modèle T72 ou T62 qui se sont rendus tristement célèbres en mettant fin au Printemps de Prague, avant d’être imités à Tien-An-Men, mais il s’agit quand même d’un transport de troupe blindé modèle BTR152. Je connais ce matériel pour l’avoir étudié à l’Ecole, sur fiches techniques et sur photos. Mais je n’imaginais pas qu’un jour j’en aurais un dans ma compagnie. Dans ce métier, il faut s’attendre à tout, savoir s’adapter et prendre les moyens qui se présentent : si vous êtes psychorigide, ce métier n’est pas pour vous.
En parlant de psychorigide, j’en ai une bien bonne à vous raconter. Vous vous rappelez que ma compagnie dispose de deux mortiers de 60 dont on nous a fait cadeau à N’Djaména et que leurs munitions ont été épuisées à Njédaa. Autant dire qu’actuellement mes mortiers de 60 ne peuvent servir à rien. Mais je pense que l’on pourra sûrement me réapprovisionner en obus de 60 parce que c’est du matériel français dont certaines de nos unités sont équipées. Je sais qu’il y a quelques petits stocks de ces munitions à N’Djaména, comme dans plusieurs de nos bases en Afrique et en France. Je passe donc commande de quelques caisses d’obus de 60. Mais l’on refuse de m’en livrer parce que (écoutez bien) « parce que vous avez des mortiers de 60, c’est un fait, mais normalement votre compagnie n’est pas équipée de ce type de matériel ; je ne vous fournirai donc pas des munitions pour un armement qui ne correspond pas à votre équipement réglementaire ». Tel quel ! L’auteur de cette stupidité, je me rappelle parfaitement son nom mais je ne vous le dis pas.
Mon problème a cependant été résolu peu après : les officiers tchadiens de la garnison d’Abéché, ceux qui me prêtaient des hommes et le BTR152, ayant entendu parler de cette histoire d’obus de 60, m’en ont proposé quelques caisses. J’ai envoyé le sergent Mouillerat prendre en compte ces munitions, ça m’a coûté une caisse de bières en échange mais ça ne m’a pas privé parce qu’à l’époque je ne buvais que de l’eau.
Après que sa section est constituée, Jambon commence par l’instruction qui nous semble la plus importante : l’instruction du tir, c’est-à-dire la précision et la modération du tir. La précision dépend du calme et de la discipline que le tireur sait s’imposer, tous les bons tireurs vous le confirmeront pendant que les mauvais tireurs ne peuvent plus rien vous dire : à Njédaa, la nervosité des frolinat leur fut fatale.
La modération du tir est, elle aussi, une question de calme et de discipline : le modèle de kalachnikov en service ici est équipé, sur son côté gauche, d’un levier qui est un sélecteur à trois positions avec tir coup par coup, tir par rafale de trois, tir par rafale libre. Jambon n’autorise que le tir coup par coup, n’autorisera pas le tir en rafale libre qui vide un chargeur en quelques secondes (la cadence étant de 600 coups par minute, un chargeur de 20 cartouches est consommé en 2 secondes, le calcul est simple), mais il autorisera exceptionnellement, dans certaines circonstances et sur sa propre décision avant d’aborder un terrain à surprises, le tir par rafale de trois.

le Sergent-chef Jambon et quelques uns de nos volontaires tchadiens, sur le BTR152. Ne vous fiez pas aux apparences : intégré à la Première du Grand Trois, ce groupe qui semble folklorique est réellement bien encadré. (photo : Gildas Sonnic)
Après l’apprentissage du tir, l’apprentissage de la manœuvre : je ne tiens pas à ce que ma compagnie intègre une section qui se comporterait n’importe comment sur le terrain, surtout qu’ici on ne travaille pas avec des cartouches à blanc comme en France, on travaille à balles réelles et je ne veux pas d’accident.
Mes Tchadiens se révèlent être des tirailleurs excellents : à condition que les formations, c’est-à-dire la disposition des hommes sur le terrain, ne soient pas trop compliquées ils exécutent très proprement les changements de formation. Marcher en changeant de formation, en ligne (côte à côte) ou en colonne (à la file indienne), en gardant des distances convenables et sans que l’arme ne soit pointée sur un voisin, sans doigt sur la gâchette, ne pose plus aucune difficulté après quelques exercices.
Ces formations sont prises par chaque groupe de dix hommes et ensuite on s’occupe de la disposition des trois groupes : en triangle, groupes successifs, groupes accolés. Ceci permet de s’adapter au terrain, prêt à réagir au mieux au dispositif ennemi que l’on risque de rencontrer.
Toutes les sections d’infanterie françaises savent faire ça pour se déplacer en positionnant selon le terrain les différentes armes qui n’ont pas toutes les mêmes portée, puissance, cadence, effet, utilisation : pistolet-mitrailleur, fusil-mitrailleur, lance-roquette anti-char, fusil à lunette, lance-grenade. Mais me voici avec une section d’infanterie un peu particulière parce que toutes ses armes sont identiques. J’utiliserai cette section notamment lorsqu’il s’agira de fouiller des zones buissonneuses où nos armes plus puissantes ou à plus longue portée n’ont pas leur meilleure utilité.
Mais comme je vous l’ai dit, nous n’avons plus fait aucune mauvaise rencontre, la préparation est restée sans application au combat. Cette préparation a cependant présenté l’intérêt d’associer étroitement à notre action des Tchadiens qui le voulaient. Comme pour le recrutement de mon interprète (vous vous souvenez : l’Hadjeraï surnommé « Bernard »), nous avons d’abord pris la précaution de les prévenir du caractère provisoire de notre présence au Tchad. Lors de notre relève en septembre, nos successeurs ont pris en charge cette section dans les mêmes conditions que nous. Elle a réintégré la garnison tchadienne d’Abéché en mai 1979 quand les militaires français ont reçu l’ordre de quitter le Ouaddaï avant de recevoir, en mai 80, l’ordre de quitter le Tchad (ordre qui ôtait à l’opposition, à Paris, l’un de ses arguments). Avant d’y revenir bientôt, plus nombreux (opération manta dès 1983), après que l’opposition, qui avait si fort et si malhonnêtement critiqué notre présence, fut devenue gouvernement.
Encore un mot sur cette section tchadienne. Quelques jours après avoir constitué notre section, nous nous sommes aperçus que ces gars-là avaient faim : ils n’avaient plus touché leur solde depuis des mois. Cela s’explique aisément dans ces pays où, comme chez nous jusqu’au début du 19ème siècle, il n’y a aucune séparation entre l’argent public et l’argent personnel des dirigeants ou de leurs délégués : les crédits, lorsqu’ils passent par l’administration locale, arrivent rarement à destination.
Pour nous, la moindre des choses était de nourrir notre nouvelle section. Nous avons donc commandé à l’Intendance, à nos frais, des sacs de riz par cinquante kilos : c’est ce qu’il y a de moins cher pour caler tous les estomacs. De plus, lors de nos sorties sur ce terrain qui, surtout pendant et après la saison des pluies, n’est pas totalement un désert aride, nous avons chassé : de temps en temps une gazelle, mangée avec du riz, ça vous nourrit une section de fantassins. Et l’on peut même inviter le capitaine à dîner devant le feu de bivouac, en toute simplicité bien sûr. Je viens avec mon opinel.
J’ai d’intéressantes conversations avec ces gars du Ouaddaï. Ils veulent tout savoir du monde extérieur (aujourd’hui je suppose que la télé-satellite répond en grande partie à leur curiosité). Et surtout un thème revient souvent dans leurs propos : il faut arrêter l’indépendance. Nous sommes en 1978 et l’indépendance de nos ex-colonies n’a que 18 ans (1960). Ces jeunes hommes n’ont pas connu la colonisation, ils en ont seulement entendu parler. Avant l’indépendance l’argent public, même s’il y en avait peu, arrivait aux ayant-droit : les tirailleurs touchaient leur petite pension de retraite du combattant et lorsque les pouvoirs publics décidaient de subventionner par exemple une infirmerie, l’argent n’était pas détourné. C’était aussi l’époque où les armes n’étaient pas entre n’importe quelles mains. Voilà les problèmes qui préoccupent mes soldats tchadiens, soldats sans solde mais désormais nourris.
Cette section n’a pas combattu sous mes ordres, mais sous les ordres de mes successeurs : ils m’ont dit qu’elle s’est très bien comportée.
35. Le Connétable de Richemont
Nos patrouilles dans le Ouaddaï nous donnent peu à peu l’occasion de soigner quelques problèmes de santé à notre passage dans les villages. Voici encore un genre d’action où il faut savoir s’adapter et où nous faisons des progrès avec le temps. Parfois les chefs de village, sachant que nous possédons quelques médicaments, nous montrent un homme, une femme ou un enfant fiévreux ou blessé en espérant que nous pourrons faire quelque chose. Mais nos médicaments ne conviennent pas : nous portons sur nous le nécessaire qui nous permettrait d’attendre les brancardiers et des soins en cas de blessure par balle, nous n’avons pas de pharmacie pour les affections qu’on nous présente.
Quelque temps plus tard, la solution nous arrive de notre Base Arrière en Bretagne : dans nos courriers postaux à la Base Arrière, plusieurs d’entre nous, sans se concerter, ont mentionné ce manque de petits médicaments.
Alors la Base Arrière a organisé, avec l’aide de quelques réservistes bretons, une collecte de médicaments parmi les pharmaciens du Pays de Vannes : il s’agit de médicaments inoffensifs comme ceux qui garnissent chez vous vos trousses familiales, genre Mercurochrome, Vitamine C ou sirop. On nous les envoie et je charge mon infirmier, le Caporal Tagliamento, de gérer ce petit stock que nous administrons dans les villages. L’action chimique de ces médicaments est certaine sur des organismes qui n’en ont jamais absorbé, mais je crois surtout que « l’effet placebo » est prédominant. Le Mercurochrome rouge sur et autour d’une plaie désinfecte certainement, mais surtout il remonte efficacement le moral du blessé. De même la magie d’un morceau de cachet qui fait des bulles dans l’eau a toujours beaucoup de succès et probablement une certaine efficacité, non seulement sur le malade qui l’absorbe mais aussi sur son entourage. Et petit truc que l’on n’oublie pas quand on est attentif aux populations locales : le Ramadan, qui est cette année-là de mi-juillet à mi-août, empêche de manger ou boire quoi que ce soit pendant la journée. Insister pourrait gêner, le médicament sera pris plus tard.
Je crois que cette bonne action des pharmaciens du Pays de Vannes, en 1978, est à l’origine du jumelage Vannes-Abéché qui fut officialisé quelque temps plus tard et fonctionne encore aujourd’hui : j’imagine le Connétable de Richemont au Royaume du Ouaddaï.
Il faut être prêt à tout dans ce métier : désarmer violemment et dangereusement des malfaiteurs à Njédaa, ou donner un petit quart de cachet d’aspirine vitaminée à un villageois fiévreux dans le Ouaddaï, ce sont des gestes très différents mais qui font partie de la même mission.
Toutefois, chère lectrice, cher lecteur, je ne voudrais pas que cette distribution de petits médicaments crée un malentendu quant au rôle de l’armée : si la mission consiste à distribuer des médicaments, d’autres que des militaires peuvent le faire beaucoup mieux que nous. Si la mission consiste à désarmer des malfaiteurs, alors nous sommes les seuls à savoir le faire. Distribuer des médicaments pour soulager des gens démunis, pourquoi pas, à condition de ne pas oublier le motif de notre présence : nous sommes ici pour sécuriser la région. La distribution de médicaments, outre qu’elle fait du bien aux habitants, nous permet d’avoir un bon contact avec eux et d’obtenir aisément du renseignement.
Que l’on ne prenne pas les militaires pour des gens à qui l’on peut se permettre de faire accomplir tout et n’importe quoi : depuis quarante ans, quelques notions ont été mal entendues par les décideurs. Par exemple la dissuasion, mot trop souvent galvaudé, ne consiste pas toujours à seulement montrer ses armes : elle consiste à convaincre les gens dangereux que l’on fera, à coup sûr et sans rémission, usage des armes. Et il faut parfois en faire vraiment usage pour que la menace soit prise au sérieux. Autre exemple de malentendu : l’action humanitaire considérée comme exactement synonyme d’action non-violente, c’est confondre le but et les moyens. De même les missions d’interposition que certains voudraient imaginer comme possibles en montrant les armes mais sans montrer qu’elles fonctionnent.
Pas d’angélisme quant au rôle des militaires. Je conclurai tout à l’heure là-dessus car s’il ne reste qu’une seule idée de cette histoire, je voudrais que ce soit celle-ci : le rôle de l’armée est de mettre en oeuvre la violence des armes. Certes nous pouvons faire, à l’occasion, un peu autre chose que de l’action violente. Ma Première l’a fait au Gabon en recherchant un aéronef disparu en forêt équatoriale profonde. Ce genre d’action est acceptable parce qu’il endurcit les hommes, favorise la cohésion de la compagnie et renforce notre efficacité opérationnelle : il aiguise le fil de l’épée. Ici au Tchad, nous avons distribué des médicaments et nous étions contents de pouvoir le faire, mais ce n’était qu’un complément à notre mission principale.
36. Le GMP
Avant que nous quittions le Tchad, j’aimerais vous parler d’un souvenir d’amitié parce que cela fait aussi partie de ce métier.
Je vous ai parlé, au début de cette histoire, de l’escadron du RICM (Régiment d’Infanterie & Chars de Marine) qui était déjà à Abéché avant nous, depuis trois mois. Cet escadron fut bientôt rapatrié et remplacé par un autre escadron du même régiment. J’eus donc le plaisir de voir arriver, à la tête de cet escadron (c’était le 2ème escadron), mon vieux camarade le Capitaine Xavier de Zuchowicz. A trente ans, on peut cependant dire « vieux » camarade car nous nous connaissons depuis dix ans, depuis notre entrée à Saint-Cyr où nous étions dans la même section, avec le même instructeur, le Lieutenant Suty que je vous ai nommé avant l’assaut (dépassez l’objectif !).
Après l’Ecole, j’ai souvent rencontré Xavier de Zuchowicz au hasard de nos affectations et missions. Après le Tchad, nous nous sommes encore suivis : notamment à l’Ecole Militaire à Paris, c’est lui qui m’a suggéré amicalement de faire un DESS à la Sorbonne, conseil que j’ai eu raison d’écouter. J’ai quitté l’armée peu après, mais nous avons gardé le contact et je suis resté informé du développement de sa carrière. Notamment sa nomination, comme colonel, à la tête du RICM (le régiment le plus décoré de l’Armée française), puis sa nomination, comme général, à la tête de la Division d’Infanterie de Marine. Il est aujourd’hui, au moment où j’écris ces lignes, Gouverneur Militaire de Paris (GMP), l’un des dignes successeurs de Joseph Gallieni.
Un mot sur Joseph Gallieni qui est une de nos grandes références de l’Infanterie de Marine : né en 1849, fils d’immigré, formé au Prytanée et à Saint-Cyr, il fut blessé à Bazeilles en 1870, étant sous-lieutenant au Grand Trois. Il prit sa retraite après une carrière dans l’Infanterie de Marine dont il avait assimilé toutes les qualités. Rappelé à l’activité au début de la Première Guerre Mondiale, il fut alors nommé Gouverneur Militaire de Paris. En septembre 1914, le Général Joseph Gallieni rassura les Parisiens en proclamant, pendant que le gouvernement se repliait vers Bordeaux : « j‘ai reçu le mandat de défendre Paris contre l’envahisseur, ce mandat je le remplirai jusqu’au bout ». Puis il sauva la situation avec ses célèbres Taxis de la Marne. Le Grand Trois y était. Au cours de ses campagnes dans l’Infanterie de Marine, Joseph Gallieni avait appris à « se plier aux circonstances » : j’y reviendrai plus loin ( § 37).
Je vous parle de cette amitié avec Xavier de Zuchowicz pour vous dire que vous ne perdez jamais les amis dont vous méritez la considération à Saint-Cyr : récemment, en 2005, ils viennent de m’apporter un formidable soutien moral dans une épreuve que j’ai traversée difficilement après que j’ai survécu de justesse à un grave accident de santé. Mais on n’échappe pas indéfiniment à la mort : cette idée a sans doute déclenché ma décision d’écrire l’opération tacaud que j’avais jusqu’à présent peu racontée.
Ecrire avant que mes souvenirs, qui peuvent être utiles, disparaissent avec moi. Si vous avez participé à une opex, je vous suggère maintenant de l’écrire.
Longtemps très minoritaires à l’intérieur de l’armée, ceux des opex ont trop peu raconté leur expérience. Je vais vous dire pourquoi.
37. Les « bons principes »
Dans l’armée elle-même, les opex qui ont débuté en 1978 ont suscité un phénomène sociologique banal mais dommageable : les militaires se sont spontanément partagés en deux catégories, ceux qui avaient fait une opex et ceux qui n’en avaient pas fait.
Dans les popotes des régiments et dans les réunions toujours amicales des promo de Saint-Cyr ceci ne donnait lieu, au pire, qu’à d’inoffensifs brocards.
Mais dans les états-majors, le malaise était profond : une situation se reproduisait qui avait déjà existé un siècle plus tôt, situation que Charles de Gaulle décrit magistralement dans son livre « la France et son armée », livre d’Histoire où un passage concerne les expéditions outre-mer à la fin du 19ème siècle:
« Ces expéditions ont, dans l’ordre tactique, un caractère très spécial. L’adversaire, le terrain, les moyens, ne ressemblent guère à ceux d’une guerre européenne. Aussi les ‘ métropolitains’ ne se font-ils pas faute d’affirmer que l’Armée d’Afrique et l’Infanterie de Marine y perdent les bons principes.
Pourtant, la vie des postes et des colonnes entraîne les chefs à se plier aux circonstances. Tenir le terrain dans un bled sablonneux et lointain, c’est une excellente école d’initiative et d’énergie. A la lisière de la dissidence, on doit savoir se renseigner, se fortifier, se garder, combattre. Au sein d’une nature farouche, il faut sans cesse lutter pour vivre, endurer des climats épuisants, vaincre le vertige de la solitude. Et quelles épreuves comporte, pour le caractère, le coup d’œil, l’art de se faire obéir, la manœuvre de ces détachements qui poursuivent, à marche forcée, des succès toujours révocables, à travers les terrains incroyables qu’offre l’Afrique à l’embuscade des adversaires ! »
Un siècle plus tard, dans nos états-majors des années 1980, régnaient de nombreux officiers supérieurs qui, étant entrés dans l’armée à la fin de la guerre d’Algérie, atteignaient maintenant un haut grade avec vingt ans de service sans avoir jamais entendu un coup de feu ailleurs que sur un champ de tir. Ces gens essayaient, sans vraiment y parvenir, de se persuader eux-mêmes de leur supériorité professionnelle au motif qu’ils avaient suivi les cours de l’Ecole Supérieure de Guerre non loin des pieds de la Tour Eiffel, études théoriques fondées sur des situations imaginaires extrapolées des combats blindés de la Seconde Guerre Mondiale. Tout en les confortant dans leur système stratégique abstrait, ces études leur servaient de dérivatif à l’ennui des manœuvres stériles et formatées dans les camps militaires de la Champagne Pouilleuse.
Déjà anciens mais définitivement inexpérimentés, ils étaient des stratèges en chambre ignorant pour toujours les fameuses trente secondes. Ils n’existaient à leurs propres yeux que fixés dans leur certitude, acquise par cooptation mais sans la moindre validation de circonstances réelles, d’être les Gardiens des Bons Principes. Valorisés par leurs dogmes, ils supportaient mal de coexister avec des jeunes officiers ayant vu et vécu autre chose, pour la plupart Infanterie de Marine et Légion, bardés de décorations témoignant d’actions concrètes et efficaces dans des contrées dangereuses où eux-mêmes n’iraient jamais vérifier, au contact de la réalité, les théories et axiomes qu’ils révéraient.
Leur compétence, qui n’était que virtuelle, leur donnait cependant deux pouvoirs réels. Le pouvoir d’ajouter le tampon rouge diffusion restreinte sur tout rapport et tout mémoire qui ne leur semblait pas conforme. Le pouvoir aussi de décerner ou d’infliger des notations : ils évaluaient leurs subordonnés à l’aune de leurs propres critères où les distinctions méritées en opex étaient de peu de valeur, voire suspectes d’hérésie.
Porter ses décorations sur l’uniforme est réglementaire, obligatoire. Mais raconter qu’on les a méritées en réussissant des missions parfois périlleuses et toujours problématiques, c’est autre chose : c’est interprété, lorsque cette évocation se fait sur fond de rivalité de générations, comme une insolence inacceptable. C’est pourquoi les officiers de ma génération, comme aussi celle de mes lieutenants, ont acquis et transmis la mauvaise habitude de ne pas raconter les opex, narrations susceptibles d’être retournées contre eux pour démontrer qu’ils avaient « perdu les bons principes ». Les principes qui avaient fait le succès de Tacaud, et notamment le principe de s’adapter aux circonstances, n’étaient pas les bons : à l’école supérieure de guerre la victoire décisive de Njédaa méritait un zéro pointé. Un assaut avec des véhicules non blindés, cela ne se fait pas.
Cette restriction forcée après les opex est regrettable car, pendant tout ce temps, une utile accumulation d’expérience fut perdue : l’analyse technique des constatations faites par les uns et les autres sur terrain n’intéressait pas les états-majors ni l’enseignement militaire supérieur.
L’expérience resta à l’intérieur des régiments concernés où les officiers se concertèrent pour élaborer quelques recommandations concrètes, nouvelles et de bon sens qui pourraient être utiles en vue de futures opex. Ces travaux, pour ne pas être censurés, ne furent que rarement transmis aux échelons supérieurs. Quand ils le furent, la transmission ne fut suivie d’aucune réaction ni réponse. Ainsi les régiments et notamment le Grand Trois (ceux qui y étaient se souviennent de nos travaux de groupes) tirèrent rapidement tout le profit possible de leur expérience, mais ne purent le faire que pour eux-mêmes.
Cependant ils étaient tenus de continuer de s’exercer prioritairement pour une guerre hypothétique en Europe comme le montrent les directives opérationnelles et les thèmes d’exercice de l’époque. L’hypothèse d’un envahisseur venant de l’est continuait de dominer la doctrine. Encore un an avant la fin du bloc soviétique, alors que celui-ci chancelait visiblement et que le mauvais état des armées du Pacte de Varsovie était connu, l’on continuait de s’exercer à aller prêter main-forte à l’armée ouest-allemande sur son territoire (manœuvre « moineau hardi », 1988). Pendant ce temps notre attention se détournait de ceux qui avaient vraiment besoin de nous et que nous pouvions vraiment sécuriser : l’Afrique Noire.
En dépit de la réalité, l’hypothèse officielle d’engagement des forces restait celle d’une guerre défensive et longue contre le Pacte de Varsovie. Dans cette ambiance irréaliste, l’expérience des opex ne fit que tardivement l’objet d’études ouvertes et organisées.
Il aurait pourtant été utile, et urgent, de faire étudier par l’enseignement militaire supérieur, qui aurait pu proposer des solutions, les problèmes que nous avions connus et qui restaient à résoudre : notamment celui de l’ouverture du feu quand on n’est pas en guerre déclarée.
à Abéché :
le Ouaddaï est devenu paisible pour quelques mois
(photos Patrick Langöhrig)

Les visites habituelles de cette autruche, nommée Gertrude, témoignent de la tranquillité retrouvée.
38. La relève
Ma Première du Grand Trois a quitté Abéché et le Tchad en septembre 1978 dans une situation devenue calme, mais nos successeurs au contraire ont fait quelques rencontres hostiles. Je n’étais pas inquiet pour nos successeurs : ils étaient comme nous du Grand Trois, c’était la 3ème compagnie, où le Capitaine d’Athis qui la commandait à Njédaa avait passé le commandement à mon camarade le Capitaine Lhuillier, un trompe-la-mort bagarreur sous un air bonhomme et jovial.
Le caporal Nativel, qui avait été rapatrié pour être hospitalisé après avoir été blessé à Njédda, avait été muté à la 3ème compagnie après guérison et revenait avec la 3, porteur de la Médaille Militaire.
Ce sont des avions réguliers d’Air-Tchad qui nous ont transportés d’Abéché à N’Djamena pour le retour. Ils volaient tranquillement à une altitude de 2000m. C’est une altitude où les missiles anti-aériens SAM7, quand il y en a, sont très efficaces et dangereux.
Je n’étais pas habilité à contester le choix du niveau de vol parce que je n’avais aucune autorité sur l’exécution pratique de la prestation, chacun son métier, mais j’espérais que nous avions bien pris au frolinat la totalité de ses satanés missiles anti-aériens ou que plus personne ne voulait s’en servir.
39. Soyons clairs
En France, pendant ce temps et par la suite, nos opérations extérieures eurent un effet très positif : à partir de 1978, la Défense nationale, ses moyens, son organisation redevinrent un sujet d’attention.
Dans les années 70 et jusqu’en 1978, la Défense et l’armée étaient des sujets rarement abordés dans les débats politiques.
Lors de la campagne présidentielle de 1974, pas un seul mot à ce sujet : regardez les archives. Pas un seul mot, à l’exception, dans le journal ‘Le Monde’, d’un article écrit par un officier sous anonymat pour dire qu’il faudrait en parler. C’est tout, aucun écho à cette unique prise de parole sur le sujet.
L’état d’esprit a beaucoup changé maintenant et je situe en 1978, car il y eut d’autres opérations que le Tchad (il y eut Kolwesi et Beyrouth), le point de départ d’une saine évolution. Si l’on compare la campagne présidentielle de 1974 et les suivantes, l’on s’aperçoit que, au contraire de 1974, les campagnes présidentielles suivantes n’ont pas totalement ignoré les questions militaires.
Peut-être certains candidats font-ils semblant et se contentent-ils d’essayer de cacher à l’électorat leur incompétence et leur manque d’intérêt pour le sujet. En 2007, presque tous et chacun leur tour, ils en disent quelques inquiétantes énormités qui passent trop souvent inaperçues. Mais ce qui est positif, c’est que la question n’est plus complètement éludée.
A Paris à partir de 1978, nos interventions extérieures faisaient débat : c’est une excellente chose en soi quand ça ne va pas jusqu’aux calomnies que nous avons connues et quand ça ne nous fait pas prendre des risques supplémentaires en interférant dans le déroulement de nos opérations. Mais la détermination du gouvernement était amoindrie par sa crainte de la critique à mesure qu’approchait l’élection présidentielle de 1981. En parallèle à la timidité parisienne la violence revint et augmenta au Tchad, plusieurs mois après l’épisode que je vous ai raconté.
On était en fin de règne à Paris. Les prétendants à la succession, flattant tous les préjugés minoritaires récupérables pour totaliser leur courte majorité, qualifiaient de « néocolonialiste » notre intervention (le même vocable que le frolinat dans ses communiqués, je vous invite à consulter les documents de l’époque). Cette attitude affaiblissait la volonté de notre gouvernement qui se sentait en situation précaire. Ceci ne pouvait qu’encourager les distributions d’armes et la création de bandes malfaisantes.
J’insiste sur les dommages que fit le flou de nos « décideurs » politiques. Je souhaiterais maintenant qu’un de mes camarades prenne à son tour la parole pour raconter ce que je n’ai pas connu : comment on réagit lorsque l’on se fait tirer dessus avec interdiction de riposter.
Une telle interdiction, qui fut respectée, abuse de notre discipline et de notre maîtrise. Le concept de « dissuasion » n’est pas extensible à toutes les situations, sauf dans les déclarations des parleurs qui ne savent pas ce qu’ils disent. Mais parleurs écoutés, malheureusement.
Notre présence militaire ne peut pas être « dissuasive » si nous montrons que nous ne voulons pas utiliser nos moyens. Dans un pays troublé, une présence n’est rien de plus qu’une présence : une cible inerte n’a jamais fait peur à personne. L’intervention militaire ne fonctionne pas si les fauteurs de troubles ne sont pas violemment et visiblement sanctionnés.
La violence dont les Frani, avec compétence, surent faire la démonstration à Njédaa rendit aux populations tchadiennes leur sécurité pour plusieurs mois, sécurité qu’elles ont de nouveau perdue quand il est devenu clair que la volonté nous manquait.
Lorsque l’on envoie, ou que l’on maintient, une unité de l’armée dans une zone de tension c’est pour y faire quelque chose, obtenir un résultat par les moyens de l’armée : les armes.
L’armée est faite pour, s’il le faut et aussitôt qu’il le faut, au nom de la France mettre en oeuvre la violence des armes.
Avec compétence.
« On ne dit rien de la cathédrale si l’on ne parle que des pierres » (Antoine de Saint-Exupéry)
… Avec compétence. L’indispensable compétence n’est pas seulement technique, elle est aussi et surtout morale.
Vous, mes chers camarades qui êtes comme moi maintenant retirés du service des armes, j’ai écrit cette histoire en pensant à Monsieur Lebon, cet ancien de la Coloniale qui a enseigné à son fils, jeune caporal de l’Infanterie de Marine, tout ce qu’il savait du métier.
En pensant aussi aux capitaines, aux lieutenants, aux sous-officiers et aux soldats qui maintenant sont à notre place.
Certes, les situations que nous avons connues ne se reproduiront pas à l’identique. Cependant les expériences que nous avons vécues contiennent quelques enseignements qui sont encore valables.
Des enseignements que nous sommes seuls à détenir, parce qu’ils ne se trouvent ni dans les rapports officiels, toujours schématiques, ni dans la presse, informatrice mal informée, ni dans les épopées impressionnistes qui sont fabriquées et vendues quand l’événement est encore chaud. C’est un Triangle des Bermudes où la vérité se perd. Nos jeunes n’y trouvent pas les références vraies dont ils ont besoin. Racontez-leur les épisodes dont vous pouvez témoigner.
Il ne s’agit pas de divulguer nos petits secrets professionnels, qui sont parfois des trucs très dangereux, ni d’allonger encore la liste des « histoires de guerre ». De fait, nous n’avons participé officiellement à aucune guerre : nous avons seulement, dans l’omnibus de Saint-Exupéry, pris un ticket que nos jeunes camarades ont pris à leur tour. Pour le mieux possible savoir où ils vont et pour y aller sans erreurs, il leur faut trouver toutes les références que leurs prédécesseurs peuvent leur donner. Ils choisiront celles qui leur conviennent.
Notre rôle est maintenant de témoigner non seulement de quelques savoir-faire qui peuvent être encore utiles mais surtout des valeurs humaines sur lesquelles notre armée, qui est la plus ancienne et la plus respectable du monde, fonde sa force.
Racontez. Votre mission n’est pas terminée.
Achevé d’écrire sur l’île de Molène (Finistère)
mars 2007 Yves Cadiou
« Les officiers du roi, après vingt ou trente années de service, se retirent dans leur province, capitaines, majors, lieutenant-colonels, avec la croix de Saint-Louis, plus ou moins perclus de blessures et d’infirmités, mais riches de souvenirs glorieux et pittoresques qu’ils racontent à leurs neveux et rédigent volontiers. »
(Charles de Gaulle in La France et son armée)
« Au nom de Dieu, vive la Coloniale ! »
(le Révérend Père Charles de Foucauld, missionnaire,
un jour où il était en difficulté avec une tribu locale, voyant arriver à son secours les unités coloniales.)
4. D’autres témoignages sur Tacaud
par l’Amicale du 3°RIMa, association 1901
http://pagesperso-orange.fr/amicale.3rima/index1.html
Je remercie l’Amicale du 3ème RIMa, qui a fait appel à ses adhérents pour m’envoyer les documents et les photos qui réhaussent ce récit. Les envois étaient souvent accompagnés de témoignages personnels, que je publie ici avec l’autorisation de leurs auteurs, dans l’ordre chronologique où j’ai reçu ces témoignages.
41. Le témoignage de Patrick Langöhrig
Lors de l’épisode que j’ai raconté ici, Patrick Langöhrig avait dix-huit ans à peine, il était l’un des plus jeunes de la Première du Grand Trois. Par la suite, en 1979, Patrick Langöhrig est revenu à Abéché avec la Première dont j’avais passé le commandement, mon temps étant terminé. Puis en 1980 le Caporal Langöhrig était à N’Djaména. Voici le témoignage qu’il m’a adressé :
“J’ai participé à l’opération tacaud 78/79/80 : 78 et 79 Abéché et 80 N’Djaména.
J’étais dans cet assaut sur Djedda, je n’ai jamais oublié ces moments.
J’ai pris et gardé ces photos du Tchad, car c’est vrai que sortant de chez papa maman, de notre petit chez soi douillet, on ne s’imagine pas ce qui se passe dans ces pays. Ce qui m’a choqué lorsque l’on s’est arrêtés dans l’un de ces villages que l’on traversait pour rejoindre Abéché, et bien une femme s’est approchée de notre camionnette sur les genoux, ayant les deux jambes coupées, pour nous demander à manger. Je peux vous dire que cela impressionne et fait réfléchir. Et aussi quand on voit des petits gosses fouiller les poubelles pour manger.
Durant le deuxième de mes trois séjours, j’étais aussi là à Abéché lors de la bataille de mars 1979. Nous avons dû rester dans les trous de combat pour nous protéger pendant 3 jours parce que nous nous sommes fait beaucoup canarder. Mais malheureusement notre ami Jolibois a été touché mortellement par une rafale.
Lors d’une mission en direction de Faya-Largeau, j’ai été invité avec deux autres camarades chez une famille dans un village, très sympathique et très accueillante, ils nous ont fait partager leur repas, « le mil ». Pour dormir, pas de matelas ni rien, seulement une plaque de pierre un peu surélevée pour s’écarter des insectes rampants et venimeux.
A N’Djaména en 1980, nous avons protégé les civils jusqu’en mai quand les rebelles ont pris la Ville. Nous nous sommes retrouvés coincés entre deux feux, car nous étions des petits groupes éparpillés dans la Ville et c’est là que mon chef de groupe a été blessé grièvement. Nous l’avons évacué dans la villa à côté avec l’aide de l’adjoint et deux autres camarades, car la maison où nous étions était devenue un vrai gruyère et pouvait s’effondrer. Ils ont profité de la situation pour nous canarder. Nous avons contacté le QG qui se trouvait à l’aéroport pour venir nous dégager. Après maintes tractations avec les belligérants, nous avons eu une escorte pour traverser la Ville et rejoindre l’aéroport. Nous avons dû cacher nos armes car ils n’auraient pas hésité à nous tirer dessus.”
Patrick LANGöHRIG
Patrick Langöhrig fut cité pour cette action à N’Djaména en 1980. Voici un extrait de sa citation : « Soumis pendant plusieurs heures à des tirs très violents, il a toujours su garder son calme. Il s’est porté volontaire sans hésiter pour dégager le sous-officier adjoint, blessé gravement, alors que celui-ci était sous le feu. »
Aujourd’hui, Patrick Langöhrig est amicaliste du 3°RIMa, porte-drapeau et secrétaire de la section anciens combattants de Tronville-en-Barrois, en Lorraine.
42. Le déminage
Pendant quelques mois après la bataille de Njedda, le frolinat se fit discret. Cependant il eut recours aux mines, qui estropient et tuent au hasard. C’est facile, c’est pas cher et ça ne rapporte rien. Ce méfait procède seulement de la volonté de martyriser les habitants pour créer un problème qui déconsidère les autorités. C’est une forme de terrorisme.
Je n’ai pas beaucoup vécu cet épisode dont la plus grande partie s’est déroulée après le rapatriement de ma Première. Le souvenir personnel que j’en ai gardé, c’est cette impression bizarre que l’on ressent lorsque l’on roule en jeep en pensant que quelques instants plus tard l’on sera peut-être mort dans une explosion, sans même avoir le temps de le savoir ni même peut-être avoir le temps d’entendre l’explosion.
Chaque instant prend une valeur démesurée parce qu’il pourrait être le dernier. Je suppose que cette impression bizarre, c’est ce que l’on appelle « la peur ». A la longue, ça devient très désagréable. Mieux vaut dominer cette impression qui, de plus, ne sert à rien et empêche de réfléchir clairement. Conserver ses facultés en dépit du danger, cela s’apprend : ça fait partie du métier.
Je ne peux guère vous en dire plus sur mon expérience vécue des mines. Je laisse donc la parole à mon camarade le Capitaine Gildas Sonnic, qui peut en parler parce que les événements le placèrent au cœur du problème.
Voici le témoignage du Capitaine Gildas Sonnic :
Tous unis face aux mines
Août 78 : Les FAN (Forces Armées du Nord) sont ralliées, l’ANT (Armée Nationale Tchadienne) s’est bien reprise, nous avons opéré dans toute la région. Nous sommes les principaux acteurs de la sécurité du Ouaddaï.
C’est dans cette ambiance que se produit le premier incident « mines », qui va nous ramener à plus de réalisme et d’humilité. Pendant six mois, nous vivrons avec cette menace, au hasard des explosions, qui d’ailleurs ne nous épargneront pas.
13 Août 78 : une Land-Rover saute, 3km est de Biltine, 4 morts 7 blessés. Notre toubib fonce avec un hélicoptère Puma au secours des blessés.
20 Août 78 : Opération Ibis sur Biltine. Dès notre arrivée, un renseignement nous oriente vers la présence possible d’un bouchon de mines. En effet, sur de vagues traces de véhicule, le vent a découvert, en deux endroits, une forme plate. En fait, rapidement on en fait apparaître cinq. Voulant savoir, je décide d’en relever deux et de détruire les autres.
Après établissement d’un périmètre de sécurité, je me mets au travail avec mon couteau. Le sol en sable herbeux me permet de dégager le pourtour et la poignée de portage.
Trois quarts d’heure de tension et de transpiration sont quand même nécessaires. Une petite marche arrière du camion « lot 7 », câble déroulé à fond, extrait complètement l’engin. Pour la deuxième ça va plus vite et, pétardage terminé pour détruire les trois autres mines, nous abritons les deux mines récupérées, non encore désamorcées, au centre de notre bivouac. Le problème est maintenant de les neutraliser.
Un message est lancé sur le réseau Tacaud, et sur le « téléphone arabe ». Un Sergent-chef spécialiste du 17ème Régiment de Parachutistes nous arrive de la Capitale. Son verdict : il n’a jamais vu ce type de mine et veut détruire les deux, tout de suite. On le renvoie à N’Djaména, et on décide, avec « Zuco » (Xavier de Zuchowicz, le capitaine du 2/RICM), d’attendre 24 heures avant de détruire ces mines qu’il faudrait d’abord identifier pour en connaître les caractéristiques.
Le lendemain vers midi, un groupe de combattants Goranes (les FAN : Forces Armées du Nord) se présente. Un des hommes, à l’uniforme fantaisiste, prétend avoir la compétence attendue. Il a peut-être 16 ans, sans doute un collégien de Faya-Largeaud. Une fois sur les lieux, très sûr de lui, il s’empare d’une des mines. Je bloque son geste et entame un dialogue qui devient vite surréaliste :
-Attends garçon, tu as fait l’instruction sur la mine ? as-tu déjà touché ou seulement vu une mine ?
Regard furieux de l’intéressé :
-Si tu as peur, vas derrière le rocher !
-Un capitaine français n’a jamais peur [1], tu devrais le savoir.
Je reste pour le regarder faire, en me disant que j’ai peut-être eu tort de jouer au brave mais que « noblesse oblige ».
Et noblesse gagne. Quinze secondes après, le plateau de pression est dévissé et le gamin brandit le dispositif de mise de feu :
-ça, c’est la « goupille » !
-C’est bien ! Alors donne-moi la « goupille » !
Le visage du gamin s’éclaire, puis il rigole franchement, content de lui : cette fois c’est lui le professeur. Sauf qu’en fait sa prétendue « goupille », c’est le détonateur, un machin très chatouilleux. Mais je crois que ce n’est pas exactement le moment de lui expliquer. Je lui expliquerai plus tard, en faisant attention de ne pas le vexer.
Fièrement il refuse toute récompense. Heureusement nous avons un appareil-photo polaroïd et il repartira très satisfait avec le cliché de la victoire. Il a sûrement cette photo encore aujourd’hui,… s’il est en vie. S’il n’a pas été tué par une « goupille ».
Les engins sont envoyés sur Paris. Quelques temps après nous recevons une fiche détaillée. Il s’agit d’une indétectable de 6,5 kg de charge, mise en œuvre simple, pas de piège pré-installé. Bon à savoir si on en trouve d’autres !
Epilogue moins glorieux : lors de mon bref séjour en France fin 78, je ferai un contact à l’EAG (école du Génie, à Angers) pour prendre conseil, et j’y découvrirai que mon indétectable du Ouaddaï est très bien connue ici, un exemplaire est en vitrine au musée des mines de l’école. Le spécialiste du 17ème Régiment Parachutiste avait probablement manqué la visite… On lui pardonnera : la menace officielle c’était l’Europe de l’Est, à l’époque. Pas les brigands tchadiens avec du matériel venant de n’importe où. A Biltine j’aurais dû penser, tout de suite, qu’une mine carrée était… belge.
Face à cette nouvelle menace, l’état-major réagit et nous fait parvenir des lots de tapis anti-mines datant, sans doute, de l’Algérie…et des mines de toutes sortes. Autant dire clairement que pas une des mines que l’état-major nous a fait livrer n’est sortie de son emballage. Il n’était pas question pour nous de risquer des pertes civiles.
Et ce, contrairement au camp d’en face : en effet, entre le 13 août 78 et le 4 février 79, dix-neuf explosions ont été répertoriées, occasionnant 16 tués (8civils dont 3 enfants) et 37 blessés (19 civils). Nos alliés tchadiens, FAN et armée tchadienne du sud, ont été durement touchés.
Pour nous tous qui étions en charge, à des titres divers, de la sécurité du Ouaddaï (FAN, forces tchadiennes du sud, détachement français), cet épisode nous a solidarisés face à la menace invisible. Notre honneur nous a préservés de la tentation d’employer la même méthode pour piéger les repaires et itinéraires des brigands. Nous n’étions pas autorisés à les attaquer, mais étant bien renseignés par la population et les photos aériennes, nous savions où ils étaient. Nous n’avons pas utilisé nos mines parce que la méthode des mines est dangereuse pour les habitants.
Gildas SONNIC
[1] Laissons au Capitaine Gildas Sonnic la responsabilité de cette affirmation concernant la peur des capitaines. Affirmation trop générale, mais valable pour lui (note du Capitaine Yves Cadiou).
Chère lectrice, cher lecteur, à la suite du témoignage de Gildas Sonnic permettez-moi d’appeler votre attention sur deux points qui me semblent importants.
D’abord je voudrais vous faire observer l’admirable courage qui se cache sous des phrases apparemment toutes simples comme « nous découvrirons cinq mines » ou comme « je me mets au travail avec mon couteau ». Pour découvrir ces mines qui sont du type indétectable, et dont ils ignorent combien sont camouflées sous le sable de la piste, mes camarades doivent les chercher au risque de déclencher l’explosion. Pour neutraliser ensuite ces mines qui sont d’un modèle inconnu et peut-être piégées, c’est encore au risque de déclencher l’explosion.
Je voudrais aussi vous faire observer que pour mes camarades sur le terrain, ainsi que pour moi-même lorsque j’y étais, il s’agit ici d’aider une population insécurisée. Peu nous importent alors la politique et les intentions de ceux qui fournissent les mines, y compris les intentions de cet officier de notre état-major, idiot ou malhonnête, qui veut nous faire riposter aux mines par d’autres mines.
Les mines fournies par notre état-major étaient principalement des mines dites HPD, pour « Haut Pouvoir de Destruction », conçues pour arrêter l’hypothétique invasion blindée soviétique en Europe de l’Ouest. Mines à haut pouvoir de destruction, avec un système de déclenchement très sensible, par rupture d’un fil très fin. Les mettre en oeuvre ici aurait été criminel. Nous n’avons jamais su qui avait pris cette décision ni quelle était vraiment son intention.
Intention pas claire, c’est sûr.
De leur côté les fauteurs de troubles espèrent que « de guerre lasse » nous laisserons les tchadiens se débrouiller sans notre aide ou que, excédés, nous commettrons des fautes qui seraient exploitables à notre encontre et accentueraient l’indécision de la politique parisienne.
Peut-être espèrent-ils aussi, mais à tort on l’a vu, que les militaires français qui sont sur le terrain manqueront de courage et ne sortiront plus.
Sur le terrain, il s’agit de sécuriser la population et l’on se pose assez peu de questions en dehors de cet objectif.
Les directives que nous recevons ne sont pas toujours très claires et l’on pourrait s’interroger sur les processus de décision dans les allées du pouvoir à Paris.
En elles-mêmes les arcanes de la politique parisienne et ses rivalités partisanes nous sont indifférentes, mais nous constatons les dégâts des tergiversations gouvernementales. Au fond le régime des partis nous est indifférent, et même son clientélisme qui en ces années 70 crée des doutes sérieux (après 1981 il apparaîtra que ces doutes étaient trop souvent fondés) quant à la loyauté de certains militaires des états-majors. Les partis politiques parisiens et leurs réseaux ne nous intéressent guère avec leurs antagonismes, accords, perfidies, arrangements, l’opacité des motifs qui tentent d’expliquer des prises de position changeantes dans notre politique africaine à cette époque.
Mais nous constatons le gâchis.
Fin mai 1979, Abéché apprend le départ des détachements militaires français du Ouaddaï. Alors Abéché proteste par une manif francophile le 29 mai 79.
Insérer ici la photo (Gildas Sonnic) de la manif
43. Le témoignage de Yves Bitsch
Lors de l’épisode que j’ai raconté ici, le Sergent Yves Bitsch était l’un des trois chefs de groupe de la Section Bergerot :
Chef de section : Lieutenant Bergerot ;
Sous-officier adjoint : Sergent-chef Takasi ;
Chefs de groupe : Sergent Bruneau, Sergent Bitsch et Caporal-chef René-Aubin.
Voici le témoignage que Yves Bitsch vient de m’adresser :
Le temps a passé très vite et faute de souvenirs écrits de l’époque les lignes qui suivent auront sans doute des erreurs qui j’espère seront minimes et ne dénatureront pas le récit global des opérations. L’opération Tacaud a duré officiellement du 27 mars 78 à mai 1980. Mon témoignage portera sur la seule période de mai 1978. En mai 1978, le régiment a déjà envoyé la 3ème compagnie au Tchad. La 1ère compagnie est en alerte et se prépare à partir pour une mission dont la nature exacte ne sera connue qu’au dernier moment. Mai 78, c’est aussi le moment où de graves événements se déroulent au Zaïre avec la prise de 3000 occidentaux en otage par des rebelles katangais. Nous suivons cela au travers de la presse française. Sur le Tchad, pas grand chose. 19 mai, la Légion saute sur Kolwezi et les opérations de délivrance des otages commencent. Entre temps, la 1ère compagnie s’est préparée (hommes et véhicules) et nous sommes rassemblés à midi pour être présentés au général commandant la Division d’Infanterie de Marine, qui s’adresse à nous pour nous dire deux mots concernant notre mission. Deux heures après, les véhicules partent pour l’embarquement voie ferrée. Les hommes suivront le lendemain. 19 mai, c’est le jour des combats d’ATI où deux hommes du 3 ont donné leur vie. 22 mai, c’est notre date d’arrivée à Ndjamena.
Souvenirs de la 2ème bataille d’ATI en date du 31 mai 1978 (c’est le nom qui lui a été donné quelque temps après en mémoire de nos camarades tombés et aussi en raison de la proximité géographique et temporelle des deux combats). En cours de déplacement vers Abéché qui sera notre destination de déploiement pour notre présence au Tchad au sein d’un EMT aux ordres du chef de corps du 3, nous faisons halte à proximité d’ATI. C’est une halte normale à mi-chemin de l’objectif final pour permettre la remise en condition des hommes et des véhicules. Le soir, réunion des chefs de section et sous-officiers adjoints chez le capitaine. Retour du chef de section qui transmet aux trois chefs de groupe l’information confidentielle de se tenir prêts au cas où, c’est-à-dire d’ouvrir l’œil et d’avoir les armes prêtes pour le déplacement du lendemain matin. Le convoi se met en route vers Abéché et, au bout de une à deux heures de route, la colonne de véhicules bifurque à angle droit et se dirige vers la palmeraie de Djedda. Le jour commence à se lever, la palmeraie est en vue, des coups de feux éclatent. Une sentinelle a aperçu quelque chose et a tiré de surprise. La compagnie se met en ligne de véhicules et avance vers la palmeraie. Arrivées à défilement de véhicules les sections mettent pied à terre et avancent en ligne vers la palmeraie. Les AML du REC sont également présentes et les groupes de la 3ème section s’imbriquent avec elles jusqu’à une distance d’observation et de tir. Le terrain est assez plat et permet difficilement de s’abriter. On peut voir de temps en temps du sable se soulever devant nous (ce sont des impacts de balles). Il fait très chaud. Il faut économiser l’eau jusqu’au soir car le prochain ravitaillement ne viendra pas avant. Un soldat est évacué vers l’arrière, il souffre de déshydratation. J’ai l’oreille collée au poste radio qui nous apprend que le Caporal-chef Nativel vient d’être blessé par balle. On voit la jeep du capitaine amener l’infirmier, le Caporal-chef Tagliamento, sur place. Après les premiers soins le blessé est évacué vers l’arrière. La journée se passe ensuite avec des échanges de tir entre AML et rebelles. De temps en temps un rebelle est aperçu aux jumelles derrière un arbre (même dans l’arbre parfois). Un ordre de tir est donné pour tirer sur lui.
Les avions Jaguar interviennent pour un ou deux passages de tir au dessus de la palmeraie. C’est un grand nettoyage qui fera régner le calme jusqu’au soir. En fin d’après-midi nous effectuons un léger repli de quelques centaines de mètres autour d’un ancien dispensaire (un registre trouvé là indique les motifs d’hospitalisation des patients et la raison de leur départ du dispensaire : guérison ou évasion). La surveillance dure toute la nuit et au matin, la palmeraie est abordée par la compagnie et fouillée.
Le bilan total de cette opération a été effectué par le commandant de compagnie, le capitaine Cadiou. J’ai vu de nombreux corps de rebelles dans la palmeraie abandonnée pendant la nuit par les survivants et de nombreuses armes et munitions ont été récupérées. Les munitions inutilisables ont été détruites par la suite. Après la remise en condition indispensable la compagnie a repris le chemin d’Abéché. C’est seulement après cette opération que le capitaine a réuni tous les cadres pour leur expliquer le pourquoi et le comment de l’opération. La confidentialité s’imposait car tout mouvement étranger était suivi de très près (surtout après les événements d’Ati). Les renseignements donnaient une forte présence de rebelles dans la palmeraie proche (avec sans doute parmi eux des rescapés d’ATI). La proximité de la population locale lors de nos haltes pour ravitaillement était une occasion d’information pour les rebelles. Le «faux départ» précédant la bataille était certainement surveillé et je pense que l’effet de surprise a été total pour eux.
Conclusion : Un moment intense, quelques jours après notre arrivée, qui a contribué encore davantage à souder les soldats. La visite du Secrétaire d’Etat à la Défense quelques jours plus tard nous a laissé le sentiment que la France ignorait tout de ce qui se passait au Tchad car il nous a souhaité « bon séjour ».
Yves BITSCH
Le sergent Bitsch a été cité après Njédaa : « Sous-officier dont les qualités de chef se sont dévoilées lors de l’opération Tacaud. A la bataille du 31 mai, lors de l’abordage et du nettoyage du village, le sergent Bitsch a mené son groupe avec un sang-froid et une efficacité remarquables, contribuant à l’anéantissement de la résistance rebelle. Il s’est montré un chef calme, lucide et courageux. »
Après Tacaud, Yves Bitsch a passé le concours de l’Ecole militaire inter-armes pour devenir officier ; ainsi il a servi comme officier du Génie dans diverses unités parmi lesquelles le 5ème RG à Versailles, la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (la BSPP), le 6ème RG à Angers, le 1er RG à Strasbourg. A partir de 1992, il a orienté sa carrière vers les langues étrangères et les relations internationales : il a ainsi eu l’occasion de servir à Bucarest, mis à la disposition du ministère roumain de la défense. Revenu dans le Morbihan pour son dernier poste, il est maintenant officier supérieur (commandant) au sein de la direction des affaires internationales des Ecoles d’officiers à Coëtquidan. Ces Ecoles, lors de son arrivée dans ce poste, étaient commandées par le Général Bruno Cuche.
Actuellement à la veille de sa retraite qu’il prendra à Vannes, il est membre de l’Amicale du 3ème RIMa : c’est ainsi que je l’ai revu et qu’il m’a proposé son témoignage sur Tacaud.
Son souvenir de Njédaa est un peu différent du mien, mais ces différences n’ôtent rien, en définitive, à la cohérence de notre propos.
Y.C.

Quelques-uns de ceux qui ont fait cette histoire : Première du 3°RIMa , le 14 juillet 1978 à Abéché. (photo : Amicale du 3°RIMa)

Le Caporal Jolibois - Première compagnie du 3ème RIMa - Mort pour la France le 5 mars 1979 à Abéché. (photo : Patrick Langöhrig)
44- Mais d’où viennent donc les « Chats Maigres » ?
Ce surnom qui est aujourd’hui celui de la 3ème compagnie était d’abord le surnom personnel du Lieutenant Pierre Kellermann, affecté en 1977 au Grand Trois, chef de la deuxième section de la Première compagnie (sous-officier adjoint : Sergent-Chef Chapellier).
Pierre Kellermann, dit « Pierrot Kellermann », dit « le gars Pierre » (comme son chant préféré), aimait aussi qu’on le surnomme « le Chat Maigre » : étant franco-vietnamien, né en Indochine française de mère indochinoise et de père métropolitain, ses yeux étaient naturellement bridés ; très sportif, il n’avait pas un gramme de graisse superflue.
D’où son surnom le Chat Maigre.
Il appelait « Chat Maigre » les gens qu’il aimait bien. Le matin, quand il saluait sa section d’un «alors ça va, les Chats Maigres ? », la journée commençait bien.
Ainsi les premiers « Chats Maigres », au Grand Trois, ce furent ceux de la 2ème section de la Première compagnie, en 1977 et 78.
3° Compagnie
Puis le Lieutenant Kellermann fut muté à la 3ème compagnie, adjoint du Capitaine Lhuilier.
Alors la 3ème compagnie devint « les Chats Maigres », comme l’avait été la 2ème section de la Première.
L’insigne de la Trois, plutôt marrant, a été dessiné par l’Adjudant Jack Pellissier : la couleur jaune du chat famélique vient de l’indicatif radio habituel de la compagnie, venant lui-même de la couleur distinctive de son fanion.
Ainsi fut lancée la tradition des surnoms de compagnie. La Deux suivit l’exemple, s’appelant « le club des dunes » après un séjour de quatre mois à Moussoro au Tchad, un secteur spécialement sablonneux.
J’ignore l’origine des autres surnoms et insignes de compagnie, car ils apparurent plus tard, dans les années 80. Certains camarades plus jeunes pourront certainement compléter l’histoire des surnoms et des insignes de compagnie. Y. C.
Document : les cahiers du RETEX sur internet
http://www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/cahiers_drex/cahier_retex/repertoire_typo_2.pdf
Aussi le récit du Général (Armée de l’Air) qui commandait en second l’Opération Tacaud http://armees.darkbb.com/histoire-f25/tacaud-t1483-30.htm Vous y trouverez notamment le passage suivant où il parle de l’avion Jaguar abattu à Djeddaa :
“Le 31 mai, l’Atlantic Aspic Charlie
décolle à 6h00 pour Djedaa ; il ne rentrera que neuf heures trente plus
tard… En effet, à peine est-il arrivé sur zone qu’un accrochage se
produit à l’ouest de cette localité, tandis qu’il signale une forte
concentration rebelle à l’est. Une première patrouille légère de Jaguar
a décollé, suivie d’une deuxième une trentaine de minutes après ; à
8h19, à l’issue de sa première passe canon, lors de son dégagement, en
virage à gauche en montant, Cresson Oscar leader ressent un choc alors
qu’il est à 4 000 pieds, vitesse supérieure à 400 kts ; au même moment,
son équipier signale au moins deux tirs de missiles dans sa propre
direction; en phase de rassemblement sur son leader, il confirme que le
moteur droit est en feu; Oscar leader a pris la direction du petit
terrain d’Ati, ses commandes deviennent inopérantes et il doit
s’éjecter à 8 h 23. Tandis que l’équipier assure sa protection,
l’hélicoptère Puma d’Ati a déjà décollé et peut récupérer le pilote dès
8 h 45 ; il est indemne, et sera ramené à N’Djamena en début
d’après-midi. L’appareil a explosé avant de percuter le sol, ses débris
sont très dispersés.
Je rends compte à Paris par message flash, disant que le Jaguar a été
probablement abattu par SA 7, «mais ceci reste à confirmer », le
ramassage des débris étant programmé pour le lendemain, dans la mesure
du possible. Je suis très surpris d’entendre très vite les chaînes de
radios françaises annoncer qu’un Jaguar a été abattu au Tchad par un
missile !
Pour en terminer avec cette affaire, l’essentiel des débris fut
récupéré le lendemain, et les jours suivants, ramené à N’Djamena, où
nous les avons examinés très soigneusement, sans trouver le moindre
indice d’un impact important ; par ailleurs, nos écoutes montrent que
les rebelles s’interrogent eux-mêmes pour savoir qui aurait réussi ce
tir ! Il reste selon moi
deux possibilités : le moteur a pris feu à la suite d’un tir «heureux »
d’un petit calibre touchant un endroit sensible, ou bien il s’est
produit une crique en raison d’une utilisation soutenue du réacteur
poussé à ses limites dans des conditions climatiques extrêmes. La
question reste ouverte.”
J’ai demandé à M. Guy de Kersabiec, qui est colonel de réserve de l’Infanterie de Marine (il a servi au 6° Régiment parachutiste de l’Infanterie de Marine) et actuel vice-président du Conseil Général du Morbihan, en charge des affaires administratives, de sécurité et de défense, de rédiger « le mot de la fin », la postface.
Ceci parce que M. Guy de Kersabiec a toujours été à nos côtés, à Coëtquidan comme à Vannes.
Son attitude était méritoire en ces années 70, face à des partis politiques d’opposition, minoritaires mais dominateurs, et à leurs sympathisants, qui ne se faisaient pas faute de nous dénigrer en toutes occasions. Ils gardaient sans doute un souvenir amer du voyage à Baden-Baden fin mai 68, voyage qui confirma la loyauté de l’Armée envers le pouvoir légitime. Cette loyauté des militaires envers le gouvernement issu du suffrage universel avait pendant plus de dix ans différé les espoirs de ceux qui, écartés par la démocratie en 1965, avaient cru pouvoir revenir en 1968 par l’émeute.
Je remercie M. Guy de Kersabiec non seulement d’avoir accepté de participer à ce livre en rédigeant la postface, mais je le remercie aussi de sa fidélité dans les moments difficiles.
Y.C.
Postface
de M. Guy de Kersabiec
Vice-président du Conseil Général du Morbihan
Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
Colonel de Réserve de l’Infanterie de Marine
Ami lecteur, après avoir, comme moi, dévoré « opération Tacaud » d’une seule traite, tant la pression et la passion se sont emparées de vous, vous avez un instant fermé les yeux pour engranger au plus profond de votre cœur et de votre âme, toute la moisson de couleurs, de vents de sable, de soif desséchante, de peur tenaillée au ventre, de respect de l’être humain, de fierté du devoir accompli, d’anecdotes amusantes, d’humour, de drames de la vie ou de la mort, de chaleur humaine, d’amitié virile, qui apparaissent tout au long de ces lignes et, dans l’intime de votre réflexion, voulant analyser cette lecture et vos sentiments vous vous êtes posé cette question : cet ouvrage de littérature, cet ouvrage qui nous a pris aux tripes, tout autant qu’au cœur, qu’est-ce que c’est ?
Est-ce un roman d’aventure, habilement bâti à partir d’événements probablement réels et adaptés au style recherché ? Non, ce n’est pas un roman, même si le style en est alerte et vif et si cela se lit véritablement comme un roman.
Non, ce n’est pas non plus un documentaire, même si les descriptions montrent la réalité des événements, avec parfois même une véritable précision chirurgicale.
Non, ce n’est pas plus une autobiographie, même si l’auteur est en même temps acteur.
Non, ce n’est pas non plus un livre politique, même si le sujet des événements relatés est la conséquence directe de choix politiques.
Non, ce n’est pas un livre de psychologie plus ou moins appliquée, même si l’analyse des caractères et du plus intime de soi s’y livre sans fausse honte, avec pudeur et réalisme.
Non, ce n’est pas un livre engagé, plaidoyer belliciste pour la guerre, pas plus que détracteur ou pourfendeur pacifiste des opérations militaires (et de celle-là en l’occurrence), deux attitudes opposées, mais pareillement indignes d’un vrai soldat.
Non, ce n’est pas un livre de gloriole pas plus que de justification, même si l’introspection et l’analyse de l’action sont sous-jacentes derrière chacune des phrases.
Non, ce n’est pas un livre d’ethnologie, même si, au travers des propos, on discerne une profonde et réelle connaissance des peuples, de leurs us, coutumes et traditions.
Non, ce n’est pas… Alors, qu’est-ce que c’est ?
C’est un livre d’amour.
C’est un livre d’amour pour cette Afrique que tout marsouin porte dans son cœur et porte deux fois plus dans son cœur que beaucoup (trop) de nos concitoyens qui l’ignorent, la vilipendent ou la méprisent.
C’est un livre d’amour aussi pour cette Armée qui nous permet, par un engagement volontaire, d’aimer et de servir à plein notre Patrie en lui offrant même, si besoin est, le plus important de nous-même, notre propre vie.
C’est un livre d’amour pour ces hommes ou ces femmes que le Pays nous confie pour accomplir notre mission, mais dont nous sommes redevables et dont nous avons la responsabilité aussi bien physique que morale et qui sont non pas nos subordonnés mais nos compagnons d’armes et notre famille.
C’est un livre d’amour et de respect pour tous ces guerriers, de quelque camp qu’ils aient été et qui, loyalement, ont donné leur vie pour leur Pays, à nos côtés ou face à nous.
Et enfin, c’est un livre d’espoir et d’avenir, ainsi que d’hommage à tous ceux qui nous ont montré le chemin de l’honneur et du sacrifice. C’est à eux que pensait le Général de Gaulle lorsqu’il disait « le souvenir, ce n’est pas seulement un pieux hommage rendu à ceux qui nous ont précédés, mais un ferment toujours à l’œuvre pour l’avenir. »
Guy de KERSABIEC,
Vice-Président du Conseil Général du Morbihan,
Maire honoraire de Saint Brieuc de Mauron
Pendant l’opération tacaud,
le Grand Trois fut cité à l’Ordre de l’Armée.
Le Ministre de la Défense, 25 octobre 1978 :
« Régiment d’élite, au passé prestigieux, le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine vient de donner, une fois encore, la mesure de son courage et de son ardeur.
Engagé en soutien de l’armée d’un pays lié à la France par des accords de coopération, il participe avec succès à plusieurs interventions. Dans des conditions climatiques sévères, il fait preuve d’un allant et d’une ténacité exceptionnels qui lui permettent de déjouer toutes les entreprises d’un adversaire résolu et combatif.
Il ne cesse, depuis, de prendre part à l’action générale d’apaisement sur le territoire de ce pays, assurant la sécurité de zones importantes et protégeant les populations.
Par la valeur opérationnelle et humaine de ses unités, le 3ème Régiment d’Infanterie de Marine se montre le digne héritier des plus belles traditions des Troupes de Marine. »
« Un jour, tout ce que vous avez fait sera écrit »
(Le Général Lagarde, CEMAT,
s’adressant au 3°RIMa après Tacaud)
La reproduction de ce document est autorisée et libre de droits, sous réserve de mentionner la source.
Au contraire la transformation ou l’adaptation de ce document, même partielles, sont interdites ainsi que son utilisation commerciale.
Les auteurs restent propriétaires, chacun pour son travail, de tous leurs droits patrimoniaux et moraux
Impression du livre :
Heliographic
73, route de Vannes
44100 Nantes
Dépôt légal BNF : janvier 2008
Notice n° : FRBNF41187088
Dépôt SHD : 2008PA11
ISBN 978-2-9531265-0-1
EAN 9782953126501